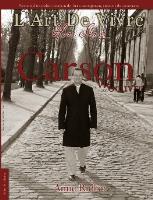 |
|
|
(French version only)
Charles Carson
Maître canadien de l'art contemporain.
«A l’écart des modes et de la facilité, Charles Carson décline toutes les facettes uniques de son immense talent poétique, en offrant dans chacune de ses œuvres, un souffle de vie, sa vie, afin qu’elles interrogent et réjouissent l’œil et l’esprit des connaisseurs qui les accrochent sur les murs de leur quotidien.
Charles Carson a creusé son sillon vers la postérité artistique, car aujourd’hui on dit c’est un Carson, comme on dit c’est un Picasso, un Matisse, un Warhol, un Basquiat et tous les autres artistes immortels.»
Christian SORRIANO
Président de DROUOT COTATION - Paris
Créateur du mouvement «carsonisme».
CARSON SA VIE SON OEUVRE.
Par Anne Richer
Cette biographie sur Charles Carson s’imposait naturellement afin de révéler l’homme et son œuvre, comprendre ce qu’il a fallu à cet artiste de persistance, de détermination pour atteindre un sommet dans l’Art.
Son cheminement artistique, qu’il soit lié ou pas à sa vie personnelle, a donné une peinture vivante qui surprend le néophyte par la clarté de sa forme, se singularise par sa force, son originalité et sa vivacité.
Charles Carson a 50 ans. Les trois décennies passées ont été fructueuses; l’artiste a consacré le meilleur de lui-même à peaufiner sa technique. La plus grande partie de son temps et de son énergie a servi à développer une écriture personnelle.
Il est indispensable que l’on se penche sur son processus de création, même si une grande part de celui-ci appartient au mystère.
Qu’en est-il de son style? Il lui appartient en propre comme celui d’un écrivain ou d’un compositeur de musique. Il n’a eu de cesse au cours de ces années de chercher, au-delà des modes picturales, car la mode voile le regard, au-delà des frontières de l’art, une nouvelle façon d’imaginer le monde. Il a exploré un langage différent, rafraîchi, éminemment imaginatif, et offert à celui qui le découvre une bouffée d’air pur. Depuis le début, il a voulu se démarquer, sortir des sentiers battus en vue de laisser son empreinte à l’art contemporain. Des explorations qui se sont poursuivies et se poursuivent encore, avec une force extraordinaire d’entêtement et de vision, parfois dans la plus grande solitude, à travers les aléas de l’existence, mais toujours avec la discipline qu’impose la pratique d’un art.
Carson est aujourd’hui une valeur sûre dans le paysage des arts canadiens et sur le plan international. Sa signature est garante d’un talent qui ne se dément pas, suscitant la reconnaissance louangeuse, l’admiration sans équivoque. La réputation de l’artiste n’est pas surfaite, car son œuvre est à la fois universelle et intemporelle.
Avec nombre d’années à venir encore à créer, ses tableaux vont atteindre indubitablement, sur le plan de leur valeur marchande, les plus hauts sommets. Pour l’amateur de statistiques : en 2008, le Dictionnaire Drouot Cotation, Paris (ISBN: 978-2-9524215-2-2) rapportait que la valeur de certaines œuvres de Charles Carson atteignait 150 000 € sur le marché international de l’art. Chacune de ses expositions au cours des dernières années, dans de nombreux pays du monde, a permis aux collectionneurs de suivre son évolution et de s’en réjouir. Plusieurs d’entre eux n’ont pu résister à l’envie de posséder un de ses tableaux, notamment Bill Clinton, ex-président des États-Unis.
Finalement, comme toute idée qui jaillit du volcan du subconscient à travers un magma de gestes et de réflexions, il est parvenu à perfectionner une technique remarquée, étudiée, décodée par les experts et historiens d’art.
Dès 1990, Louis Bruens, historien, écrivain, et expert en art, a été l’un des premiers à affirmer que la manière de peindre de l’artiste, au-delà de l’époque et des traditions, méritait son propre titre. Il reconnaissait l’originalité du style « Carson » et en faisait l’éloge dans une brillante analyse.
« La peinture au sujet de laquelle je m’exprime ici écrit-il, que l’on peut aisément qualifier de contemporaine, ne relève ni de l’impression-nisme, ni du surréalisme ou d’autres définitions en “isme”; elle s’inscrit dans un ordre de valeur totalement différent des tendances, des genres et styles que l’on retrouve généralement sur le marché de l’art. À mon avis, il s’agit donc d’une peinture véritablement distincte de tout ce qui s’est fait, et de tout ce qui se fait à notre époque, et depuis longtemps… »
Il conclut : « Carson, un nouvel “isme”. »
Pour sa part, Guy Robert (1933-2000), historien, écrivain, éditeur et fondateur du Musée d’art contemporain de Montréal en 1964, publiait en 1992 sa propre analyse objective.
« […] Aucune étiquette des “ismes” bien connus dans la pagaille de l’art contemporain ne semble pouvoir y adhérer, et je devrai donc me résigner, d’ailleurs avec grand soulagement, à nommer ce style : le carsonisme! »
Il poursuivait ailleurs ses observations :
« En ma qualité d’expert et d’historien en art mon impression initiale, en observant avec grand plaisir un ensemble important des œuvres mêmes de l’artiste, en fut une de fraîcheur, de dynamisme, de rythme : fraîcheur et vivacité de la palette, dynamisme et variété des compositions, rythme qui anime chaque segment des œuvres, un peu comme dans le meilleur jazz où le sens de l’improvisation dilate merveilleusement la structure instinctive de la mélodie et l’anime de sa syntaxe syncopée, ou, si l’on préfère, comme dans les sonates de Scarlatti et les concertos de Vivaldi, où variations et modulations fondent à la fois l’ordonnance et les subtilités de l’œuvre.
[…] Carson donne au tableau une profondeur particulière plus fascinante que la plus habile maîtrise des systèmes les plus savants de perspective. »
Qu’en disait, pour sa part, Jacques de Roussan, historien, écrivain, éditeur et expert en art (1929-1995)?
Il a analysé l’unicité de l’écriture picturale de l’artiste. « […] C’est-à-dire que tout devient silhouette et suggestivité qu’on peut lire sinon interpréter en faisant appel à un minimum de références picturales. Cela ne signifie pas que cette lecture s’impose au premier regard, mais bien plutôt qu’elle relève d’un phénomène optique avec, comme toile de fond, un kaléidoscope chromatique qui devient véritable fête pour le spectateur. Il s’agit en somme d’une nouvelle manière de peindre, une forme d’écriture picturale unique par sa sublimité, où l’on découvre un entre-deux mondes d’une mouvance perpétuelle. »
Robert Bernier, historien, écrivain, critique d’art, éditeur et rédacteur en chef de la prestigieuse revue Parcours L’informateur des arts, consacrait, pour sa part, une analyse de 16 pages à l’œuvre de Carson. Étude concrète qui donne à celui qui regarde un tableau de Carson de meilleurs outils pour le comprendre.
« Cette approche (en parlant du carsonisme) n’est pas facile à décrire, mais, de manière générale, on peut parler d’une succession infinie de touches légèrement obliques qui, sur la surface, dynamisent au maximum la perception de la matière et du sujet, le tout s’animant sur la toile dans des transparences subtiles tout à fait sensationnelles, donnant une impression de profondeur à la couleur. On dirait un flot incessant de particules, tout de même assez larges, qui balaient la matière avec une régularité fascinante, voire déconcertante. »
Voilà donc qu’existe désormais le mouvement carsoniste dans la vie des arts. On dit de lui spontanément qu’il rayonne, éclate, invente et fait preuve d’une étonnante joie de vivre.
Confirmé par le Magazine Prestige dans sa livraison de décembre 2006 : « […] Des écoles de carsonisme sont en voie d’être créées dans le monde : ailleurs au Canada, en Algérie, Espagne, France, aux États-Unis, en Afrique, Amérique du Sud… »
Bien des voix fortes continuent de s’ajouter, dont celle de Lise Grondines, historienne en art, diplômée de l’Académie française des sciences et des lettres de Paris et qui fut présidente du Salon international des Beaux-Arts de Montréal en 2002.
« […] le “carsonisme” vous place, exprimait-elle en s’adressant à l’artiste, au premier rang de l’avant-garde sur la scène artistique canadienne et internationale.
[…] Tout le monde s’entend pour dire que vos œuvres relèvent d’une parfaite maîtrise et peuvent être considérées comme des pièces maîtresses en art abstrait contemporain, au monde. Elles sont rafraîchissantes, puissamment exécutées et d’une rare expression… »
Qu’importe le titre ou l’étiquette. Qu’importe la manière de le dire, de le décrire ou même de le cataloguer. Pour l’artiste, c’est l’affaire des autres. Sans être indifférent aux témoignages admiratifs, à l’analyse de son œuvre par des experts, son tempérament ne le porte pas à pavoiser. Il poursuit la seule route familière, celle du travail.
Hommages à la nature : mer, forêts, faune.
Hommages à la beauté fragile du monde.
Indignation devant l’inconscience des Hommes.
Cris d’alarme lancés en éclats vifs sur la toile pour éviter qu’elle ne meure.
Voilà la quête absolue de l’artiste.
Avant tout, Carson donne à l’incomparable, mystérieuse et unique vie un vibrant coup de chapeau qui se répercute à la surface de sa toile et de notre conscience pour l’allumer.
|
|
«Je voudrais des prairies teintes en rouge et des arbres peints en bleu.»(Charles Baudelaire)
Le bleu. Non pas le bleu du ciel. Non pas ce bleu de Prusse que Chagall qualifiait de couleur dangereuse parce qu’elle était, selon lui, trop présente. Ni l’ardoise, ni l’outremer, ni le pervenche. Mais bien plutôt un bleu électrique, vibrant, léché, titillant le regard, éclaboussant la toile de lin tendue, posée sur le chevalet.
Avec un fin pinceau bien enfermé dans sa main, le peintre applique ce bleu avec délicatesse et assurance. C’est le seul moment, pour le bleu, où il prend un pinceau. Autrement, il se sert de ses spatules, alignées dans un ordre parfait comme les instruments d’un chirurgien.
Il sait où il va dès qu’il pose les yeux sur la toile, dès la première couleur, le premier mouvement. Il sait où il nous emmène, c’est-à-dire dans un univers autre que celui qui nous est familier. Ce sera peut-être une forêt dense, une jungle aux mille mystères; mais peut-être aussi un trésor caché au fond de la mer, des poissons inconnus qui montent la garde. Pourquoi pas des fleurs, des branches, un oiseau? C’est ce que notre œil veut y voir ou retenir. L’émotion transcende l’anecdote.
Pour lui, le peintre, c’est différent. Il laboure, il défriche avec audace. Il n’a jamais pris encore cette route. Il la trace sans hésiter comme ferait l’explorateur sur une île déserte, dans un fouillis d’herbes hautes.
Avant le bleu éclatant, il avait posé d’autres couleurs fondantes sur la toile, comme un drap. Il les a laissées se déposer.
Carson va inscrire, à travers ces couches juxtaposées, ses secrets d’alchimiste pour atteindre la transparence souhaitée. Il n’improvise pas. Fluidité, limpidité, voilà ce qui a constitué la majeure partie de ses recherches, des heures et des heures d’observations et d’expérimentations.
Ce canevas sert de point de départ. Depuis la pensée et le regard jusqu’au geste, une phrase s’est formée. Ininterrompue en dépit de points de suspension, D’une phrase à l’autre, un livre s’est ouvert. Une histoire a commencé.
On s’y aventure sur le bout des pieds, des lèvres, dans une forme de pudeur contenue, et d’excitation, il faut bien l’avouer. Comme un enfant devant un feu d’artifice qui allonge le bras vers le ciel, émerveillé par la pureté et la force des couleurs.
Le peintre est debout en sarrau, sa tenue de travail éternelle, un sarrau peinturluré de haut en bas, à lui seul un tableau, témoin des longues séances en atelier, des éclaboussures, de la débauche de couleurs.
Aujourd’hui est une des rares fois où il permet à une étrangère d’envahir son lieu physique de création, l’antre où il séduit en silence les gnomes cachés, ces génies capables de rendre visible ce qui est invisible. Il souligne le fait que je suis privilégiée de pouvoir partager durant quelques heures son espace de travail. La pudeur et la réserve lui interdisent ordinairement le grand spectacle de la performance. L’atelier est son royaume, la générosité de consentir à me recevoir est d’autant plus émouvante.
Sa compagne y accède du bout des pieds pour lui rappeler affectueusement qu’il ne doit pas oublier de manger, de reprendre son souffle. Mais, comme tout artiste, il a besoin de s’extraire du monde, de s’enfermer dans sa bulle. Il lui arrive même de perdre la notion du temps.
Ses lunettes de presbyte posées en équilibre sur le bout de son nez, il me gratifie d’un grand éclat de rire qui permet enfin d’éclairer un regard inquiet, constamment aux abois; un regard qui tient à la fois captif et distant son interlocuteur. Des yeux qui ont l’habitude de voir ou d’imaginer autre chose que la réalité, au-delà de la réalité.
Ce jour-là, malgré ma présence, il s’étonne de sa capacité de concentration. L’expérience n’est donc pas trop désagréable. C’est plus fort que lui : pinceaux, peinture, spatules, éclairage, l’ordre nécessaire au rituel, rien ne peut le distraire sévèrement de son travail. Ni du regard, ni de l’esprit. Il parvient même à rester attentif aux questions les plus naïves, auxquelles il répond d’une voix douce, patiente. Il réfléchit à voix haute :
« D’où me vient l’inspiration?
– Oui, à quoi penses-tu maintenant, là, en faisant ce geste?
– C’est inexplicable. Je ne sais pas. Je fais ce que je ressens. »
Et puis, silence.
Le refuge du peintre est situé à mi-chemin d’une impasse anonyme, presque banale, sans les signes distinctifs habituels que certains artistes exubérants impriment à leur lieu de vie. Parfois, ce sont des sculptures étranges longeant les sentiers, des couleurs osées, une signature sur une boîte à lettres ou bien une architecture excentrique.
Mais Charles Carson n’est pas exubérant.
Il n’a rien du personnage farfelu ou scandaleux. Il cherche plutôt à se fondre dans la foule, à rester anonyme. À la limite, il n’a pas l’air d’un artiste, c’est-à-dire qu’il ne tente pas de créer l’illusion en déguisement ou en décor.
Une fois la porte de sa tanière refermée sur nous, l’espace le retient, entre en lui, de même que l’odeur des pigments et la lumière de novembre.
Tout me saisit : la poésie et la gravité du lieu. Une sorte de folie sous-jacente exubérante et douce. Dans ces murs, ces meubles, il est chez lui, à l’abri de tout ce que le monde extérieur peut signifier de dangereux ou de triste, d’incompréhensible.
L’atelier. Ce n’est pas seulement un lieu physique. Un atelier de peintre, le sien en particulier, est un lieu mystique. Dans tous les recoins, peu importe l’heure, des étincelles de créativité surgissent pour mettre le feu à la toile, des forces étranges qui sommeillaient s’éveillent enfin dans les gestes cohérents et précis de l’artiste. Ce que le peintre voit et que nous, nous ne voyons pas, est issu d’une réalité incontestable. L’artiste véritable crée un univers. Ce peut être celui dans lequel nous vivons, mais il peut s’agir aussi d’une sorte d’Atlantide, paradis perdu, société idéale. Nous pourrons chercher à le comprendre une fois le tableau terminé.
Quel est son rituel avant de se donner, comme un artiste avant d’entrer en scène? Un salut virtuel à la rivière, sorte de pacte entre la nature et lui. La rivière du Nord. Cette eau noire automnale dont le courant suit la direction du vent et emporte sous nos yeux, ce jour-là, des canards tout ébouriffés, qui hésitent entre prendre leur envol vers des cieux plus cléments ou partager avec nous la glace et la tourmente à venir.
Le choix de ce lieu de vie ne tient pas du hasard seulement. Charles Carson avait besoin de cette eau, de cette rivière qui lui apporte, durant la belle saison, l’occasion de prendre le large en pensée, de jeter une ligne à l’eau. Il souhaitait cette mouvance, l’eau qui coule dans une direction et qui tout à coup bifurque pour faire face au vent. Qui n’arrête jamais son élan, comme la vie elle-même. Il ne se sentirait pas heureux dans un paysage plat, une solitude figée, à la manière du peintre Lemieux.
Sur l’autre rive, les arbres sont serrés les uns contre les autres, frileux, noirs et nus. Ils vont alimenter la mélancolie de l’artiste pour de longs mois. Il voudrait tellement que l’été perdure, qu’il y ait du soleil en abondance, un hamac caché sous les feuillus pour laisser libre cours à une certaine indolence qui l’habite. Afin de produire l’énergie créatrice, il lui faut de ces moments suspendus dans le temps, entre ciel et terre, entre action et contemplation.
Il a eu le loisir d’admirer bien des paysages dans le monde, de plus beaux sans doute. Mais celui-ci se profile à l’horizon de son atelier, si près qu’il pourrait s’y perdre. Il l’apprivoise, il se l’approprie.
« Et que vienne la neige! » dit-il. Lorsqu’elle tombe en rafales et qu’on est à l’abri, elle devient belle. Sa lumière au mois de janvier est unique, il en convient, mais elle ne servira pas son inspiration, du moins pas consciemment : « Je n’ai pas envie de peindre ce genre d’atmosphère. »
La rivière du Nord suggère des images précises en lui : celles du canot, de la canne à pêche, d’une échappée dans la furie du temps. Elle est présente de toute sa force et entretient vivants les souvenirs de son enfance. Du moins d’une certaine période de son enfance, celle des jeux et de l’insouciance.
Il choisit de faire comme les canards, les pieds dans la banquise, la tête dans les nuages à attendre qu’elle se gonfle de pluie le printemps prochain, la surprendre à lécher les cailloux du rivage et la découvrir éternellement vive et joyeuse.
Mais revenons au tableau et à l’atelier.
La table trônant au milieu de la pièce est recouverte de grandes feuilles de contreplaqué. Les pots de peinture acrylique sont à portée de main, car l’artiste crée ses propres mélanges selon son inspiration et l’alchimie créatrice des unions secrètes entre les pigments et lui. Le choix des couleurs composées n’est pas fortuit. Bien qu’il soit guidé par une vaste expérience peaufinée d’années de travail, l’idée qui germe et sa sensibilité vont s’imprimer avec leur personnalité propre.
Il a donc réuni ses outils et placé le chevalet à contre-jour. Un divan projette sur le plancher son ombre rose. Des tableaux récents couvrent les murs. On entend en sourdine la voix du ténor Pavarotti.
« J’aimerais que tu écoutes bien la dernière note, me dit-il en haussant le son de l’appareil. Quelle émotion! »
Il peint souvent en écoutant de la musique qui provoque l’émergence d’images, de souvenirs.
L’opéra pour lui se résume en ces mots : « Les violons, l’intensité, le drame. Cela me vire à l’envers. C’est de l’art pur, un chef-d’œuvre, cette musique! »
L’œuvre picturale est elle-même une symphonie interprétée par un grand orchestre dont chaque instrument, chaque tonalité apporte sa contribution au tableau.
« La peinture, c’est aussi des mots », dit-il en reprenant l’ouvrage interrompu. Peindre ou écrire relèvent du même geste. Il aime penser, et il le répète souvent, qu’il est devant la toile comme l’écrivain devant la page blanche.
Il pourrait, à l’instar de Baudelaire, déclarer que : « La peinture est une poésie qui se voit au lieu de se sentir; et la poésie est une peinture qui se sent au lieu de se voir. » Le poète affirmait aussi qu’un coloriste est un poète épique.
Carson a son écriture, son style. Il exprime sa créativité, unique en son genre, par une technique remarquée, décodée, identifiée, qui lui a valu des analyses de la part d’experts et d’historiens en art réputés, telles qu’elles sont décrites dans l’avant-propos.
L’objectif de perfection n’est cependant jamais atteint. C’est à la fois une quête et un désespoir. Mais c’est aussi du courage. Celui de ne pas baisser les bras, ni la tête. Comme pour tout artiste véritable, le doute est son compagnon, suivi parfois de périodes d’exaltation où tout semble plus facile, où les œuvres plaisent sans qu’il ait quoi que ce soit à repenser. Pour son pur plaisir.
Carson poursuit donc devant moi le tableau entrepris quelques heures plus tôt, qui se découvre un thème, une anecdote. « Le spectateur doit apprendre à lire, consciemment ou pas, les scènes et les sujets proposés. Dans un enchaînement presque endiablé des éléments de la composition, on distingue les propos de Carson derrière la puissance formelle de son interprétation », expliquait pertinemment Jacques de Roussan.
« Ce qu’il y a sous nos yeux à l’heure actuelle, c’est un brouillon », dit le peintre encore insatisfait, soucieux d’aller au bout de ce qu’il a en tête.
Que dit-il lui-même de son processus de création?
« Je travaille les formes, je laisse couler l’inspiration avec elles et je définis peu à peu ce que ce sera. Je ne dessine rien avant. »
« Il peint beaucoup à l’inspiration, écrivait le critique et historien d’art français, Alain Coudert. Le spectateur en ressent l’ardeur, ce souffle exigeant, surtout au contact de ses grands formats. Exécutant l’œuvre aux frontières semi-figurative et non figurative, Carson pose sa matière à la spatule, en transparence dans sa juxtaposition de couleurs, obliquement et par petites touches. Il complète ensuite son œuvre par un traitement en diagonale et en épaisseur des blancs, comme un effet ténu de neige. Ceci a pour effet de concentrer la lumière et d’accentuer les contrastes… On reconnaît la main du maître, celle du carsonisme qui fait école… »
Aujourd’hui, pour ce tableau qui vient tout droit de son imaginaire, il veut aller plus loin, faire apparaître autre chose qui va se raffiner par un trait ici, un trait là, se parfaire, demander de la réflexion.
Le tableau tel qu’il était déjà m’apparaissait abstrait, moderne, éclatant, et le peintre aurait pu s’arrêter là. Magie de l’image qui nous entraîne très loin, dans un seul regard. Selon moi, il s’agissait d’un tableau digne d’enrichir une collection privée.
« Voilà, c’est fini, je signe », aurait-il pu me dire.
Mais a surgi cette impulsion incontrôlable qui l’a ramené à la spatule, au pinceau, au regard soucieux et pointu posé sur le tableau. C’est qu’il sentait émerger autre chose qui n’était pas tout à fait en vie encore, autre chose qui n’attendait que lui pour venir au monde.
Cette autre chose tirée du magma de couleurs devenait des fleurs, un bouquet entier, me semblait-il. Oui, mais quelles fleurs? Où est le modèle? Il n’y en a pas. Celles-là n’ont pas de nom. On ne peut pas dire en les regardant : « Ah! Voilà des pivoines. Des roses! »
Et le vase et la table qui n’existaient pas il y a à peine quelques instants, ce décor, cette perspective tout à coup installée par un trait et qui donne de la profondeur au tableau. De quelles superpositions de tons sont-ils issus? De quels gestes? Encore une fois, où est le modèle? Comment voit-il ce qui semble invisible à l’œil nu?
J’ai pourtant bien regardé, je n’ai rien vu; il n’y a aucun signe extérieur d’inspiration. Le tableau a été exécuté de l’intérieur. Tout est apparu, a disparu, réapparu; l’ébauche et plus tard le tableau fini ont été un tour unique de prestidigitation.
Étonnement de ma part! Il est lui-même surpris, surexcité. C’est cette émotion qu’il recherche en peignant. « Ce plaisir », ajoute-t-il. Et cette découverte d’un secret en son être qui s’incarne sur la toile. Comment son cerveau a-t-il pu emmagasiner tant d’éléments épars et comment l’inconscient parvient-il à y mettre de l’ordre? Touches subliminales et subtiles de jours enfuis, de paysages, d’émotions, d’amours; les heures passées à rêver, à réfléchir, à donner un sens à la vie. Tout nourrit l’acte de créer.
Mémoire heureuse aussi, puisque, dans une sorte d’hallucination, ce qui apparaît sur la toile est primesautier, et peut s’expliquer comme l’écrivait Guy Robert :
« Peindre n’est pas copier, ni reproduire. Peindre, c’est évoquer comme chez Cézanne, ou célébrer comme chez Rubens, voire fustiger comme chez Francis Bacon. Mais peindre, c’est surtout faire apparaître, révéler, “donner à voir”, selon le beau titre d’un recueil de poèmes d’Éluard, publié en 1939. »
Charles décode l’étonnement sur mon visage et lit dans mes pensées :
– Tu te poses la question, n’est-ce pas? Est-ce une nature morte? C’est ainsi que l’on décrit ce genre de peinture. Je pense que ce n’est pas une expression juste. Je crée une nature pleine de vie, moi, exubérante, loin d’être morte! Pourquoi inventer des mots qui sonnent faux et cachent leur vrai sens?
Le peintre est en pleine dérive de langage. Son regard s’illumine et il éclate de rire en suivant mon regard absorbé par le tableau.
– Quel est le message que tu veux transmettre?
Il réfléchit à sa réponse.
J’ai le temps d’ajouter :
– Et faut-il absolument un message?
– Certes le langage de la peinture abstraite n’est pas compris par tout le monde.
Il n’y a aucune part de snobisme dans cette réflexion. Bien au contraire. Son humilité naturelle favorise son empathie pour les autres :
« Il faut d’abord comprendre les gens pour qu’ils comprennent une œuvre. Comprendre qu’ils n’ont peut-être pas eu l’éducation scolaire, la culture familiale ou des contacts répétés avec l’art pour comparer les artistes, analyser les cheminements, les techniques différentes. »
Il ne tient pas à ce que son travail reste en vase clos, n’appartienne qu’à une élite. « Je veux donner une ouverture à l’œuvre. L’ouverture nécessaire à la bonne compréhension du public. »
La conscience des êtres en général tient à sa personnalité profonde, mais est aussi le résultat d’une vie en dents de scie, en déboires qui le porte à les comprendre sans effort. C’est à la fois une force et une faiblesse, peut-on penser lorsqu’on le connaît mieux.
Il croit qu’il doit partager son talent et son savoir-faire avec tous ceux qui y sont sensibles. Son travail de peintre, c’est une chose, mais, lorsqu’il ne peint pas, qu’il redevient un homme « ordinaire », il écoute toutes les histoires, tous les chagrins, se laisse séduire par les larmes, fond devant la misère, pleure avec le pleureur. Est-il nécessaire de préciser qu’il a eu son lot d’entourloupes et de hâbleurs? Il tente aujourd’hui de mieux se protéger, mais la carapace est toujours douce et tendre au toucher.
Au moment où il crée, un artiste participe à la beauté de l’univers. C’est un acte de communion entre les êtres humains. Un don de rédemption.
Le peintre Rouault avait une vision douloureuse de son art : « La peinture n’est pour moi qu’un moyen d’oublier la vie. Un cri dans la nuit. Un sanglot raté. Un rire qui s’étrangle. »
Carson va dans la direction opposée.
Il y a des moments, bien sûr, où le sens de la vie nous échappe, où la vue se brouille, où l’espoir s’effiloche. Il faut résister aux assauts du négativisme, rester vivant coûte que coûte.
« Je veux apaiser avec ma peinture. J’aimerais consoler celui qui est triste, lui redonner le goût de vivre. L’art doit nous rendre meilleurs, avec toute la passion de la vie, toute l’énergie du possible. »
Il a la tête pleine de choses à dire et n’a pas encore livré tous ses mots, comme s’il s’agissait d’une richesse inépuisable.
Au début de la cinquantaine, il se sent d’attaque, régénéré par la mise au rancart des tristesses de sa vie. Il a fait ce choix, il y a relativement peu de temps, de travailler sur le bonheur, sur son bonheur, de rester lové dans une bulle rose et douce. Le diable emporte la notion que les artistes ne peuvent créer que dans la souffrance, ou dans l’orgueil même, tout concentrés sur le paraître! Il jette un sort aux défaitistes. Et tant pis s’il n’est pas compris au premier regard. Il prend sa revanche avec ceux qui tressaillent devant un tableau et qui rendent grâce à l’artiste, à leur manière, en choisissant de l’emporter chez eux, dans leur intimité.
Alors, il peint. La nuit de préférence. Il n’a pas besoin de paysages, de modèles vivants, ni de cartes postales. La lumière du jour ne lui est pas indispensable; il la jette sur la toile la nuit en éclats multiples par la seule force de son évocation.
– Tu y vois clair?
– La nuit, je suis forcé de travailler des couleurs plus intenses. Alors, le tableau, le jour, « éclate ».
La nuit, il rôde comme un chat dans la maison sur le bout des pieds. Ses savates familières et usées le mènent droit à l’atelier, en traversant d’abord la cuisine, le salon, son bureau, tandis que la maisonnée est endormie. Il centre son esprit sur un point. La toile qu’il a tendue plus tôt dans la journée irradie dans le noir.
Le temps pour lui semble n’avoir ni commencement ni fin. Parfois, une lune bienveillante lui tient compagnie en éclairant juste ce qu’il faut sur sa table de travail. Les silences familiers de la maison, le chien à ses pieds :
– Chut! Ne fais pas de bruit, lui dit-il.
Ce sera pendant quelques heures la fête des images lointaines, rayonnantes sur la toile de lin, transformées, transfigurées.
« […] Il ennoblit ses modèles jusqu’à la sublimation la plus totale. Il les plonge dans un bain de lumière et de couleurs et leur redonne leur essence première, leur faisant ainsi atteindre, au travers de cette brume lumineuse et colorée, une apparence multidimensionnelle… », écrivait Caroline Leroux, critique d’art (extrait des Éditions Utilis, Art 1997).
Ce calme! Le corps et l’esprit réconciliés, voilà ce qu’il aime de la nuit. Et tout ce qu’elle lui a donné lorsqu’elle se retire à l’aube, tout cet accomplissement. Quelle joie de peindre! Et quelle bienheureuse fatigue que cette joie!
Les heures s’étirent entre nous et le peintre est toujours debout sur des jambes solides, esquissant de temps à autre un pas arrière. Les sourcils froncés, il vérifie la composition, le cheminement de l’œuvre. Et voilà qu’elle lui fait exprimer cette autre idée.
– Le rôle de l’art est de créer l’émotion. Le tableau doit nous parler, nous emporter loin, le plus loin possible. On ne doit pas acheter un tableau sous prétexte que le peintre est bien coté. C’est une très mauvaise décision. Ce qu’il faut reconnaître chez un artiste, c’est cette volonté d’aller plus loin dans la communication.
En 1993, à l’occasion du lancement du livre Carson, publié chez Iconia, et écrit par Guy Robert, la conservatrice du Musée Vaudreuil-Soulanges où avait lieu l’événement, Pierrette Labonté, a confirmé l’objectif de l’artiste : « Lire ses œuvres, c’est contempler, c’est découvrir la figuration à travers l’abstraction dans une explosion chromatique qui apporte joie et bonheur de vivre. Elles font du bien au cœur. Leur qualité, leur originalité et leur dynamisme nous entraînent, nous emportent, nous réjouissent. »
« Objets inanimés, avez-vous donc une âme? », se demandait le poète. Pour l’artiste peintre, le plus grand défi consiste à donner une âme à l’ensemble de son œuvre.
– L’œuvre porte en elle-même sa propre émotion. Mais son créateur en est l’instigateur, reconnaît Carson.
Il y a la forme et il y a le fond. La pensée de l’artiste est indissociable d’une œuvre marquante, durable. Elle doit s’articuler sur une profonde sensibilité, sur l’intelligence universelle.
Pour donner de l’équilibre à un tableau, rien de tel que les mathématiques, les règles de compositions, la règle d’or, les règles de perspectives, suggère-t-il.
– Elles sont la rigueur quand tout le reste paraît illogique.
Il aurait aimé poursuivre ses études pour en comprendre mieux les rouages. Car les mathématiques recèlent une intuition qui rejoint l’art : des oppositions certes, et finalement une logique formelle construite sur la base du symbolisme. Les chiffres eux-mêmes sont des symboles. Nombres et symboles, pour les mathématiques : espace et temps pour l’Art.
Un tableau fini n’est pas incertain; il contient sa propre logique et s’adresse à nous dans une langue intelligible. C’est un monde en soi. Comme dans la galaxie où la multitude est tout de même organisée. Il se laisse soudain emporter par son enthousiasme :
– J’ai toujours eu des envies de grands tableaux, s’écrie-t-il, en esquissant de larges gestes. Je vais exploser!
Dans un même souffle, il ajoute :
– Il faut que je consacre le temps voulu à ce quelque chose d’immense que j’ai envie de créer. Ma tête est pleine, elle déborde, c’est difficile à expliquer. Et, si je ne fais pas bientôt ce qui est là, je vais être profondément malheureux. J’ai déjà connu cette exaltation, mais de cette intensité, jamais.
Dans cette expectative, il y a une part de souffran-ce. Il pense à tous ceux-là avant lui qui ont dû traverser cet état et qu’il admire du plus profond de son être : les Léonard de Vinci, Michel-Ange, Turner, Matisse. Ces génies qui ont donné leur vie à l’Art et dont les œuvres traversent le Temps et continuent d’émouvoir.
L’artiste ferme un instant les yeux, dépose ses lunettes sur la table, repousse de la main le chevalet. La fatigue commence à creuser sa niche dans ses reins. Il s’étire comme un chat. De gros nuages noirs chevauchent le ciel, la rivière est devenue sombre, la fin du jour allonge son ombre à nos pieds et jusque sous nos yeux. La lumière n’est décidément plus la même.
Le tableau non plus. La couleur est souveraine, organisée et insuffle déjà son énergie.
« La couleur pure! Il faut tout lui sacrifier. L’intensité de la couleur indiquera la nature de la couleur », disait Gauguin.
Couleurs et sujets sont apparus, les uns et les autres entrelacés, ne faisant plus qu’un. Il ne semble pas y avoir eu de véritables difficultés picturales au cours de ces heures de travail. Ou bien est-ce une espèce d’état de grâce propre à l’artiste, qui a suffi à les gommer? Le tableau pourrait être signé; il ne le sera que plusieurs jours plus tard.
Le ton des confidences baigne dans une douce torpeur. Il faudrait du café. La voix est plus rauque, assourdie.
– Tu n’as pas l’habitude de disséquer ton travail?
– En cours de création, non. Le processus exige une parfaite concentration. Là, je suis entre deux mondes. Il faut une sorte de transe pour peindre. Et expliquer la façon de faire une œuvre au fur et à mesure de sa mise au monde me ramène au réel, me fait perdre le fil. Voilà pourquoi je ne le fais jamais.
Il a souvent dit : « L’art de peindre est d’oublier la matière, cette dernière n’existe pas... elle n’est plus qu’ombres, lumières et couleurs aux reflets multiples. »
Voilà qu’on le réclame pour le dîner.
Ce partage intime d’une journée de travail au cours de laquelle un tableau s’est ébauché, s’est poli, s’est inscrit dans sa réalité, a permis de tisser des liens avec l’artiste, d’investir son intériorité, d’établir le pacte de la confiance mutuelle grâce à laquelle il pourra explorer plus avant.
C’est la fin de la journée des premiers pas vers la découverte de l’artiste.
Ce fut tout au long des jours, des mois, un processus semé de découvertes multiples; de fascinants paysages intérieurs, quelques fois noyés de brume, d’autres fois nimbés de rose.
Le mois de mars 1957 était comme ceux que ce pays connaît : gris, dégoulinant, porteur de giboulées ou de giboulettes, selon l’expression acadienne, cette neige mouillée et molle qui tombe du ciel en rafales et réduit à néant l’espérance de temps doux. C’est aussi en général un temps de lassitude, un entre-deux, après le long hiver qui nous a privés de chaleur et de lumière. Dès la deuxième semaine du mois, à l’approche de la date officielle du printemps, on se sent des fourmis dans les jambes, on a envie d’ouvrir grand les fenêtres. Pour peu qu’un tout petit rayon de soleil nous y invite.
On imagine aisément l’impatience du couple devant l’éminence de la venue au monde de leur cinquième enfant, prévue le 13 mars. Surtout pour Claire, jeune mère déjà fortement accaparée par quatre enfants turbulents attachés à ses pas.
Pour elle, les journées sont bien remplies, le ventre lourd, les pieds endoloris; elle est parfois rompue de fatigue par des nuits de veille si l’un d’entre eux a été malade. Sans compter l’ordinaire de la maison qui exige temps et énergie!
Pour lui, l’hiver a été particulièrement rude. Entre son travail de réparations mécaniques au garage familial, les tracasseries inhérentes à la bonne marche de son affaire, les menus travaux pour rendre son foyer plus confortable, le chef de famille est, lui aussi, éreinté. On le retrouve parfois taciturne, mais habité d’une forte ambition qui ne s’est jamais démentie au fil des années.
Les aînés entendent leurs parents discuter de la possibilité, de la nécessité une fois encore de déménager. Changer de maison est un geste qui se justifie par le désir de trouver mieux, plus grand, plus confortable.
Au moment de la naissance de Charles, ils habitaient le quartier ouvrier Saint-Michel à Montréal. C’était dans la rue, dans la ruelle, au parc que les enfants apprivoisaient leur univers.
Le 13 mars 1957 tel que prévu, dans un décor de briques, de bois et de pierres, en pleine nature citadine, quand l’hiver fond en rigoles, est né le cinquième enfant de la famille : Charles.
Un autre garçon!
En attendant la venue de ce futur petit-fils, le grand-père paternel avait fabriqué des jouets en bois fignolés avec tendresse. La grand-mère possédait bien des habiletés comme celle de fabriquer des sucres d’orge dont les enfants raffolaient! Elle était prodigue de gâteries à leur égard. Ces gestes simples étaient remplis d’une grande affection.
Chez les garçons qui précèdent Charles, la venue d’un nouveau bébé ne signifiait pas grand-chose à part le fait qu’ils seraient encore plus nombreux à se partager l’attention maternelle.
Ce sentiment confus est une ombre portée sur le nouveau venu, déclaré officieusement futur souffre-douleur. N’est-ce pas souvent le rôle ingrat du benjamin dans l’organisation du pouvoir des aînés? Qui sera le mâle dominant dans la meute? Les paris se sont ouverts, chacun des garçons possédant une forte personnalité. Et jusqu’à quel point la guerre aura-t-elle lieu dans l’enfance d’abord et plus tard dans la vie?
C’est au fil des années que le cinquième enfant de la famille se rendra compte de leurs défaillances malgré leurs airs de conquérants. C’est en vieillissant au sein de cette meute que le cinquième enfant aiguisera ses dents.
La naissance de Charles ne marque pas la fin de la famille, loin de là. Cinq autres enfants vont venir grossir le clan après lui. « Ma mère n’a jamais eu beaucoup de vacances », reconnaît Charles, magnanime, car il sait, maintenant qu’il est père lui-même, ce qu’une famille représente.
Même s’il était jeune, il a surpris à maintes reprises cette envie que son père et sa mère éprouvaient de se retrouver en couple. « De temps en temps, on les voyait en route pour l’église, seul lieu où ils pouvaient se retrouver seuls sans toute la marmaille. »
Il les comprend d’avoir eu envie d’être ailleurs au loin, sur des plages, sous des cieux plus cléments, pour adoucir leur vie quotidienne. Goût de l’aventure? Ils choisiront de temps à autre des escapades sur les plages américaines, dans des lieux touristiques populaires, lorsque l’état de leur fortune le permettra. Seuls les derniers-nés de la famille profiteront le plus souvent de ces plaisirs. Comment, de toute façon, pourraient-ils partir à douze dans une auto?
Au cours de sa tendre enfance, Charles s’est souvent perdu dans ses pensées, semblable à tout enfant imaginatif et sensible. Une feuille d’arbre qui virevolte, un nuage, et voilà que cet enfant n’est plus là. On a beau le réclamer, le chercher, son esprit vagabonde parmi les belles choses du monde, toutes celles qui sont invisibles et mystérieuses.
Ce serait tellement plus facile de regarder le paysage, de suivre du regard l’eau noire de la rivière, de se balancer langoureusement et tranquillement au rythme du temps. Suivre la trace d’un rêve, mais ne pas faire l’effort de le réaliser. Comme des millions d’êtres humains.
L’environnement de son enfance ne portait pas particulièrement à rêvasser. C’était un luxe de se laisser aller. Le contexte économique de l’époque, la dynamique familiale ne donnaient pas beaucoup le temps aux images vagues de se fixer. Autant d’enfants dans la famille! Tant d’agitation quotidienne! Et tellement de préoccupations à la fois indispensables et triviales chez des parents qui avaient la responsabilité première de mener tous leurs moussaillons à bon port.
Le rêve éveillé est pourtant si fertile, si prometteur! Surtout pour une jeune personnalité sensible qui se cherche. Peut-être davantage chez un être muni d’antennes qui se rendait compte assez rapidement que, si rien n’est solide en ce monde, rien n’est acquis, qu’il faut se tenir aux aguets à l’égard des dérapages quotidiens des êtres qui nous entourent. On doit essayer de protéger le confort de son rêve, tenir éloignée l’anarchie et rester accroché aux plus belles choses du monde, celles justement qu’on ne voit pas.
Peut-être est-ce ainsi que l’imaginaire d’un artiste se crée.
Peindre, c’est comme inspirer et en même temps expirer. Le geste s’inscrit dans la vie, au même titre qu’un cœur qui bat. Voilà plus de 30 ans que Charles Carson a fait le choix de maintenir vivant son souffle pour la création. Une énergie renouvelable, mais fragile. Chez tout artiste, le défi consiste à garder les pieds sur terre tout en ayant la tête dans les nuages.
Peindre, c’est aussi créer des éléments et ensuite les réunir pour en faire une œuvre. Comme pour une musique qui s’ébauche de l’intérieur et veut prendre le large, une page qui se noircit de mots, un corps qui danse. Une œuvre est d’abord issue d’éléments épars qui, par la magie du talent, composent une production distincte et cohérente.
Faire émerger tout de suite, entre un pinceau et une toile, par la seule force de l’imaginaire, ce qui n’existait pas. Le défi est de pouvoir faire comprendre et aimer cette chose nouvelle, la rendre accessible.
À cette époque pas si lointaine, faut-il le rappeler, les clochers des églises catholiques étaient nombreux à poindre dans le ciel québécois. On avait même surnommé Montréal : la ville aux cent clochers! Et les parvis d’église depuis le début de la colonie et encore au cours de la deuxième moitié du XXe siècle constituaient le lieu par excellence des rassemblements sociaux. Des bavardages.
Lieu rassembleur, c’est là que s’entretenait le rite catholique invitant les familles, hommes, femmes et enfants, à une pratique fervente. À l’intérieur de l’église, le silence était obligatoire, et le respect des lieux imposait même une certaine rigueur dans la tenue vestimentaire. Chapeaux à plumes et à voilettes pour les femmes, col empesé et veston du dimanche pour les hommes. Plusieurs fois par année, à l’occasion des grandes fêtes religieuses, les enfants y étrennaient leurs nouveaux atours.
C’était déjà, pour l’enfant sensible, les caractéristiques d’un certain esthétisme qui s’imprimait par le protocole, les rituels, la tradition.
L’intérieur du temple catholique, qu’il fût situé dans une riche paroisse ou dans un village modeste, reflétait le goût baroque, imposé par des siècles d’architecture religieuse. La demeure de Dieu devait être la plus brillante, la plus somptueuse de toutes.
Ce fut là le décor des premiers émois et découvertes esthétiques de nombreuses générations. Si certains fidèles y étaient plus ou moins sensibles, d’autres, par ailleurs, en subissaient un émerveillement béat. L’église physique de pierre et de verre semait le germe d’un rêve, d’une certaine vision de la beauté.
Où donc ailleurs qu’à cet endroit pouvait-on voir la lumière transfigurée de vitraux éclatants, admirer l’étonnant talent des sculpteurs de statues, et celui non moins spectaculaire des peintres de tableaux du chemin de Croix? La musique elle-même, les voix, tout le répertoire sacré ont souvent consacré des vocations artistiques. Le silence et le recueillement jouaient un rôle subliminal pour imprimer des images fortes, durables.
Charles, tout petit, assistant en compagnie de ses parents et de ses frères aux cérémonies religieuses, surtout celles des grandes fêtes qui exigeaient un cérémonial particulier, y trouvait un pur ravissement. Il remarquait tout. Les peintures en trompe-l’œil, les habits sacerdotaux brodés d’or, la foule recueillie. Il s’en souvient encore avec émotion. Le charme opérait déjà quand il franchissait les lourdes portes de l’église à Repentigny, ville de banlieue cossue où la famille était allée s’installer quelque temps après sa naissance. Il passera toute sa jeunesse à cet endroit.
Sensible aux symboles de manière précoce, en plongeant son index dans l’eau du bénitier, il se sentait purifié et légitimé. De quoi? D’entrer de plain-pied dans une caverne d’Ali Baba somptueuse. De se gaver les yeux de tout ce qui brille : celle de la flamme dansante des lampions dans les chandeliers, celle des candélabres. Mêlés à l’odeur de la cire fondante des bougies flottant dans l’air, les effluves de l’encens lui donnaient vaguement la nausée.
Selon l’heure du jour, la lumière extérieure se répercutait sur les saints de plâtre, conférant à leurs yeux de vitre un air de vie. Les anges et les saints des vitraux s’animaient. L’enfant Charles était emporté dans un autre monde. Évidemment ce n’est qu’aujourd’hui qu’il en mesure l’impact sur son imaginaire, dans un souvenir sublimé et attendri.
Était-il agité? On l’imagine plutôt immobile, docile, imitant la foule, nullement mortifié ni impatient. Silences, chuchotements et psalmodies, debout, assis, à genoux, tout cela ajoutait au mystère enveloppant.
Il y croyait. C’était sa foi. Une foi enfantine, naïve et absolue.
Quel était donc le lien qui l’unissait à Dieu dans sa jeunesse? Quand on ne sait rien du grand Mystère, quand on est un enfant, on suit la voie que les autres nous tracent. Avec le temps, si la foi fuit, Dieu s’éloigne petit à petit et sa voix disparaît. On est seul. On cherche un Père.
Une fois qu’il est adulte, l’église, symbole de la réunion de fidèles unis par les mêmes croyances, a perdu sa magie, quelque peu de sa poésie, de son authenticité à ses yeux. Pourquoi? La foi est un mystère, et la perte de cette dernière l’est encore plus. Il s’en est éloigné, a suivi en cela la désaffection d’une partie du peuple québécois envers les pratiques religieuses.
Charles comme tant d’autres se demande ce que Dieu fait pour les êtres humains, quelle est cette sorte d’amour qui ne peut empêcher les catastrophes de se produire? Il a alors développé une spiritualité personnelle basée davantage sur le désir de l’Homme d’atteindre l’absolu en poursuivant un idéal. Qu’il soit artiste ou mystique, l’Homme tend toujours vers la perfection.
Sa liberté individuelle, sa liberté d’artiste sont allergiques, depuis qu’il en est conscient, aux diktats quels qu’ils soient. Si l’artiste doit être esclave de quelque chose, c’est de l’impulsion de créer seulement. Une exigence absolue.
Et puis le Dieu de son enfance ne doit pas être enfermé uniquement dans un lieu de pierres, mais dans le vivant : « Il est en nous, en chacun de nous, car la création ne peut être guidée que par la puissance d’un Créateur universel. Force inexpliquée, transe, qui nous mène à dépasser nos limites », croit-il. Rien ne peut résister à la puissance de la volonté humaine. « L’Homme doit exercer son libre arbitre. C’est le gage de sa liberté. » Les forces que l’on porte en soi sont des outils de dépassement. La conscience de ne faire qu’un avec le monde, d’appartenir aux étoiles et aux grains de sable lui est venue dans un même souffle. Les montagnes, les rivières, les mers, tout ce qui appartient à notre Univers, tout ce qui vit sont pour lui des lieux sacrés, mythiques, plus précieux qu’un autel couvert d’or. L’effet « cathédrale » des grands arbres, notamment ce qu’il découvrira plus tard en Amazonie, le force à admirer le génie du grand Architecte.
Le véritable mystère pour Charles réside dans la nature même du besoin de créer, cette impulsion qui le mène, lui, à tout lui donner.
|
|
Son statut «d’enfant du milieu » a façonné son tempérament, c’est indéniable. Faire sa place dans une famille de dix enfants représentait en soi un défi. L’enfant était timide et tranquille, pas très bagarreur, sauf en cas d’intrusion de son territoire. On pensait peut-être qu’il était heureux simplement, sans grandes exigences, qu’il n’avait pas besoin qu’on s’attendrisse sur ses états d’âme. On l’oubliait. Parfois même physiquement, comme on le verra plus tard.
Pourtant, chacun des dix enfants, neuf garçons une fille, avait besoin de sa dose d’attentions, de tendresse. Besoin de se sentir unique, malgré le nombre d’enfants, par un amour parental qui peut seul forger un adulte équilibré.
Agatha Christie devait posséder cette richesse intrinsèque pour survivre aux multiples meurtres qu’elle a décrits. « L’une des plus grandes chances qui puisse vous arriver dans la vie est d’avoir une enfance heureuse. J’ai eu une enfance heureuse. »
Charles aussi a eu une enfance heureuse, tient-il à préciser. Quels sont les enfants devenus grands qui n’ont pas la nostalgie d’un passé absolu, idéalisé?
Les caresses et autres démonstrations d’amour n’étaient pas tellement répandues à cette époque, surtout dans les familles nombreuses! Est-ce par pudeur, pruderie, voire ignorance du b.a.-ba de la psychologie enfantine? Le temps manquait, l’énergie allait au plus pressant : la survie. Les enfants devaient d’abord manger. Et puis, à quoi serviraient les démonstrations intempestives d’affection pour des garçons? Ils deviendront des hommes forts, et des hommes, c’est connu, ça ne pleure pas.
Charles, à l’instar de ses frères, rêvait de devenir grand, habile et débrouillard comme son père.
L’air sage et résigné du petit garçon lui permettait instinctivement, en guise de consolation, d’échapper à une partie de l’autorité parentale. Qui se soucie d’un enfant tranquille?
Cet enfant était, de plus, généreux et empathique. Il partageait. Il comprenait, protégeait. Des qualités à double tranchant qui le plaçaient souvent en état de vulnérabilité, d’exploitation, si ce n’était d’abus.
Une famille nombreuse peut être une école d’altruisme. Elle le fut pour lui. Cependant, en contre-partie, il aimait bien mener ses affaires à sa manière; il a exigé très tôt qu’on le laisse en paix, qu’on respecte son jardin secret.
Une famille nombreuse qui ne roulait pas sur l’or, mais qui, en apparence, se débrouillait mieux que bien d’autres dans pareille situation. Charles se souvient de leur maison de Mascouche, des meubles de style Louis XV, des lustres de cristal. Il admet qu’une certaine opulence dans son passé a pu avoir une influence sur son goût des belles choses, aujourd’hui.
Être aimé, voilà la quête de tout être humain, d’un enfant en particulier. Charles se sentait-il aimé? Inconsciemment, comme tous les enfants, il croyait l’être. L’enfant ne connaît que ce qu’il reçoit. Pour cet enfant sensible à l’extrême, à l’affût des signaux de tendresse, il aurait fallu que l’amour parental soit mieux exprimé, sans condition, et toujours présent.
Il n’était qu’un être de plus à se contenter d’une affection coupée en dix parts égales.
Sa mère était surchargée. Son père se concentrait sur tout ce qui pouvait rapporter plus d’argent à la famille. Il y a eu la mécanique en premier lieu, mais aussi la rénovation de maisons et, au fil des années, un tas d’autres métiers rentables.
Orgueilleux et fier, le petit Charles n’était pas du genre à fréquenter l’école avec des pantalons trop courts, un veston étriqué, une chemise au col élimé! Ce n’est pas qu’il était vaniteux à outrance, mais il avait aussi conscience d’une forme d’esthétisme.
L’école ne réussissait pas à le motiver suffisamment pour qu’il y trouve une échappatoire. À la maison, ses parents n’avaient pas le regard de ceux d’aujourd’hui, obsédés par la performance et la réussite. « J’étais doué en mathématiques et je possédais une très bonne mémoire. Mais je m’entêtais à refuser d’étudier certaines matières que je n’aimais pas ou que je jugeais mal enseignées. »
C’était le cas notamment des arts plastiques. Jouer avec de la pâte à modeler durant tout un cours le déprimait. « Ce n’était pas assez profond, ni assez intéressant, trop ludique et enfantin. » Il avait le sentiment de perdre son temps, ce qui a fait fondre au départ l’enthousiasme et l’a entraîné dans d’irrésistibles rêveries.
Sa dissidence était symptomatique d’un système qui mettait tous les enfants dans un moule, sans égard pour leur rythme personnel d’apprentissage ou leur personnalité.
« J’aimais l’école pourtant », confie-t-il avec un fond de regret, car, si on réussissait à capter son attention, il était heureux.
Il l’a quittée trop tôt sans réfléchir, sans en mesurer les conséquences. Sans prévoir qu’il allait le regretter plus tard. Sa curiosité, sa capacité d’apprendre toutefois sont restées intactes. Son abandon fut malheureusement le geste le plus flamboyant de sa délinquance, alors qu’il était persuadé que sa présence à l’école n’était pas le meilleur moyen d’atteindre l’indépendance à laquelle il rêvait si fort.
Pourquoi s’est-il braqué contre le seul élément qui pouvait vraiment l’aider à s’évader, ou tout au moins à mieux s’y préparer? Forte personnalité, caractère opiniâtre, voire buté, l’enfant s’est placé involontairement dans une zone de fragilité. À l’école comme à la maison, il était difficile sans doute pour les adultes en autorité de résister à sa volonté farouche.
Son imagination était à la fois sa richesse et sa pire ennemie. Il pressentait un ailleurs, plus haut, plus loin; un destin unique à vivre, d’autres univers à découvrir, avec une urgence déraisonnable.
Dans sa tête, il créait sa vie, et non pas celle que lui imposait l’autorité, refusant la route tracée d’avance, préférant cent fois l’inconnu.
Les enfants d’aujourd’hui sont pris en charge par le système scolaire ou médical au premier dérapage. En principe, Charles, avec son bagage intellectuel, aurait été encouragé à tenir bon pour entrer bien armé dans ce siècle de technologies. Personne ne remarquait que cet enfant n’avait besoin que de soutien et de conseils.
Rétrospectivement, il se voit comme un garçon qui projetait une image de parfait contrôle de lui-même, mais qui crânait. Un peu amer à l’évocation de cette période de son enfance, et même plus tard dans sa vie, il fait ce triste constat : « Quand j’y pense, ce sont des étrangers qui m’ont encouragé le plus au cours de ma vie, sans jamais rien demander en retour. »
Ni la maison ni l’école ne pourront lui faire vivre des expériences enrichissantes, suffisamment fortes pour alimenter la lumière vive de son intelligence. Il lui a fallu très tôt trouver en lui d’autres ressources.
Il possédait incontestablement une personnalité bouillonnante, imaginative, inventive. Plus futé que bien des enfants de son âge, il jouissait d’une curiosité naturelle qui l’entraînait à vouloir expli-quer les choses, plus loin que le « comment ça marche ». Il trouvait par lui-même, à force d’obstination, des réponses à beaucoup de questions. Pas forcément toujours les meilleures réponses. Et non plus, pas forcément toujours dans son intérêt.
Il ne faisait qu’à sa tête; son comportement marginal, indépendant, rebutait l’autorité. Insoumission, obstination, tout était bon pour ne pas entrer dans le rang. Souvenir douloureux d’un enfant différent des autres, qui n’arrivait pas à bien se défendre alors qu’il se plaçait en porte-à-faux.
Les religieux enseignants au Manoir Saint-Henri-de-Mascouche dispensaient pourtant un enseignement de haut niveau dont il aurait grandement bénéficié s’il avait pu accepter quelques règlements! Les pédagogues devaient bien se rendre compte que tous les enfants ne sont pas issus du même moule. Dans toutes les générations, il est des enfants qui poussent leur intelligence et leur capacité critique jusqu’au point où l’enseignant doit retrouver la part en lui de modestie et d’émerveillement, et surtout ne pas hésiter à remettre en question sa manière d’enseigner.
Pourquoi Charles ne voulait-il pas apprendre la flûte à bec? « Je détestais cet instrument », dit-il. Il y avait là un beau défi pour le professeur de musique.
Il n’a jamais été un grand sportif, ni dans sa tendre enfance ni plus tard. En refusant de jouer au hockey, en ne devenant pas le Maurice Richard que son professeur voyait en lui, il lui fallait du courage pour se soustraire à cette volonté! Avait-on jamais remarqué qu’il portait des patins trop petits, que ses pauvres pieds étaient gelés? Lorsque l’on scandait dans les gradins : « Vas-y, Charles! Vas-y, Charles », il ne s’agissait pas de lui, mais d’un autre Charles.
Alors, au gymnase, puni, mis à l’écart, il dessinait et lisait! La société n’est pas tendre pour les « différents ». Marginal et solitaire, il le sera toute sa vie. Avec toutefois de grands efforts de compromis plus tard.
Il aimait bien être seul, sans jamais être lymphatique. Au contraire. Il s’est créé des occupations, seul ou avec d’autres. « Qui m’aime me suive... » La réflexion d’abord, mais l’action doit suivre inévitablement. Il le sentait, elle servirait le mieux son désir d’évasion et serait un levier pour son indépendance. En bande, le combatif a eu cet instinct du jeune animal à la fois prudent et audacieux.
Il collectionnait toutes sortes d’objets : des monnaies d’ici et étrangères qui sonnaient dans sa main comme des promesses de richesses; des timbres venus de si loin que l’exotisme des dessins le faisait rêver; des objets divers, sons et odeurs confondus.
Ainsi, il devenait riche. Riche de trésors qui lui appartenaient en propre et l’amenaient à voyager mentalement : à faire le tour du monde. Dans le temps et dans l’Histoire. Tout était enfermé dans de jolies boîtes. Il était propriétaire d’un royaume dont il avait seul la clef.
Une grande idée d’aventure se frayait un chemin :
– J’ai pensé devenir archéologue, découvrir des témoins fabuleux du passé, apprendre à les nommer, connaître celui ou celle qui avait fait l’objet, pour quel usage, en quelles circonstances.
C’était un peu l’objectif de rassembler une collection. Elle lui permettait d’explorer des univers savants; il en savait plus que les autres, se constituant ainsi une culture d’autodidacte. Et il voulait prouver qu’on peut avoir de la valeur sans obligatoirement sécher sur les bancs d’école. L’orgueil ou une sorte de foi absolue en l’avenir le menaient par le bout du nez et lui faisaient emprunter les chemins les plus ardus. Mais combien riches d’explorations et d’imprévus!
On le sait, la vie est rarement « un long fleuve tranquille ». Les changements de domiciles de la famille ont été nombreux. Chaque fois, il fallait se déraciner, perdre sa rue, la porte d’à côté, la familiarité des lieux, les amis.
Comme pour beaucoup de Montréalais et de banlieusards, l’arrivée du printemps devenait synonyme de la chasse à la maison plus belle, plus grande, moins chère. L’encombrement des rues avec camions, camionnettes, voiturettes était à son paroxysme à la fin du mois de mai. Les écoliers perdaient ainsi le dernier mois de fréquentation de l’école de leur quartier et étaient inscrits dans une autre pour un mois seulement. Cette absurdité administrative a été corrigée depuis. La date butoir des déménagements est désormais fixée au 1er juillet.
Le grand « dérangement » se justifiait, pour la majorité des ménages, par l’augmentation des membres de la famille. Ou par la cupidité d’un propriétaire qui exigeait une trop forte augmentation de loyer.
Ces multiples déplacements même s’ils avaient lieu quelquefois dans le même quartier déstabilisaient l’enfant. Cela a compromis la création d’amitiés solides, durables, qui auraient pu lui apporter un sens d’appartenance à un milieu de vie. Il en a souffert. Il aimerait aujourd’hui pouvoir compter sur l’affection et la solidarité d’une véritable bande de camarades. Les nommer. Un ou deux amis qui auraient traversé avec lui la route de l’enfance. Cette errance a créé un trou affectif dans sa mémoire.
Au sein de cette communauté familiale, chacun partageait l’espace commun, ce qui n’était pas automatiquement un malheur en soi. La promiscuité quotidienne d’une bande considérable de frères à laquelle s’ajoutait une sœur, leur énergie débordante, leurs petites mesquineries étaient une réalité animée et bruyante prompte à prendre toute la place.
Chose curieuse, la famille a toujours habité à proximité d’un cours d’eau, soit un lac, soit une rivière. On comprend mieux pourquoi le peintre a cherché toute sa vie à recréer ce décor.
De temps en temps, en accord avec son tempérament, il trouvait le bonheur sur cette rivière sous le prétexte d’aller pêcher; ou dans les bois environnants à tenter de reconnaître le chant des oiseaux. Parfois même, on le retrouvait à l’église paroissiale, aux heures de grand silence.
Le Charles d’aujourd’hui loge la vision idéale de sa famille alors qu’il était enfant dans une bulle à part de son cerveau. Qu’a-t-il conservé de sa jeunesse? Quelles sont les maisons où il a été le plus heureux? A-t-il gardé le souvenir de rires ou de bousculades fraternelles qui pourraient encore l’émouvoir? C’est flou.
On le surprend aujourd’hui à reconnaître la densité des nuages qui passent encore au-dessus de sa tête quand il évoque le passé; on le surprend à souffler très fort pour les chasser.
Il ne permettrait pas à la tristesse, à l’injustice, de diriger sa vie. Dans l’enfance, il savait les reconnaître, les nommer, mais ne pouvait y échapper. Comme bien des artistes, comme tous les rêveurs, comme chaque idéaliste, il est clair que Carson a voulu le plus tôt possible redessiner sa vie, ajouter sur la grisaille une palette de couleurs vives. La recréer.
Sa famille, comme pour tous les enfants du monde, était son univers. Jusqu’à l’adolescence, il en était solidaire et lui portait un amour sans réserve, quelquefois douloureux. Il en a suivi les règles même arbitraires, et partagé avec elle les joies, les chagrins et les drames.
C’est un bien précieux qu’il conserve dans un repli de son cœur en sublimant, en transcendant, même si les liens sont coupés pour des raisons obscures, indépendantes de sa volonté. « Cette page est tournée depuis longtemps. Je n’espère plus rien. Même si on pouvait remettre le film à l’endroit, je ne changerais pas d’idée. C’est parfois difficile de faire machine arrière, dans certaines circonstances. De plus, il faudrait changer la distribution des rôles et l’auteur de la pièce », dit-il avec un sourire empreint de tristesse.
Quel était son destin à quinze ans? Il lui fallait suivre les règles, tristes ou joyeuses, mais imposées. Plus prosaïquement, on lui a demandé de contribuer aux dépenses de la famille, d’aller travailler. C’était, d’une certaine manière, plus important que de fréquenter l’école. En tout cas, aussi important que de perdre son temps sur un canot au milieu d’une rivière; ou de faire le fanfaron en prétendant tout connaître.
Il raconte qu’à cet âge il quittait la maison de Mascouche en banlieue de Montréal, tôt le matin, faisant de l’auto-stop, à la merci du premier automobiliste qui voulait bien le faire monter. Il se dirigeait vers le parc industriel de Ville d’Anjou occuper un poste chez un manufacturier de meubles qui engageait à l’époque un millier de travailleurs spécialisés.
Environ un an plus tard, il s’est un jour braqué contre un ordre de son supérieur qui voulait lui faire exécuter des tâches pour lesquelles il n’avait pas été engagé, qui le rétrogradaient.
Têtu, décidé à ne pas se laisser abattre, il a décroché un emploi de l’autre côté de la rue. Chez ArtCraft, au début, il s’initie à toutes les étapes du travail de l’entreprise : assemblage, montage, emballage et expédition de lustres de bronze, de candélabres chargés de cristal destinés aux hôtels et résidences huppées. En moins de deux mois, le patron reconnaît ses qualités d’organisation et de leadership et lui confie la gérance d’un groupe d’une vingtaine de travailleurs, alors qu’il n’est lui-même qu’un adolescent.
Le vendredi venu, traditionnellement jour de paye, il devait remettre la presque totalité de son salaire à son père. Il ne conservait que quelques dollars qu’il arrivait tant bien que mal à mettre de côté.
Pour arrondir son pécule, il a tiré avantage de son expérience de meneur d’hommes chez ArtCraft, en mettant sur pied des équipes de jeunes qui livraient des journaux, taillaient des pelouses, déneigeaient les entrées de maison. Durant la saison des braderies ou des ventes-débarras, il se transformait en chasseur d’objets rares et précieux, vaquait à ses occupations en trônant sur sa mobylette.
Cette part officieuse de ses revenus était soigneusement camouflée. Ce qui lui a permis, deux ans plus tard, de s’offrir une somptueuse embarcation à moteur et, en prime, une auto.
L’argent, il le comprenait depuis longtemps, devenait la clef précieuse de son autonomie.
L’un de ses grands rêves était de pouvoir un jour se procurer un voilier et de naviguer en mer à la recherche de ces lointaines îles bienheureuses dont il avait vu des images dans l’encyclopédie de la bibliothèque familiale.
Il n’a pas pu réaliser ce rêve un peu fou, mais son fils Stéphane, grand lecteur de Jules Verne durant son enfance, l’a réalisé à sa place par une sorte d’osmose. Le jeune marin de 28 ans vogue depuis plusieurs années déjà, le plus souvent en solitaire, toutes voiles déployées sur les mers du monde. Rien ne semblait avoir préparé à ce destin le jeune programmeur analyste. C’est au cours d’un voyage en France comme étudiant stagiaire qu’un futur patron l’a invité à bord de son voilier pour faire plus ample connaissance. Stéphane a découvert dans un éblouissement la mer et la voile, et a décidé que c’était cette vie-là qu’il voulait mener. Il a quitté un emploi prometteur et rémunérateur pour s’initier au métier de marin et enfin prendre le large. Voilà des qualités que son père admire et qui l’émeuvent : débrouillardise, audace, initiative.
Mais un fils aussi semblable, aussi aimé et qui mène une vie d’aventures inquiète le père après quelques semaines de silence, lorsque les appels ne rentrent pas, que leurs rendez-vous sont manqués. Le regard tendu du père évoque la furie des eaux qu’il craint par-dessus tout. Pour calmer une part de son anxiété, il a doté le voilier de Stéphane de la plus récente version d’un système GPS (Balise d’urgence par satellite).
Charles éprouve face à l’eau en général un sentiment parfois contradictoire. Voici un souvenir d’enfance terrifiant : l’un de ses frères l’a jeté brutalement dans la section profonde de la piscine familiale pour le forcer à nager. Des adultes l’ont rescapé in extremis.
Il a connu, une première fois lors d’un voyage de pêche en haute mer en République dominicaine, et une seconde fois à La Havane à Cuba, la colère d’une mer déchaînée.
Et que dire de l’accident de plongée qui a failli lui coûter la vie? Cette mésaventure sera racontée plus avant dans ce récit.
Malgré une certaine appréhension de son caractère violent, son attachement à la mer reste entier et admiratif. On peut en juger par la manière dont il en parle, mais surtout par la beauté troublante des nombreux tableaux qu’il a peints de fonds marins éblouissants, enchanteurs et énigmatiques.
Si la vie lui paraît monotone, si elle s’essouffle au quotidien, Charles rêve à la mer et imagine sans peine un prochain départ vers un ailleurs qui devrait le ressourcer. Cette passion des voyages date de ses jeunes années. Ne dit-on pas qu’ils « forment la jeunesse »?
Le tout premier voyage de Charles alors qu’il n’avait que seize ans a été aussi éloigné qu’il pouvait l’être de la carte postale ou d’une aventure idyllique.
Des voisins partaient pour la Floride en roulotte avec leurs enfants. Charles avait quelques économies, ils ont donc consenti à l’emmener avec eux moyennant la somme de 1000 $! Au début des années 1970, cela représentait un joli montant!
Hélas, à Jacksonville, une surprise désagréable l’attendait.
Il raconte : « Non contents de m’avoir fait payer le gros prix, ils voulaient en plus que je sois le gardien de leurs enfants, pendant qu’eux allaient se promener. Je me suis révolté, j’ai refusé. Pour me punir, ils m’ont abandonné sur le terrain de camping de Jacksonville, sans tente, en promettant de me reprendre au retour. J’ai dormi sur la plage, dix jours tout seul pendant la période des Fêtes, et sans connaître l’anglais. »
En désespoir de cause, il a téléphoné à son père.
– C’est un interurbain, mon gars, lui a fait remarquer ce dernier, en colère.
Et il a ajouté :
– T’as voulu y aller, maintenant, débrouille-toi.
Ce n’était pas la première fois qu’il vivait une mésaventure de ce genre. On peut même s’étonner aujourd’hui qu’il aime tant les voyages!
À la fin d’une journée passée à Old Orchard, célèbre plage du Maine aux États-Unis, plusieurs années plus tôt, il devait avoir huit ans, tout le clan s’était entassé dans la longue voiture familiale pour revenir à Montréal en fin d’après-midi.
Ce n’est qu’au moment du repas du soir que les parents ont réalisé que Charles n’était pas avec eux, à la maison! Se pouvait-il qu’ils l’aient oublié là-bas? Aucun membre de la famille, ni les parents ni les frères, n’avait remarqué son absence.
Un policier américain s’est occupé de Charles durant toutes les heures précédant l’arrivée du père. « Ce policier m’a offert, raconte-t-il, joyeux, comme s’il s’agissait d’une bonne blague, un nombre incalculable de cornets de crème glacée. »
Lorsque son père est arrivé à la nuit tombée, Charles était à la fois soulagé et heureux. Mais le souvenir en est terni : « Ce fut un retour à la maison chargé de lourds silences », relate-t-il.
On éduque les garçons pour qu’ils soient de vrais hommes, sans ménagement, sans effusions, voire sans indulgence. Ils doivent se débrouiller, s’aguerrir pour la vie qui les attend et qui ne leur fera pas de quartier.
Qui en souffrait le plus? Les garçons sensibles comme lui, fragiles, boulimiques d’accolades, de mots consolateurs et tendres.
Il aurait souhaité que la vie familiale un peu dure parfois, s’arrête sur le pas de la porte, ne franchisse pas la demeure; que l’indifférence cède la place à un attendrissement véritable devant les efforts qu’il déployait pour plaire.
Il rêvait, surtout au fil du temps, que ses parents se réjouissent sans arrière-pensée des efforts et des succès de leur fils. Ces derniers n’ont pas compris ce besoin, ni combien il est toujours aussi important à ses yeux.
Dans une ultime tentative d’explication et de rapprochement, Charles a écrit ce message à sa mère, qu’il a expédié comme une bouteille à la mer. « […] L’amour d’une mère est irremplaçable, écrit-il en préambule. Parfois, on a le sentiment d’un manque dans notre vie et, malgré tous mes efforts, j’ai compris que cela restera à jamais et tristement un grand vide que je ne pourrai jamais combler… »
Sa missive est restée sans réponse…
Balzac écrivait : « J’ai usé mes facultés à l’œuvre désespérante de l’attente… Cette longue attente du cœur, du bonheur, d’une vie rêvée m’a plus détruit que je ne le croyais. Aussi n’y a-t-il qu’un mot pour rendre ma situation : je me consume… »
Charles s’est donc senti incompris. Il le déclare sans ambages aujourd’hui comme si cet aveu pouvait ramener une quelconque paix en lui. L’adolescence se traduira par une véritable rébellion.
Les années ont passé avec la même quête inconsciente : un revirement de situation. Espérer qu’un jour il retrouverait des bras tendus vers lui et l’amour perdu.
À l’aube de sa vie adulte, la poésie de l’enfance, l’idéalisme adolescent ont subi un dur coup. C’est comme si un loup avait rôdé dans la bergerie. Les garçons, ses frères, se transformaient eux aussi, réagissaient face à la vie avec des dents acérées; le clan qui semblait uni, indéfectible, s’est lézardé.
Ils étaient si différents les uns des autres et pourtant armés de la même manière, c’est-à-dire un couteau entre les dents. Prêts à affronter l’avenir avec un féroce désir de vaincre.
Ils se sont distanciés peu à peu du frère du milieu, pour se créer des alliances entre eux, entre ceux qui se ressemblent. Ils se sont engagés sur des routes parallèles, parfois cahoteuses. À chacun son destin! Charles poursuit le sien, un chagrin en bandoulière. Ce n’est pas facile de traîner ce lourd bagage d’amour contrarié.
À quel moment Charles adolescent s’est-il rendu compte du précipice qui s’ouvrait sous ses pas? Du fossé qui se créait irrémédiablement entre sa famille et lui?
La fin de l’adolescence a créé la déchirure. Il n’était pas question de s’enfoncer dans la glaise d’un avenir sans couleurs. Lucide et audacieux, un peu fou sans doute, il a senti le besoin irrépressible d’entrer de plain-pied dans une autre vie. Ce fut « l’éloge de la fuite » avant l’heure. Abruptement.
Sorti de sa résignation respectueuse, il a dit :
– Il est temps que je parte.
On lui répondait :
– As-tu pensé à ce qui t’attend?
Il est allé jusqu’à donner forme à ce désir, malgré les mises en garde.
Que cherchait-il à fuir? Ou plutôt que voulait-il trouver dans un ailleurs inconnu, cette existence d’adulte libre?
Oui. Qu’est-ce qu’il voulait, au fond? Un endroit où il aurait eu l’impression d’être au paradis.
Ce paradis s’est incarné sous la forme d’une adolescente de 14 ans, son premier amour, rencontrée sur les lieux de son travail. Il en avait tout juste 17.
Il suspectait d’une certaine manière le danger d’aller trop loin dans cette relation, conscient de sa jeunesse, mais tenté par la séduction et l’éveil des sens.
Le courant les a emportés. La timidité du jeune homme a été bien vite confondue dans les bras d’une fille délurée. Et ce sont les premiers mois de fréquentations d’un pur délice qui leur ont fait tourner la tête!
Il y a mis des formes. Le jeune homme sentimental alimentait sa rêverie face à une jeune fille dont la beauté un peu clinquante le bouleversait. Un agréable visage, un regard clair flattaient sa fierté de jeune mâle. Ce sera, croyait-il, l’amour éternel. Il devait démontrer à tout le monde sa maturité et son sens des responsabilités.
Le jour où la jeune fille s’est fait congédier par leur commun employeur pour « manque de sérieux », l’amoureux n’a pas hésité une seconde. Solidaire, noble chevalier, il a plaidé pour elle et a finalement servi au patron cet ultimatum :
« Si elle part, je pars avec elle. »
Le voilà devenu un véritable héros romantique. Il est sans le moindre doute un grand amoureux et suit aveuglément les élans de son cœur.
Indépendance, le beau mot! Une idée si belle et qui prend toute la place dans un jeune esprit impatient. Charles ne demande qu’à aller au devant de la vie, celle où il pourra s’épanouir.
Si le prix à payer pour son émancipation et celle de sa fiancée est que cette liberté se prenne en couple marié, eh bien! c’est ce qu’il fera.
Le mariage a été célébré à l’église Saint-Henri-de-Mascouche à l’été 1976. La jeune femme attend son premier enfant. Charles a maintenant 19 ans.
Il croit au mariage, à l’union durable; il est convain-cu qu’il peut vaincre tous les obstacles grâce à l’amour. Il a de l’institution du mariage une vision ultraconservatrice. Ce sont des principes auxquels il croit, dans lesquels il a baigné. Ses premiers modèles sont ses parents.
De cette union qui a duré quinze ans, sont nés deux fils : Éric et Stéphane.
Les premières années de leur union n’ont pas ménagé les difficultés ni à l’un ni à l’autre. Inexpérimentés, ils ont abordé la vie à deux avec toute la candeur de leur jeunesse. Ce n’est que plus tard que Charles saisira l’ampleur des combats pour leur survie. Et combien de solitude, de tristesse et de démons il a dû affronter certains jours dans l’implacable jungle humaine, quand il n’était qu’un adolescent, qu’il avait, encore tapis au fond de lui, ses peurs et ses doutes.
Les années se sont succédé en colmatant les brèches.
Par pudeur, il ne raconte pas tout. Il garde le silence sur les épisodes trop douloureux, dont certains ont laissé des cicatrices. Qu’il ait survécu à tout ce qui n’est pas raconté volontairement, c’est reconnaître son esprit de battant, son goût de la vie. À certaines époques, il pouvait mal tourner, mais c’est méconnaître son esprit farouchement indépendant qui n’accepte pas de dépendance, quelle qu’elle soit. Cent fois, bien sûr, la corde tendue s’est relâchée. Il a su tenir à distance les tentations de paradis artificiels et a pu maintenir le contrôle de sa vie ainsi que l’intégrité de son esprit créatif.
Mais il est alors légitime de se poser la question. Comment l’artiste Carson a-t-il pu naître dans ce brouillamini, cet amoncellement de contraintes quotidiennes et domestiques?
Comment la force de créer a-t-elle pu se tracer une voie en lui, s’imposer, apporter de la lumière dans sa vie?
Carson est devenu à son corps défendant un personnage dont la vie mouvementée a connu un tas de rebondissements. Sa destinée semblait inscrite au plus profond de lui-même, enchevêtrée, parfois désordonnée; mais toujours – et c’est là le miracle – rafistolée, remise sur la bonne voie. Il aurait pu devenir amer, pour ne pas dire acariâtre, se plaindre de tout et perdre en route la richesse de sa pensée imaginative.
Emporté malgré lui par la force du courant plus souvent qu’à son tour, blessé, meurtri, il a conservé envers et contre tout une formidable envie de vivre. Jamais vaincu. Se hissant sur le rivage avec toute l’énergie du désespoir. Tous ceux qui l’ont connu autrefois, qui le fréquentent aujourd’hui, reconnaissent et admirent chez lui cette faculté de rebondir. Jamais vaincu.
C’est à se demander si chez lui les épreuves n’ont pas été le canevas d’un inépuisable imaginaire? D’un espace intime où il a pu se réfugier quand tout sombrait et qui est devenu, avec le temps, lumineux.
|
|
Picasso affirmait qu’il y a un artiste dans chaque enfant. « Le problème, disait-il, est de savoir comment rester un enfant en grandissant. »
Laisser vivre l’enfant en soi est un talent; le laisser délirer, rêver tient du courage.
Dans un certain sens, Charles Carson a réussi à conserver intacts son émerveillement, la faculté de faire jaillir la lumière de l’ombre, comme si chaque tableau était un hymne à la joie.
Comme tous les enfants, bien avant l’école primaire, il a dessiné, « barbouillé », tenté de donner forme à son univers familier.
Il ne disait pas : « je veux devenir peintre. » Et personne ne lui avait encore dit évidemment : « tu as du talent. » Les enfants ont un talent spontané qui semble venir tout droit d’une vie antérieure. Leurs premiers dessins maladroits lèvent souvent le voile sur des mondes poétiques quelquefois tristes, en général heureux, dont la résonance nous attendrit et nous étonne.
Le talent en lui, mais que veut dire talent? est resté embryonnaire jusqu’à l’adolescence. Il ne ressentait pas « l’appel » impérieux de la création qui viendra le harceler plus tard.
Mises à part des habiletés manuelles incontestables dont il faisait preuve en vieillissant, pour monter et démonter n’importe quel appareil ou mécanisme, une mémoire des concepts les plus compliqués, l’excitation d’une nouvelle idée, d’un nouveau défi, rien n’était défini, ni clair sur ce qu’il voulait vraiment devenir ou accomplir.
Quel métier? Quelle profession? Qu’allait-il choisir de faire dans sa vie?
Il a découvert de façon fortuite ses habiletés pour le dessin en peignant à 16 ans un portrait fidèle d’Elvis Presley qui était sans doute la plus grande vedette de l’heure.
Le portrait était si troublant de vérité qu’un fan du chanteur américain n’a pas hésité à lui en offrir 400,00 $!
Succès éclatant, inattendu, mais qui provoque des remous autour de lui. En lui aussi, dans sa propre tête qui bourdonne tout à coup d’une activité nouvelle, imprévue. Personne n’avait vu venir le coup! Encore moins dans sa famille.
Il est très fier! Joli coup d’argent certes. Mais il découvre, surtout pour la première fois, le sentiment heureux et exaltant d’émerger, d’être un « artiste ».
C’est relativement facile d’imiter en peinture la photographie d’une idole. C’est relativement facile d’exécuter, si on a quelques notions, un tableau assez bien fait. Dessiner et reproduire une œuvre exigent toutefois une bonne technique de dessin, et, si la reproduction nous émeut, voilà qu’intervient le talent.
On le regardait soudain différemment, avec envie peut-être. Voilà une question qui titillait également l’artiste en devenir. Pour y répondre, il s’est attelé à la tâche de travailler à dessiner de plus en plus, de tenter de découvrir les secrets des grands maîtres de la peinture. Il s’est penché sur les reproductions comme un sage écolier, a étudié attentivement les traits de pinceaux, l’application des couleurs, leurs subtilités; il a découvert la force des jeux d’ombre et de lumière. Ce fut une immersion totale dans l’Art, une exploration qui l’a mené à se découvrir lui-même. Au cours des années, il va collectionner un nombre impressionnant de livres d’art. « J’en ai possédé des milliers! » Il regrette d’avoir dû s’en défaire lorsqu’il a décidé de s’installer en Colombie.
Le jeune artiste qui apprend facilement retient tout. Il décide de travailler d’arrache-pied.
« Le travail est la loi de l’art et de la vie », selon l’un des principes inexorables de La Comédie humaine de Balzac.
Afin de tester ses capacités, d’évaluer ses limites, il a reproduit des tableaux célèbres cent fois plutôt qu’une. Il a peint La Joconde si souvent qu’il en est arrivé à reconnaître Leonardo da Vinci sous les traits de la jeune femme énigmatique. Un auto-portrait. « Je crois que cet immense génie s’est travesti pour nous confondre durant des siècles. Pourquoi pas? » suggère-t-il admiratif.
Sans maître véritable, dans quel ordre pouvait-il affronter la nouvelle discipline que lui imposait la découverte fortuite de son talent? Comment toucher au cœur et traverser le Temps? Comment plus simplement incarner sur la toile vierge ce qu’il porte en lui?
Ces choses à dire qui témoignent de la beauté fragile du monde, quel serait le langage, « son » langage qui pourrait être à la fois évocateur et subliminal?
Le jeune Charles a encore beaucoup à apprendre avant de s’exprimer. « Le dessin n’est pas la forme, il est la manière de voir la forme », disait Edgar Degas.
Les quelques rares dessins de cette époque qui ont résisté au temps, alors que l’artiste était au tout début de la vingtaine, nous entraînent dans des sous-bois où l’ombre et la lumière se côtoient avec aisance; près des ruisseaux tumultueux qui serpentent, des haies triomphales de peupliers. La manière est académique, loin encore de sa liberté actuelle.
Il cherchait à reproduire ce qu’il avait sous les yeux, couleurs et formes, comme un peintre du dimanche installé sagement au centre du paysage. On l’imagine aisément l’œil rivé à sa fenêtre, ou le chevalet planté dans le champ, occupé à débusquer les tons fondants de l’automne, les éclats du soleil mourant entre les feuilles des arbres.
Un peu comme chez les impressionnistes, sa palette devait regorger de couleurs répandues directement du tube. Et c’était déjà là, dans ces premiers balbutiements, la découverte d’un plaisir total.
Le jeune artiste sentait confusément qu’au-delà de ce sous-bois, en amont du ruisseau, il existait
d’autres choses. Non pas uniquement à photographier et à copier. Des choses plus importantes, plus graves à raconter.
L’incident du premier succès dû à Elvis Presley est clos pour l’instant. Charles doit désormais passer aux choses dites sérieuses, notamment installer leur appartement à l’Île-Saint-Jean.
La survie alimentaire quotidienne de sa jeune famille occupait toute la place. Lui qui rêvait d’autonomie et de liberté s’est vu bien vite ramené à la réalité. Les responsabilités étaient importantes pour un jeune homme sans carrière, sans métier véritable, qui ne devait compter que sur lui-même pour s’en sortir.
« Un jour j’ai frappé à la porte de ma voisine parce que ça faisait trois jours que je n’avais pas mangé. Le bébé ne manquait de rien, on lui avait même préparé une très jolie chambre. »
Le couple était, lui, privé de ses rêves de belle vie! « C’en était fini du bateau, de l’auto, de la motoneige… », se rappelle Charles. Adieu la lune de miel et le romantisme des premières étreintes.
Sa fierté est mise à dure épreuve. Il doit trouver une solution. Selon les valeurs de l’époque, c’est à lui de faire en sorte que la famille s’échappe de ce bourbier.
Heureusement, son imagination est étonnante et va le servir avec bonheur. Il fait de tout avec rien, récupère, recycle, restaure, pour ne pas dire, réinvente. « On avait trois chaises de métal. Avec un rouleau de fil électrique monté sur bobine en bois, j’ai fabriqué une table. Je la revois encore toute capitonnée, en cuir, de style anglais! De toute beauté! Quelle harmonie! », conclut-il, ironique.
Il n’a ménagé aucun effort comme concierge pour satisfaire son employeur, y compris pour exécuter les tâches les plus sordides. Le souvenir est violent : « Je pelletais d’un côté, je vomissais de l’autre pour venir à bout d’une canalisation d’égout bouchée », se souvient-il avec horreur.
Dans la même période, à l’aube, il exécutait un aller-retour d’une heure et demie en auto-stop pour nettoyer à la serpillière les planchers d’un centre commercial. Il en revenait les mains couvertes d’ampoules.
Mille et un métiers. Mille et une misères. C’est le sort d’un homme qui n’a pas complété d’études supérieures et dont les journées passent à satisfaire les premières nécessités et à laisser le rêve endormi.
Qu’en est-il des activités artistiques? Fort de l’énergie de sa jeunesse, il réussit à maintenir vive la flamme de sa passion. En 1978, malgré tout, le rêveur entêté réalise sa première exposition de gravures sur verre avec juxtaposition de couleurs, à la Galerie Verte, à Rosemère. On était encore loin de la notoriété internationale! L’artiste devait continuer de chercher du travail pour assurer la subsistance de la famille.
Il n’avait peur de rien; lorsqu’il s’agissait de gagner sa vie, l’audace était sa première qualité. Il s’est retrouvé notamment au volant d’un camion de déneigement de la Ville de Montréal. Or, il ne connaissait pas la conduite manuelle! Il avait répété les gestes de changement de vitesse la nuit précédente.
Le restaurant italien de son voisinage cherchait un cuisinier? Bien. Il s’est présenté comme l’expert qui ferait le meilleur travail. La fabrication des pizzas n’avait pas de secrets pour lui, déclarait-il à qui voulait l’entendre. Le résultat de sa fanfaronnade? « Je réussissais deux pizzas “jumbos” que je faisais tourner en même temps au-dessus de ma tête, une dans chaque main. La foule s’installait devant moi pour voir le spectacle. Personne ne se doutait, pas même le patron, que je n’avais aucune expérience et que les recettes, je les inventais. » Des recettes qui ont fait école si on en juge par la description qu’il en fait : pizza pochette, pizza avec bœuf haché, laitue, bref tout ce qui n’était pas encore à la mode. Son imagination ne connaissait pas de limites.
Ce fameux jour où les pizzas se sont transformées en soucoupes volantes et où la sauce tomate a atterri sur l’auditoire le fait encore beaucoup rire!
Puis un deuxième enfant s’est ajouté à la famille. À force de volonté et de travail, leur situation économique s’améliore. Après de nombreux déménagements, le couple se fixe finalement à Charny où Charles pratique le commerce d’antiquités, tout en continuant de peindre, de travailler en atelier.
L’année 1983 marque le retour de la petite famille dans les banlieues de son enfance : Repentigny, Blainville et puis Sainte-Thérèse. Ce sont des retrouvailles en quelque sorte d’une partie de son passé, et, dans ce décor familier, il croit être mieux armé pour colmater les brèches dans sa vie amoureuse.
En 1988, la famille aménage dans un secteur huppé de la banlieue montréalaise, à Sainte-Thérèse-en-Haut, dans une luxueuse maison « canadienne ».
Durant les années qui suivent, Charles maintient le tempo. Sa vie quotidienne explose d’idées. Il présente à nouveau des œuvres de verre abstraites et figuratives, à la Galerie Renoir.
Une période florissante financièrement. Les apparences sont trompeuses : dans ce décor de rêve, le couple, de plus en plus, va à vau-l’eau. Les tensions augmentent.
En même temps, le jeune artiste s’était engagé dans plusieurs voies, essayant de trouver dans l’action créatrice une sorte de consolation, voire une fuite. Toute cette activité alimentait son bagage technique. Sans nier les influences de son époque sur le plan pictural et plastique, il a proposé les résultats de ses trouvailles : outre la peinture sur verre, il explorait la peinture à l’envers, le verre juxtaposé sur toile, etc.
La vie poursuivant son cours apportait son lot de plaisirs aussi. Charles a concrétisé un vieux fantasme, celui de posséder une Rolls-Royce, le summum symbolique de la grande vie. « Cette vieille voiture d’occasion, à part le prestige de son nom, n’avait pourtant rien d’extravagant. Pour moi, c’était un jouet avant tout. » Il en soignait les accessoires, frottait affectueusement les chromes. Comme il avait tout appris des voitures et de leur entretien au garage familial, il connaissait sa vieille Rolls comme sa poche, de son moteur les moindres sursauts et ronronnements. Il aurait pu, à l’instar
du peintre Riopelle, grand collectionneur de voitures rares et anciennes, entretenir cette coûteuse passion. Mais il s’est montré raisonnable.
Le joujou était en évidence sur la rue. Charles ne pouvait s’imaginer un seul instant que la voiture laissait croire qu’il était riche et pouvait s’offrir tous ses caprices. « Ce fut un autre motif d’envie dans mon entourage », dit-il.
À force d’arpenter les marchés aux puces, les étalages des brocanteurs, il avait développé un œil d’expert véritable. Il achetait, en négociant ferme, des objets et meubles qu’il vendait à son tour, aux clients avisés. Il en tirait, grâce à son talent de vendeur, un bénéfice intéressant.
Plus importante que celle des objets domestiques, il s’était en même temps constitué une enviable collection d’œuvres d’art parmi lesquelles figuraient des Marc-Aurèle Fortin, Stanley Cosgrove, Léo Ayotte, René Richard, une murale de Paul (Tex) Lecor; des Borduas, Ferron, Bellefleur et Lemieux; une tapisserie de Picasso, et plusieurs autres. Un piano demi-queue de style Queen Anne dont les touches étaient du pur ivoire a longtemps trôné chez lui. Son fils Stéphane y exerçait ses dons naissants de musicien.
L’ébénisterie, le rembourrage, la restauration de
meubles et de tableaux anciens, la sculpture d’ornements sur les encadrements, la pose de feuilles d’or, la décoration intérieure de résidences huppées, voilà quel était le menu d’une partie de ses occupations. Avec son partenaire Michel De Leséluc, il a décoré la discothèque montréalaise : Les foufounes électriques, un lieu très branché de la vie nocturne, à cette époque.
Des salles de ventes aux enchères aux galeries d’art, il apprend tout par lui-même, en se renseignant auprès d’experts, bien sûr, pour ne pas commettre d’erreurs, se pose en spécialiste et s’attache une jolie clientèle. C’est ainsi qu’il va peaufiner une partie des talents qu’il porte en lui. Son principe est simple : « Si quelque chose a été fait par un humain, c’est que l’être humain est à même de le comprendre. Je peux donc le faire moi aussi. »
Parmi ses découvertes, prédomine le travail d’un certain artiste qui l’a toujours fasciné et à qui il porte une attention bienveillante et admirative. Il s’agit de l’œuvre peinte de Christo Stefanoff, logée dans la partie inférieure du Cyclorama de Jérusalem à Sainte-Anne-de-Beaupré.
« Stefanoff a tout au long de sa vie, (1898-1966), créé une œuvre conséquente, exceptionnelle et magistrale. Dessins d’apocalypse, de ghettos, d’amas de corps, de scènes de guerre. On ne peut pas rester indifférent face à ces chefs-d’œuvre d’un artiste pourtant méconnu. »
Il lui a rendu hommage en interprétant deux de ses œuvres à sa manière, c’est-à-dire à la manière carsoniste, dans la Trahison de Judas et La fin d’un cycle et la naissance du carsonisme.
Il lui faut l’action, mais aussi la contemplation indispensable au ressourcement de son imaginaire créatif des 30 dernières années. Depuis longtemps, il engrange des images, des sensations, une multitude de signaux.
« Mon plus grand bonheur était et est encore de m’asseoir devant un vieux mur en pierres, d’y découvrir des objets, des personnages, de me raconter des histoires. »
Il a confié cela un jour à l’historien d’art Guy Robert qui lui a rappelé que Léonard de Vinci faisait de même.
Les rochers, un simple caillou, une racine d’arbre, les arbres eux-mêmes dévoilent, à qui sait regarder, beaucoup d’éléments d’inspiration. Les pierres trouvées sur la plage, polies par le temps et la vague, sont des témoins d’une grande agitation sous-marine, inscrite dans leurs pores, et dont leurs strates gardent la mémoire. Les bois blanchis par le sel de la mer, le flux et le reflux de la vague offrent des formes douces, singulières. Qui sait s’ils ne sont pas issus du naufrage d’un navire de brigands?
« Le bon Dieu est un grand artiste! » s’exclame-t-il, ému.
Les murs en pierres des champs, couverts de vigne et de ronces, les plus délabrés même, sont émouvants quand on sait imaginer les mains pleines d’ampoules qui les ont assemblés patiemment. Il y a longtemps. Parfois de l’aube jusque tard dans la nuit.
Au cours de ses nombreux voyages en France, il a été plus attiré par ces témoins simples du passé que par n’importe quel autre élément. « Quelquefois, il apparaît plus profitable de suivre sur un mur le voyage d’une tache de soleil que d’écrire des lettres d’affaires… », confiait l’écrivain Julien Green, dans son Journal.
Carson a toujours admiré la vie simple des paysans, leurs vertus de patience et de résilience. Il mentionne les dessins fabuleux des grottes de Lascaux en Dordogne, qui datent de 15 000 ans av. J.-C. et fascinent le monde entier depuis leur découverte en 1940. Selon lui, les habitants de ces grottes ont été inspirés directement par les formes apparaissant sur les reliefs des murs.
« Ce que ces hommes ont vu dans la pierre leur a peut-être servi de canevas », suggère Carson. Le mur rappelait peut-être l’animal chassé.
Comme la nature éternellement vivante malgré ses périodes de dormance, il envie cette liberté, en ayant conscience qu’elle est programmée selon ses propres lois.
C’est ainsi qu’il imagine la forêt profonde, le fond des mers ou ses rives, les mouvements de vagues éternels et uniques. Rien ni personne ne peuvent intervenir dans l’ordre de ces choses-là, dans cette force inébranlable.
L’arbre, pour sa part, plonge ses racines profondément et ne quitte plus la terre qui le nourrit. Il prend la fuite par le réseau des branches et des feuilles, le plus haut, le plus loin possible.
Cette liberté idéale, faite de stabilité et de légèreté, est une conquête quotidienne pour l’artiste. C’est ainsi qu’il aimerait vivre.
Avec ses contradictions naturelles et l’impératif besoin de créer, de temps en temps, il faut bien le dire, il sacrifie tout cela, momentanément, au profit d’une femme, au nom d’un amour.
Il est clair que la routine, la quotidienneté, l’enfermement, fût-ce par amour, le prive de son oxygène. Mais, en même temps, il s’y complaît, il en a besoin.
Le grand Maître Deshimaru disait : « Il y a le grand ego, celui qui recherche liberté, sagesse, calme et silence et regarde l’autre, le petit ego de tous nos soucis. » Cette dualité, Charles Carson en est à la fois conscient et victime.
Pour s’adapter à la routine quotidienne, à ses contraintes, à ses joies aussi, admet-il, il lui a fallu revenir sur des pans de sa vie, leur trouver un sens. En d’autres mots, atteindre une espèce de maturité en mettant derrière lui ce qui a failli le détruire…
Sur ce passé où il a grand peine à revenir, des éclats de voix lui parviennent quelquefois, des images floues comme des photos pâlies dormant au fond d’un tiroir. Dans des moments de tristesse, Charles ouvre ce tiroir, il sait ce qu’il va y trouver; parmi les photographies, se trouve celle de l’un de ses frères, Marcel, le plus aimé. Alors Charles cherche quelque chose dans son visage, dans sa tenue, quelque chose qui aurait dû l’avertir du danger. Sa souffrance devant cette impossibilité de remonter le temps s’est assoupie, mais pas pour toujours.
Alors, il reste là à rêver devant ce portrait fané évoquant celui avec qui il pêchait, celui avec qui il se sentait bien. Ce frère portait en lui une forme d’exaltation qui se traduisait, entre autres, par le culte d’Elvis Presley. Le pantalon à pattes d’éléphant, la chemise moulante, les cheveux gominés, le spectacle en valait la peine et les deux frères en riaient de bon cœur.
– Viens m’écouter. Je vais te chanter Don’t be cruel.
Et il s’installait dans la cour arrière sur le balcon à faire semblant que c’était une scène, un simulacre de micro entre les mains. Une foule hystérique face à lui. La foule, c’était Charles.
Charles qui l’applaudissait et sifflait.
« Je pense que ce qui nous unissait, c’était le plaisir pur de faire des choses ensemble, sans se juger, sans se jalouser. »
Ce plus jeune frère était aussi « un grand cœur », un hypersensible. Et puis un jour, Marcel s’est marié, est devenu père. C’était pour lui le plus grand des bonheurs. Mais la fragilité créée par le remous des relations conjugales, le risque de perdre l’amour de sa vie, son enfant, a fait de lui un homme pétri de douleur, incapable de se battre.
Il macérait dans sa mélancolie et son impuissance. De mauvaises influences, la drogue ont eu raison de son désir de vivre.
– Il est allé voir le film Kramer vs Kramer, il en est sorti bouleversé, se souvient Charles.
Déjà il laissait entendre qu’il voulait mettre fin à ses jours.
– On ne le prenait pas au sérieux, évidemment, reconnaît-il, la gorge nouée.
Il assistait impuissant à la détérioration du courage de son frère. De ses forces vives. Inconscient de l’éminence du drame.
Marcel se confiait par bribes sans jamais aller vraiment au fond de son cœur : les mots sont si rares quand la souffrance est trop grande.
Qui pouvait lire dans une boule de cristal que le jeune homme avait tout planifié? Surtout quand on est sûr, comme Charles l’était, que l’amour est le meilleur des remparts.
Ce frère aimé a choisi un beau matin de s’enlever la vie, dans son auto, dans un bois isolé. La solitude de ce choix. Sa douleur intenable. Le froid.
Charles faisait face à la mort pour la première fois. Et il fallait que ce soit par ce frère aimé si tendrement! Il a vécu de longues années enfermé dans des questions stériles, des questions sans réponses. Une vague culpabilité comme chaque fois devant un suicide; la colère, et puis cet impossible vide à combler.
Il lui fallait pourtant continuer à vivre. Charles l’a fait en enfermant son chagrin en lui-même. Un beau chagrin dans un écrin de nacre scellé et muet comme une tombe. L’affection fraternelle est à jamais disparue et, nulle part dans la famille, il ne trouve quelqu’un avec qui il pourrait partager sa douleur.
Le départ absurde du petit frère alimente une plaie vive.
Refermons le tiroir.
La peinture a été le pivot des actions de la deuxième partie de sa vie, une passion, un exutoire jusqu’à un certain point. Elle a aussi canalisé sa quête d’absolu et de bonheur. C’est ainsi que la vie vaut d’être vécue, c’est ainsi qu’il voulait poursuivre sa route.
Peindre ne veut pas dire absolument choisir l’indigence. La bohême est un cliché. La majorité des peintres, s’ils ont le choix, optent pour la réussite, sinon la gloire. C’est prosaïquement le moyen de gagner sa vie, et d’entretenir celle des autres, comme le font tous les artisans, tous les entrepreneurs. Faut-il vraiment choisir la misère quand on est peintre? Au nom de quoi? La liberté? Malheureusement, beaucoup d’artistes y sont contraints. Mal armés pour défendre leurs droits, timides lorsqu’il s’agit de se mettre en évidence, parfois jouant la carte du mépris des préoccupations matérialistes.
L’art pictural est une affaire comme une autre avec sa stratégie de développement, ses rouages et ses contraintes. Le simple mortel ému devant la grâce du talent ne voit qu’un artiste, sa sensibilité, les vibrations qui le touchent. En réalité, un peintre qui consacre sa vie à son art est, en quelque sorte, le président-directeur général de sa propre entreprise. Il doit s’entourer d’une équipe qui comblera les lacunes de sa gestion. Et apprendre surtout à faire confiance.
La pureté du geste de créer est malheureusement, il faut bien le reconnaître, entachée souvent d’exploitation et d’abus par des rapaces avides et sans scrupules.
Pour s’y retrouver dans cette jungle, car c’en est une, et pour ne pas être dupe, l’artiste comme le public en général doit être renseigné.
Et, pour cela, il faut commencer par le commencement. Carson a toujours prôné que l’école publique devrait inscrire à son programme régulier un enseignement de l’art pictural qui en relaterait l’histoire, les grands noms, les courants. Les enfants ont le droit d’y avoir accès. La culture n’est pas la chasse gardée des adultes!
Qu’il s’agisse de littérature : lire Victor Hugo ou Saint-Denys Garneau. De musique : écouter du Mozart ou du Debussy. Il faut savoir regarder un tableau de Matisse pour le suivre dans sa démarche. De même que tous les autres génies qui dorment dans les musées, ceux qu’il faut découvrir dans les expositions! Voilà qui contribuera à forger des têtes bien faites. « Les enfants sont comme des éponges et se gonflent sans difficulté au contact de la beauté. » Les pédagogues ont le devoir de les aider à décoder le langage des grands maîtres qui ont ouvert des voies et inspiré les générations suivantes d’artistes jusqu’à ce jour. « En grandissant, les enfants seront heureux d’appartenir à un monde où la création rend meilleur. »
Est-ce que l’art peut changer le monde? « Si on veut évoluer en tant que peuple, on doit respecter le travail, le talent des artistes, écouter ce qu’ils ont à dire. » Il entend par là qu’une des manières de transformer notre environnement, d’influencer la pensée humaine consiste à saisir l’intuition qu’un artiste manifeste dans son œuvre, qu’elle soit peinte ou écrite. Cette intuition permet de mieux percevoir l’avenir et les transformations qui s’amorcent.
Il ne nie pas par ailleurs que l’art est peut-être la part du divin en chacun de nous; un outil pour transcender la laideur.
De temps en temps, à travers certains mouvements de pensées, des tentatives de séduction, même de provocation, le démon de l’insensé fait son apparition.
« Des excréments collés dans l’époxy ne sont pas de l’art. Le message de Piero Manzoni qui déféqua dans 90 boîtes de conserve en 1961, sur lesquelles fut inscrit merde d’artiste en fait foi. Près de 45 ans plus tard, qu’ont donc compris les collectionneurs du message de l’artiste? Pas grand-chose. Pour être dans le coup, ils se sont procuré ces boîtes à 30 500 euros pièce!
« De même, ajoute-t-il avec colère, lorsque le Musée national du Canada fait l’acquisition d’un tableau de 1,8 million pour trois lignes de couleur sur une toile, cela devient indécent. »
Les gens ordinaires ne comprennent rien, pensent les apôtres de l’hermétisme? « Qu’y a-t-il à comprendre, sinon qu’on les prend pour des imbéciles », ajoute Carson.
Nous sommes allés ensemble à Toronto visiter une exposition nationale de galeries d’art. Nous allions d’un kiosque à l’autre, remplis d’admiration pour certains travaux. À cette exposition, il aurait aimé être surpris, excité, motivé.
Carson est respectueux, on le surprend rarement à critiquer les autres. Mais, soudain, n’y tenant plus, il traite de « barbouillage » un tableau immense qui se dresse devant nous. Il est indigné. « Le ridicule ne tue pas heureusement, car plusieurs seraient morts. »
Il ajoute : « Ce n’est pas parce qu’on a atteint une renommée qu’on peut faire n’importe quoi! Il faut être sensible aux gens qui nous regardent et veulent nous comprendre, les respecter, donner le meilleur de nous-même. L’art n’est pas un geste banal ou insignifiant, c’est la responsabilité de l’artiste de se surpasser. »
Nous sommes placés soudain devant un tableau peint en jaune serin uni, comme une publicité de compagnie de peinture, et qui est l’exemple parfait de ce qu’il vient d’énoncer.
Plus tard, il s’est exprimé sur autre chose de plus intéressant : « Le traitement des couleurs me fait penser à William Turner », a-t-il dit, admiratif.
Ouvrir et baliser des sentiers, tracer une route en plein désert, dépasser les limites dans tous les domaines, qu’il s’agisse des sciences ou de l’art, est l’une des vocations humaines de première importance. L’artiste qui, dans la solitude et le doute, réussit à faire émerger un chef-d’œuvre dont la seule vision permet d’ouvrir une porte sur la conscience appartient à la race des explorateurs.
Peindre est un apostolat pour celui qui creuse les mystères, ne se satisfait pas des apparences, cherche au-delà du réel un trésor enfoui.
Un artiste véritable traduit, par ses métamorphoses picturales, l’âme d’un peuple. À ce peuple il révèle des vérités ou débusque des faussetés. Comme le poète dont les mots qui chantent se répercutent sur la frontière de notre esprit. Et l’ouvrent.
Le journaliste colombien, Gustavo Tatis Guerra, rapportait dans le quotidien El Universal, en 1994, un entretien qu’il avait eu avec Carson : « On retrouve dans vos œuvres toutes les couleurs de la planète, des plus fortes aux plus ternes, de la voûte céleste aux profondeurs des volcans qui vivent inconsciemment dans les entrailles de l’homme. Le vide entre deux infinis : le ciel et la terre. Pure peinture! »
Un véritable artiste n’est jamais au repos intellectuellement. Avec sa sensibilité particulière, toutes les fibres de son être tendent à saisir le monde qui l’entoure, à en comprendre les mouvements qui peuvent avoir une incidence sur son art. Au cours d’une promenade dans la ville, au jardin ou en forêt, il ne peut pas laisser ses yeux se reposer, ni sa tête ni son cœur, emporté qu’il est par les beautés; quelquefois touché par la laideur, le mal, le désespoir sous-jacent qu’il perçoit. Tout lui sert, pour le meilleur et pour le pire. Les faciès crispés sous le vent, la tendresse de certains regards, la rudesse d’une falaise ou la sérénité d’un champ de blé. Les formes infinies et les couleurs innombrables de la neige, composées, décomposées, de la blonde abeille, du noir corbeau. Ce qui se voit, ce qui se cache. Et même les odeurs sont comme autant d’éléments permettant un retour sur des paysages d’automne, sur le linge propre séché au vent.
Il se les approprie en pensant sans forfanterie qu’il pourra : « peindre un état d’âme et non pas une réalité pour introduire l’idéal dans l’art », comme l’écrivait Pearl Buck.
En cette fin de mois de novembre 2007, le Jardin botanique de Montréal où nous nous promenons, Carson et moi, est peu fréquenté à cette heure du jour. Dehors, c’est la grisaille humide et mordante du début de l’hiver.
Dans la grande serre, il s’est attardé d’abord aux effluves de l’air moite : « On se croirait sous les tropiques. On est dans un autre monde. » Il est ravi de ce dépaysement inattendu.
Le corps tout à coup se détend, ne se défend pas. La respiration se fait calme, plus profonde.
Il avance précautionneusement sur le petit sentier, s’incline ou lève la tête à tout moment devant la majesté de certains arbres, la beauté des fleurs : « On dirait que c’est peint à la main », observe-t-il sans cacher son étonnement en prenant délicatement un pétale entre ses doigts.
« Pour moi, venir ici, retrouver un contact intime avec une nature luxuriante, c’est comme visiter un musée ou m’aventurer dans la jungle. Dans les deux cas, on doit y faire son chemin dans le silence. »
Au cours de notre promenade cet après-midi-là dans le Jardin aux mille merveilles en plein cœur de la ville, il a fait preuve d’une bonne humeur débordante. D’un certain bonheur de vacances. L’ambiance chaude et douce des serres le réconfortait.
Brutalement, le bananier, caché au milieu d’autres arbres et plantes exotiques, a imposé sa présence par ses feuilles énormes :
« Je sais faire les bananes frites, tu sais », s’est-il exclamé, gourmand. Et il a poursuivi : « La première fois que j’ai vu un bananier, j’ai été impressionné qu’un arbre apparemment sans force puisse supporter, sous ses longues feuilles, le poids de tous ces fruits regroupés. »
Les réminiscences gustatives et visuelles ont cédé la place au lyrisme.
« Le rôle de la couleur dans la nature, ces pigments de vie et de mort, tous ces pièges tendus, cette séduction. Peut-on croire être vraiment capable d’en reproduire toutes les nuances? C’est impossible! »
Il se revoit au cœur de la forêt tropicale, la vraie qu’il a bien connue. Tout lui est souvenir. Il ne tarde pas à me faire remarquer un pélican sous la forme d’une fleur; un sexe féminin sous la forme d’une autre. Il ne tarit pas d’éloges devant la patience de certaines plantes dans leur croissance et ne manque pas d’entrevoir l’éclat de la soie, du satin et du moiré dans les pétales de fleurs exotiques ou familières : « Il y a des fleurs qui se font encore plus belles quand on les regarde de près, secrètes, mystérieuses, envoûtantes. »
Et pourtant fragiles et éphémères.
À la vue des bonsaïs, Carson sent surgir plusieurs autres souvenirs : « C’est au Japon d’abord que j’ai vu mes premiers bonsaïs, il y a déjà plus de 20 ans. Quelle finesse! En Égypte, j’ai appris que la culture de ces arbres nains aurait commencé là il y a plus de 4 000 ans. Je suis attendri par leur longévité, fasciné par leurs formes et l’équilibre des masses, résultat de la patience d’hommes sages qui les ont aidés à vieillir sans jamais qu’ils deviennent grands. J’ai aussi découvert au Musée de Tokyo le plus vieux bonsaï, âgé de 1 500 ans! J’étais fasciné. Je n’ai pas pu résister à l’envie d’en peindre un en haut d’une montagne en Chine. »
À cette époque de voyages, les découvertes sont nombreuses et marquantes. Il a souvent connu des périodes de recherche d’harmonie, de questionnement spirituel. À 20 ans, il s’est penché sur les philosophies orientales et s’est inscrit à des cours de karaté Shotokan avec un Maître québécois, André Ouimet.
Poursuivant son observation des bonsaïs dans la grande serre qui les abrite, il s’immobilise soudain devant l’un d’eux : « Celui-ci a mon âge… »
Il se trouble. Le cap des 50 ans est pour lui une épreuve qu’il doit apprivoiser. Car « vieillir… Oh! vieillir », Chantait Brel.
Un nuage passe.
Distrait plus loin par l’exubérance d’une branche chargée d’orchidées. Attendri, quelques fois ému devant le réseau délicat des motifs de pétales et de feuilles. Il me rappelle avec enthousiasme que certaines fleurs se mangent.
« En peinture comme dans la nature, dit-il en plongeant son regard dans les corolles d’une belle fleur comme sous un jupon, le réflexe humain est de rechercher quelque chose de familier, de rassurant. »
Il raconte, inspiré, en traînant le pas sur le sentier bordé d’immenses fougères, qu’il n’a pas fréquenté l’École des beaux-arts malgré son désir. Cela ne faisait partie de la culture ni familiale ni sociale de son enfance.
Pourtant, rien ne l’arrêtait dans sa recherche picturale. Voyons notamment en 1977, il a 30 ans, ce qu’il a entrepris.
Les natures « mortes » qu’il exécutait étaient des exercices académiques. Le sujet importait peu. C’est par ce biais qu’il apprivoisait l’espace et la profondeur, ces deux éléments qui seront la clef de voûte de son travail plus tard. Il s’y contraignait dans un sentiment confus d’urgence, de nécessité, voire d’une certaine forme de douleur.
Il ressentait un sentiment âpre et désespérant de ne pouvoir donner libre cours à l’envie omniprésente. On pouvait même penser à un torrent qui cherche un lit, l’épouse et le déborde.
Il a gravé sur le verre avec une pointe de diamant. En superposant verre sur verre, il a réussi à donner un effet tridimensionnel qu’il souhaitait. Il a utilisé différents procédés : collage, cuivre, peinture, herbage et autres. Le Château Frontenac était l’un de ses sujets de prédilection pour expérimenter sa gravure sur verre. L’idée lui en est venue en découvrant en Europe le merveilleux verre Lalique.
Cette technique de création a eu l’heur de plaire, mais il ne s’est pas arrêté là pour autant. Il a perfectionné sa technique de juxtaposition des couleurs. Il s’est servi de l’acrylique pour créer des formes abstraites aux couleurs vives. Sur une toile de lin, il a disposé des parcelles de verre coloré, complété de traits d’acrylique qui conférait au travail fini un aspect de haut relief. Puis, afin de faire éclater les couleurs, il les a rehaussées d’un vernis ultrabrillant. Il était fasciné et séduit par l’art des maîtres verriers de Murano et, pour ce faire, chauffait d’immenses fours à céramique à étages multiples, créait des moules et plaçait ses glacis à 2 000 et 3 000 degrés.
Il cherchait à tout prix à reproduire en peinture la texture, les formes, la transparence des vitraux d’églises si chers à son cœur.
Une exploration qui le poussait en avant comme une naissance annoncée.
Il se servait pour sa démarche artistique d’huile, d’acrylique, de pastel, de fusain. Toutes les surfaces de récupération servaient à ses expériences d’adhérence, de durée.
Au cours de ces années d’expérimentation d’effets spéciaux et d’art contemporain, l’artiste ne ménageait aucun effort. Il laissait tomber des poches de peinture du haut de la maison et allait vite voir les étonnantes éclaboussures sur le trottoir! Ou alors il faisait tourner une perceuse sur laquelle il avait fixé un panneau enduit d’acrylique de couleur, de noir et de blanc… Et puis le ballon gonflé rempli de peinture faisant éclater sa couleur sur la toile...
Il s’est même servi de la roue d’une vieille bicyclette dont il avait enlevé le pneu et qu’il faisait tourner remplie de couleurs, pour juger de l’effet sur une toile. Ouf!
Il n’est pas exagéré de dire qu’il explosait! Car, un jour, il a failli détruire sa maison par le feu en expérimentant une certaine finition au vernis. Cette mésaventure le fait rire encore aujourd’hui. « J’ai appris que peinture et feu ne font pas bon ménage. »
Pour recréer « l’effet Murano », le toit de bois de l’atelier de même que l’œuvre en devenir ont été réduits en cendre.
L’incident, comme il arrive parfois dans de nombreuses découvertes scientifiques fortuites, lui a permis de mettre au point un mélange d’époxy et de verre appliqué à la torche.
Mais combien de moulages de plâtre ont été perdus! À combien de kilos se chiffrent les tesselles ou morceaux de verre coloré utilisés au cours de ses expériences de mosaïque?
Aujourd’hui et depuis fort longtemps déjà, il utilise l’acrylique, « plus malléable pour les textures, explique t-il, au séchage plus rapide, ce qui me permet de multiples superpositions de couleurs ». Ses tout premiers sujets ont été des bouquets de fleurs, traités de manière abstraite.
Selon la vision du peintre Wassily Kandinsky, « l’âme de l’artiste, si elle vit vraiment, n’a pas besoin d’être soutenue par des pensées rationnelles et des théories. Elle trouve par elle-même quelque chose à dire ».
Pour Charles, ce « quelque chose à dire » devait impérativement être exprimé avec de bons outils. Il travaillait à trouver une forme d’écriture qui lui soit personnelle. C’était une quête et un défi.
Sa tête guidant sa main, dans les moments de mélancolie, de colère, de déception, de bonheur, il s’empare d’une spatule, de la couleur et confie à la toile ce qu’il ressent, laquelle, à son tour, nous en fera part.
Par miracle, par on ne sait quelle entourloupette de son cerveau et de son talent, le tableau fini sera d’une éclatante joie de vivre. Un vibrant témoignage de jeunesse et d’optimisme qui place la vie avant toute autre chose.
« La peinture me harcèle et me tourmente de mille manières comme la maîtresse la plus exigeante », disait Eugène Delacroix.
Cette obsession est présente chez tous les créateurs, et Carson n’y échappe pas.
«Une chromatique harmonieuse et audacieuse à la fois, des jeux de transparences et de profondeurs, une composition dynamique et un sens de l’invention constamment renouvelé. Voilà la recette gagnante qui propulse l’artiste de succès en succès. »
À la Galerie d’art Beauchamp à Québec et à Baie-Saint-Paul où Charles Carson expose au sein de leur Galerie contemporaine, la clientèle a, depuis les débuts, saisi la force de l’œuvre « carsoniste ». Afin de traduire en mots le style du peintre, Arévik Vardanyan, conseillère en art et muséologue, lui a consacré un article où elle met en lumière : « […] les éléments qui rendent, par le carsonisme, l’œuvre du peintre exceptionnelle, voire phénoménale, soit : le style de peinture, la composition, le sujet, la palette, la texture, la lumière, le mouvement. »
« Et c’est là le travail de l’artiste : des œuvres qui attirent au premier coup d’œil le spectateur, tout en gardant leur contenu profond pour un deuxième regard », a également écrit Louis Lefebvre, critique d’art dans le journal La Presse de la Manche.
C’est l’unanimité des témoignages : « Plus on regarde ses toiles, plus on découvre des choses. » Cette phrase est comme un leitmotiv qui résume l’admiration que lui vouent ses amis, les amateurs d’art, les collectionneurs.
Donc, voilà une œuvre qui ne cesse de livrer sa richesse et ses secrets. « À force de recherche et de travail, après 30 ans devant ses chevalets, avec l’inspiration et l’obstination pour seuls témoins, Charles Carson a bâti une œuvre unique en son genre. Une œuvre forte et belle », poursuit Louis Lefebvre dans son analyse.
L’admiration des autres est un baume à tout créateur, et, pour le peintre, un témoignage encourageant pour des années de travail, un long parcours. Mais il ne pavoise pas pour autant. Il n’alimente aucun amour-propre. Ou alors infime, lové au fond du cœur. Comme beaucoup de créateurs, notamment l’un des grands poètes anglais, John Keats, qui était insomniaque à cause de la poésie qui le hantait, qui croyait et en même temps n’osait croire à l’immensité de ses talents.
Chagall répétait : « Les profanes sont mes critiques préférés. » Carson reprend pour lui cette phrase et déclare que c’est à ses lecteurs qu’il craint d’abord de déplaire.
L’homme et l’artiste sont en opposition d’une certaine manière. Ou complémentaires, selon le point de vue. Autant l’artiste est flamboyant, autant l’homme est réservé.
Laissons parler l’un de ses amis. « Le peintre que je connais est un être attachant, simple, touchant », dit Bernard Grelier, homme d’affaires, et grand collectionneur des Carson.
Il raconte que c’est en feuilletant par hasard un magazine d’art que son attention fut attirée par des photos de ses œuvres. Le coup de foudre fut immédiat, un coup de cœur comme il en arrive peu dans la vie.
Grelier s’est mis en tête de rencontrer cet artiste au talent si radieux, qui lui faisait un si grand bien à l’âme. Il est parvenu quelques mois plus tard à le rencontrer et à tisser dès lors des liens amicaux.
« J’ai toujours été passionné de peinture, je suis devenu au fil des années un collectionneur averti, je crois, un modeste connaisseur. Devant le talent original et unique de ce peintre, j’ai été subjugué. »
Au point, avoue-t-il, « que je n’hésite pas à me défaire de deux tableaux de peintres célèbres, Richard ou Cosgrove par exemple, pour un seul Carson. Lorsqu’ils sont trop nombreux sur mes murs, dit-il en riant, ce sont mes enfants qui en bénéficient. »
Il ajoute pragmatique : « C’est un bon investissement. Un jour, Carson vaudra davantage que bien des peintres célèbres. »
D’ici là il en jouit, ne se lasse pas de les admirer, d’y découvrir chaque jour de nouveaux éléments qui l’entraînent ailleurs.
Un peintre qui a du succès enrichit le patrimoine financier de ses admirateurs. Voici ce qu’on pouvait lire dans le Magazin’Art dans sa livraison estivale de 2005, sous la plume de Louis Bruens.
« […] Un artiste ne peut peindre plus d’un certain nombre de tableaux par année. Si la demande est plus forte que l’offre, comme en bourse, sa cote monte au gré de sa réputation et de son succès. C’est le cas de Carson aujourd’hui très en demande par les investisseurs. »
Selon Dominique Stal, expert diplômé de l’École du Louvre, la valeur réelle des œuvres de Carson serait bien supérieure à sa valeur actuelle à la pratique sur le marché. Une estimation qui s’est trouvée confortée récemment lors d’une vente aux enchères publiques le 18 juin 2006, d’une œuvre de l’artiste, à Metz en France.
Charles Carson s’est toujours senti mieux loin des feux de la rampe tout en ayant, il faut le dire honnêtement, le besoin de confort et de sécurité. L’important pour lui consiste à faire son travail, mais il ne tient pas à mourir de faim! Il travaille par tempérament, loin des projecteurs, dans la solitude, si ce n’est dans une certaine douleur de mise au monde. Mais dans quelle joie aussi!
Il y a quelques années, il déclarait qu’il ne tenait pas à s’exhiber en public ni à nourrir de potins l’imaginaire d’un véritable collectionneur. « Quel intérêt aurait-il à connaître mon enfance, ma vie, mon statut matrimonial? Le peintre n’est pas un amuseur public, il n’a pas, comme le chanteur, le devoir de se donner en pâture à son public. La matière doit parler pour lui, seule ma peinture devra dire mes pensées, mes émotions et mes rêves. »
Sa philosophie n’a pas changé, mais il conçoit que, pour faire reconnaître son œuvre, il doit communiquer avec des journalistes, des collectionneurs et le public en général.
Naturellement plus apte à écouter qu’à parler, à recevoir des confidences qu’à en faire, plus près des coulisses que de l’avant-scène, il a cultivé l’art du non-dit, voire du paradoxe.
Il connaît ses points sensibles où on peut l’atteindre et le blesser et a transformé délibérément sa vulnérabilité en barricade. Ainsi cuirassé, il nage entre deux eaux, ce qui parfois le rend énigmatique et désarmant.
Toutefois, afin de servir au mieux ses intérêts et ceux des collectionneurs, il a accepté certains compromis : il se confie un peu, n’hésite plus à prendre la parole devant un large public. Des parcelles de son intimité, de sa vie privée ainsi révélées permettent à ses admirateurs de mieux le comprendre.
Cette réserve, pudeur même, c’est dans une enfance écorchée vive qu’il faut en trouver l’origine. Comme il a été habitué à se faire tout petit, qu’il a été conditionné plus tard à la discrétion, les coups d’éclat ne sont pas sa force.
Bien des éléments ont contribué au mystère entourant l’homme. Il y a le passé récent : sombre, trouble. Le passé lointain: à peine enterré sous la surface des souvenirs.
« Vivre sans passé est pire que vivre sans avenir », a dit un grand sage.
Charles veut donc se souvenir du passé pour en prendre possession, le contrôler, l’exorciser.
Mais le raconter, même si c’est libérateur, c’est également souffrant. Les mots à peine sortis de la bouche écorchent et ravivent des plaies profondes.
Le diable est prompt à ce jeu.
Mais revenons aux évaluations de la valeur de l’artiste, aux témoignages d’admiration, puisqu’il faut bien l’admettre, ils sont légion.
Lors d’un souper-encan de la Maison Victor-Gadbois, la représentante de la Financière Banque nationale de Mont-Saint-Hilaire a tenu ce propos : « Il est rare de pouvoir dire cela, mais la valeur des tableaux de cet artiste pourrait bien doubler dans les prochaines années. Il s’agit d’un peintre innovateur qui a sa propre technique et une imagerie unique. »
Au cours d’une exposition d’un mois en Normandie à Tourlaville, Carson est qualifié « d’artiste exceptionnel ». Et le maire en rajoute : « Depuis 1990, plus de 280 expositions ont été tenues à l’Espace culturel de la mairie. Des artistes connus, d’autres moins. Aujourd’hui, cela a été un grand honneur d’accueillir l’un des plus grands peintres contemporains… »
Le journaliste français et critique d’art, Louis Lefebvre, a écrit : « Voilà un artiste dont le talent et l’œuvre sont d’ores et déjà passés à la postérité. »
Après plusieurs jours d’absence, il franchit les portes de la Galerie Richelieu sur la rue Saint-Denis à Montréal, là où une grande partie de ses œuvres sont exposées. Il rentre de Paris, médaillé d’or, invité d’honneur du Salon artistique 2007, sous le thème : L’art dans sa diversité. Il est comme un pacha retrouvant sa tribu et son royaume.
Anne-Marie Laures, présidente du Salon, lui a servi cet éloge dithyrambique en guise de présentation à l’ouverture de l’événement :
« L’art de Carson est duel : d’une part, il traduit son amour de la nature sublimée, évoquant l’embrasement d’un coucher de soleil ou des instants de la vie animale et végétale; d’autre part, son propre paysage intérieur est révélé de façon brillante dans ses œuvres mosaïques. Sa peinture est tonique, onirique, à travers laquelle des formes vivantes entrecroisent d’autres formes réelles ou inventées. Elle est aussi un entrelacs de couleurs baignant dans des superpositions habiles, des transparences subtiles, posées en touches obliques accentuant l’effet de mouvement et de scintillement lumineux. »
Il doit répondre; tant d’honneurs, tant de compliments, c’est trop, il est touché. Mais il aimerait s’évader de cette cour, car sa timidité est en voie de le rattraper. Ce n’est pas facile de parler devant une foule d’étrangers, surtout quand on n’est pas à l’aise en société. Et particulièrement s’il faut faire des ronds de jambe! Le bagou des Français est étourdissant. Comment trouver les bons mots, se faire comprendre malgré l’accent québécois?
Le héros de la fête était pris dans un piège doré et, malgré son envie, n’a pu filer à l’anglaise.
Alors, il a fait contre mauvaise fortune bon cœur, car on l’entourait et le félicitait de tous les côtés. Il s’est approché délibérément d’une compatriote, Katherine Sirois, historienne en arts installée à Paris depuis plus de quatre ans et vivement intéressée par ses tableaux. La conversation était chaleureuse, il ne craignait pas d’écorcher la syntaxe, il se détendait, souriant. Dans cette foule baroque, il avait trouvé une bouée de sauvetage.
Soudain, surgissant à deux pas de lui, une femme échevelée s’écrie :
– Monsieur Carson! Monsieur Carson!
– Oui…, Madame…
Le bec pincé, la douairière octogénaire qui a interrompu la conversation avec autorité saisit l’invité d’honneur par le bras.
– Laissez les jeunes femmes tranquilles, venez plutôt rencontrer mes amies qui vous attendent! Allez, allez!
Parcourir 6000 kilomètres pour recevoir une médaille, c’est une chose, mais c’est trop loin pour une leçon d’étiquette!
Le preux chevalier évoque la scène avec humour et un fond d’indulgence.
La Galerie d’art Richelieu est effectivement son royaume où il a ses habitudes, ses rituels. C’est l’annexe de sa maison en quelque sorte. Colette Richelieu le reçoit avec plaisir; il s’installe avec elle et discute d’art, de marché, de public.
Charles se revoit 25 ans plus tôt en compagnie du Dr Max Stern qui l’accueillait dans sa galerie avec la même chaleur. « Il savait créer une atmosphère unique, prodigue de conseils. Il me consacrait une attention particulière, j’en garde un excellent souvenir. » Le Dr Max Stern est décédé en 1987. Il a fait don par testament d’une grande partie de sa collection au Musée des beaux-arts de Montréal.
Colette Richelieu entend aussi ses tourments de création, elle l’encourage, se renseigne sur l’étape actuelle de ses recherches.
Il est chez lui, arpentant les lieux, une mallette d’ordinateur à la main, très homme d’affaires, dépistant d’un seul coup d’œil les absents, les tableaux vendus.
On ne sait pas s’il plaisante ou s’il est sérieux lorsqu’il s’exclame subitement en reculant d’un pas :
– Regarde comme ils sont beaux, ces tableaux!
En plissant les yeux devant la lumière flamboyante des couleurs. Un peu comme s’il se trouvait devant les œuvres d’un autre peintre ou qu’il remarquait son travail pour la première fois!
Il ajoute mi-badin, mi-sérieux, en me jetant un regard oblique :
– Je crois bien qu’on fera un peintre de moi.
– En es-tu bien certain?
Il éclate de rire.
– C’est incroyable tout ce qu’on porte en soi. Je m’étonne moi-même.
Il reconnaît sans peine le mystère qui participe à toute création. Et, comme il se donne l’ordre intime de toujours faire mieux, il assure qu’on n’a encore rien vu.
Il cache mal le bonheur de l’inspiration rayonnante qui vit là désormais sur les toiles. Sans doute retrouve-t-il en les observant l’élan qui les a fait naître.
Il examine aussi ses tableaux à travers le regard de Colette Richelieu. C’est elle qui sait le mieux traduire en mots au visiteur de la galerie ce qui est l’essentiel. Avec ce sentiment d’insécurité et de doute qui le tenaille, il est réconforté chaque fois qu’elle lui confirme la vente d’un tableau, chaque fois qu’elle lui relate les commentaires des visiteurs. L’excitation évidente des acheteurs.
Il a besoin comme tout créateur de ce « petit lait » qui le rassure.
L’argent n’est pas tout dans la vie. Charles possède un bon sens des affaires, toute sa vie passée en témoigne. En dépit de déboires cuisants, il a pu se maintenir à flot, évoluer et avancer.
Si chaque dollar gagné par la vente d’un tableau est comptabilisé, il est aussi oublié d’une certaine manière. Tant l’homme, le mari, le père, l’ami se perd dans un tourbillon de prodigalité et de générosité parfois intempestives.
De temps à autre, il dépense sans compter. Le jour d’après, il se reprend, conscient de ses multiples responsabilités. Il se méfie donc d’un compte de banque dont les actifs diminuent.
Colette Richelieu n’a pas oublié le jour où elle a rencontré Charles Carson, il y a près de sept ans. La similitude des événements de ce jour-là et de ceux d’aujourd’hui est frappante. Il revenait du Salon d’automne international des beaux-arts de Montréal, fier lauréat de la « Grande Médaille d’or du rayonnement universel » qui lui fut remise en reconnaissance de son talent et pour souligner l’ensemble de son œuvre. Il était en compagnie de son agent de l’époque.
« Je connaissais Carson de réputation, je ne fus donc pas surprise de lire, au sein d’une littérature abondante, toutes les louanges de l’artiste dont celle-ci tout particulièrement, de l’historienne d’art, Lise Grondines :
“[…] Je pense, sans un doute, que Charles Carson sera l’un des grands peintres abstraits contemporains de ce siècle. Cette affirmation est la plus grande marque de reconnaissance du talent d’un peintre, un témoignage que je n’ai jamais rendu à personne à ce jour…” »
La galeriste comprend qu’il s’agit là d’un artiste capital et n’hésite pas une seconde à en faire la figure de proue de sa galerie.
« J’ai tout de suite été séduite par son dynamisme et sa volonté de maintenir le tempo d’une carrière de plus d’un quart de siècle, bien rodée, le vent dans les voiles. »
Il était fin prêt pour une exposition solo. Tout était maîtrisé, bien orchestré.
L’exposition s’est organisée tambour battant en décembre 2001. Un journaliste du réseau TVA, Dominique Arpin, a offert de tourner une émission sur place en début d’année à la condition que l’exposition se poursuive en janvier. Ce fut un immense succès.
« Il est venu plus d’un millier de visiteurs au cours de cette exposition, relate madame Richelieu. Depuis ce jour, l’intérêt pour l’œuvre de Carson ne fait que croître. »
« Artiste le plus prometteur, le plus remarquable de sa génération. »
« Héritier sans conteste de nos meilleurs peintres. »
Voilà encore ce que disent de lui de nombreux experts et admirateurs. Les notes élogieuses que laissent les visiteurs dans le cahier des commentaires.
C’est indéniable que chacune de ses expositions est un événement en soi. Ce le fut particulièrement en Colombie où il a vécu une décennie de sa vie.
À Carthagène qui était son port d’attache colombien, il est même devenu une sorte de héros national. On lui a érigé un monument en bronze grandeur nature! Ce n’est pas peu dire!
Cette décennie d’exil, véritable saga, sera racontée plus avant.
Si cette retraite loin de son pays d’origine durant les années 1990 a semblé ralentir la progression de sa notoriété canadienne, elle lui fut profitable ailleurs, car il a peint et exposé dans diverses galeries d’art du monde. Ce fut le cas notamment à Londres où il a exposé en solo au Larkin’s Swindon.
Représenté par Phantom Fine Art à New York, il a exposé au ArtExpo 1997.
Dans l’Ouest canadien, Carson s’est adressé à un ami de longue date, le peintre, Leslie Katona, spécialiste des effets spéciaux en art cinématographique, qui a organisé, en 1996, une exposition intitulée simplement : « The Carsonism. » L’expérience a été une telle réussite qu’il n’a pas hésité à la renouveler l’année suivante.
Durant cette même période, l’agent de l’artiste, Stéphane Marcoux du Groupe Mercurart, dont le siège social était situé à Rosemère, a maintenu sa carrière vivante en organisant des expositions solos de 1993 à 1996.
« Nous avons inversé les rôles, dit Charles. C’est lui maintenant qui vit en permanence à Bogota et qui me représente en Colombie depuis mon retour au Québec en l’an 2000. »
Jusqu’à maintenant donc, pas trop de critiques négatives. Si tel était le cas, il se réfugierait dans le sarcasme, choisirait la dérision pour en parler, de manière à cacher son désarroi.
Il a créé, sans le vouloir, une cour d’amateurs inconditionnels. La majorité d’entre eux est constituée de personnages cultivés, il va sans dire, sensibles à l’art, qui ne reculent pas devant la hausse des prix des tableaux, le suivent dans sa démarche picturale, curieux de savoir ce qui s’en vient, avancent avec lui et surtout croient en lui.
« Le phénomène est étrange et constant pourtant, explique la galeriste, Colette Richelieu. Il existe une véritable alchimie entre le tableau et celui qui le regarde. »
Que perçoit-elle de plus fondamental sur l’œuvre qui peut échapper à un néophyte? Elle est convaincue que l’énergie vitale qui se dégage des tableaux de ce peintre explique en partie l’engouement des collectionneurs.
« C’est un artiste profondément libre qui explore diverses facettes de son talent avec un égal bonheur. Il ne sera jamais prisonnier de rien ni de personne, pas même du “carsonisme”. Voilà ce qu’il est convenu d’appeler un véritable artiste. »
Elle le connaît depuis assez longtemps maintenant pour se permettre de pousser plus loin l’analyse de l’homme : « C’est un passionné, voire un excessif. Il est doué d’un magnétisme particulier qui entretient chez lui une part de mystère. Et c’est en partie ce mystère qui fait tout son charme », ajoute-t-elle en souriant.
Enthousiaste, elle partage l’émotion des amateurs : « Dès qu’on plonge notre regard sur l’un de ses tableaux, l’écrin se referme et on a envie de l’ouvrir pour y plonger à nouveau. »
Une amie de longue date, l’avocate Diane Giroux, partage cette opinion :
« C’est à la fois par sa fragilité et le courage à faire face à toutes circonstances que cet homme fascine. L’œuvre de Carson amalgame ce qu’on voit, ce qu’on ressent et ce qui est inaccessible à son contact. »
L’effort de créer tient en grande partie au désir de ne pas mourir, de laisser sa trace dans le monde. Bien des artistes issus d’un milieu familial et social qui ne se préoccupe pas d’art ont émergé de cette obscurité comme un miracle.
Ce fut le cas de Carson. La bonne fée qui s’est penchée sur son berceau à sa naissance en le gratifiant de son don par un coup de baguette magique lui a fourni en même temps la clef pour réussir, en dépit des obstacles.
Petit retour sur le passé, puisqu’il faut bien comprendre comment le peintre Carson a traversé près d’un quart de siècle entre la douleur et la gloire, entre le deuil de l’enfance et la renaissance de la maturité.
En 1983, il a 26 ans. On a suivi son cheminement, ses essais et ses trouvailles. Tant d’énergie et de passion ne peuvent rester inassouvies. Il choisit de consacrer sa vie à la peinture.
Peu importe la manière, le temps qu’il faudra, les efforts à consentir, il va peindre, se consacrer à son art.
Et il va réussir, se promet-il.
La décision n’est pas prise à la légère. Il répond à cet appel comme d’autres entrent dans les ordres et choisissent d’y consacrer leur énergie et leur jeunesse.
Hors de l’atelier, au cœur de la maison, à la fin des années 1980, son mariage est à vau-l’eau; les affaires familiales en général ont du plomb dans l’aile; les enfants traversent une adolescence difficile; l’amoncellement de nuages sur sa tête annonce inéluctablement une tornade qui va tout emporter.
Pourtant, il s’accroche à ce qu’il croit, se débat pour rester debout dans le vent. Car il a horreur de l’échec et plus encore d’être démuni.
Le moyen le plus efficace d’élever un mur de protection contre les rafales est de s’accrocher à son rêve de peindre, d’être reconnu. Et il fonce tête baissée.
« C’est ainsi qu’à plusieurs reprises, il est arrivé chez moi, quelques tableaux sous le bras. Il voulait savoir ce que je pensais de son travail », raconte Louis Bruens, expert en marché de l’art, le mentor de ses premières explorations.
À chacune de ses visites, Charles écoutait avidement ses commentaires.
– Tes tableaux doivent être originaux, ton style doit se démarquer complètement de ce qui se fait ou se voit ailleurs. Tu dois créer… inventer!
Parfois, devant un tableau en particulier, il ajoutait en fronçant les sourcils :
– Celui-là est plutôt mauvais!
Remarque franche qui aurait pu donner le coup de grâce à n’importe quel être dépourvu de courage.
C’était sans compter sur la force de caractère de Charles, son opiniâtreté.
« Contrairement à de jeunes peintres de l’époque qui au bout d’un certain temps croyaient tout savoir, Charles, lui, écoutait, suivait les conseils. Il ne tenait jamais rien pour acquis. Ne se croyait jamais au-dessus de la mêlée. Cette humilité lui a été très utile et elle a été le fondement de sa démarche.
– Ce n’est pas grave, disait-il. Je continue à chercher, je vais m’améliorer, je reviens bientôt vous voir avec de nouvelles peintures!
– Je vois bien que ton talent est incontestable. Mais tu as encore besoin de travailler. Par contre, ces tableaux-là me fascinent par un détail que je ne saurais définir sur le champ. Tu as un sens inné de la couleur et ton écriture picturale est un ensemble de formes sans forme. Quelque chose d’indéfini émane de ton « peinturlurage », quelque chose que je ne peux élucider maintenant, mais qui m’intrigue.
Malgré son talent, il cherchait à le mettre en garde contre un plongeon trop hâtif qui l’aurait rendu extrêmement vulnérable sur le plan professionnel, dans un monde où on ne fait pas de quartier.
Ce jeune homme tendu vers un idéal et d’une sincérité désarmante était vraiment touchant.
L’affection un peu bourrue du départ s’éclairait d’un sourire radieux devant un tableau prometteur.
Conseiller est un art délicat. La critique peut être un moteur d’action, mais peut aussi démoraliser. Il ne fallait surtout pas le décourager. Louis Bruens pressentait, dans les premiers tableaux maladroits, le talent fou qui se frayait un chemin.
– Je reviendrai bientôt, lui disait chaque fois Charles en reprenant ses tableaux sous son bras.
Pour assurer ses arrières, entêté, il poursuivait ses démarches auprès de directeurs de galeries, lançait sa ligne à l’eau, leur montrait quelques œuvres, mais ne cherchait pas à se compromettre tant et aussi longtemps qu’il ne se sentirait pas prêt, étant en cela fidèle aux enseignements de son mentor. Il avait seulement besoin d’entendre leurs remarques générales, leur analyse même superficielle de ses tableaux. Voilà où son humilité le servait. Tout était bon à prendre pourvu que cela lui permette d’avancer, pour « cent fois sur le métier remettre son ouvrage… »
Aussi longtemps que sa technique ne serait pas parfaitement peaufinée, qu’il n’aurait pas trouvé ce qu’il cherchait.
L’atelier de l’artiste était une véritable ruche. En même temps qu’il peignait, il sculptait, expérimentait des techniques de moulage, et installait l’équipement nécessaire au travail de la céramique et des émaux sur cuivre.
Il est allé « étudier » en Europe le plus souvent possible. Les voyages, peu importe la destination, ont été des épisodes de bonheurs, de découvertes. Il partait pour combler un besoin de dépaysement, d’exotisme, bien sûr, mais cette quête était devenue sans peine un exercice de ressourcement et d’instruction sur l’état du monde. Il revenait chez lui chaque fois avec une vision transformée, enrichie. Il a été fasciné par l’Asie, ses splendeurs et ses misères. Sensibilisé sur place aux conditions sociales des peuples, aux problèmes environnementaux, il n’avait pas besoin d’entendre de grands discours pour saisir la situation. Tout entrait par les fibres de ses observations et de sa sensibilité. La protection de la nature, de la Terre en général : les ciels, les mers, les montagnes, la faune et la flore a donné un autre ton à ses œuvres.
Et puis il se gavait de beautés, celles que les Hommes ont façonnées eux-mêmes, avec l’aide parfois du divin : « Les jardins de Monet avec leur lumière, ce que j’ai ressenti profondément face aux œuvres originales des grands maîtres, la magnificence des musées, véritables cathédrales consacrées à l’Art, tout cela m’a profondément marqué, raconte-t-il. Les œuvres colossales me transportaient au point que je ne pouvais plus concevoir de peindre des tableaux de petits formats! La beauté des fresques et des murales, la grandeur de l’architecture même entraient par tous les pores de mon cerveau et me comblaient d’admiration et de bonheur. »
Ces éblouissements en début de vie professionnelle de peintre parachevaient une culture d’autodidacte et formaient en lui une réserve infinie d’images subliminales.
Les rencontres entre les deux hommes se sont poursuivies du,, , , , , , rant quelques années au cours desquelles ils discutaient, refaisaient le monde, consolidaient leur amitié. Incontestablement, au respect et à l’affection s’ajoutait l’admiration mutuelle. Et puis le jeune artiste prenait de l’assurance, ouvrait ses ailes.
« Un beau matin, raconte Bruens, c’était il y a une vingtaine d’années, je l’ai vu une fois de plus franchir ma porte, un tableau sous le bras. Charles hésitait à déballer son travail devant moi. Sans doute craignait-il d’être une fois de plus renvoyé à ses exercices et à ses pinceaux. Après quelques hésitations, il me l’a montré.
J’en suis resté interdit, béat de surprise et de bonheur. »
C’était un tableau de 51 sur 41 cm intitulé, et le symbole est juste et prémonitoire : L’envol.
« J’avais sous les yeux, dit-il en reprenant son récit, une petite merveille. Un semi-figuratif aux couleurs éclatantes, une composition qui répondait parfaitement aux règles de l’art dans un ensemble étonnant d’imagination. »
Il l’a regardé droit dans les yeux avec sérieux.
– Fonce, mon garçon. Cette fois, tu es prêt.
Le chemin de l’artiste était tracé désormais. Des jours et des jours de labeur, de foi et d’espérance aboutissaient sur l’éclaircie tant souhaitée.
Charles spontanément a offert ce tableau au couple Bruens. C’est un porte-bonheur que le couple conserve jalousement.
Le premier tableau de la naissance du mouvement carsoniste.
|
|
Un homme devient plus sûr de lui, du moins en vieillissant, mais, comme bien des êtres qui ont une intelligence sensible, Charles Carson n’a jamais cessé de s’autocritiquer, de douter, n’a jamais perdu le besoin d’être rassuré.
Il n’a pas prise sur l’inquiétude omniprésente qui l’habite.
Le seul lieu où il est tranquille demeure l’atelier. Là, face à la toile blanche, à ses idées et à ses fantômes, il ne craint rien ni personne.
Parfois, il a envie de voir la mer, plus forte que tout, de sentir la chaleur du soleil sur son corps. D’aller ailleurs.
Convaincu qu’il peut peindre partout au monde, sur une plage, dans une cambuse, dans une chambre d’hôtel, il affirme trouver n’importe où un ressourcement à son inspiration. « Je sais qu’on peut toujours partir. On a ce choix. C’est ça qui est merveilleux! »
Ici le « on » veut dire « je ».
À la fin des années 1980, Charles est entré dans une période sombre de sa vie. Ses repères de toujours se transformaient, s’estompaient et disparaissaient dans un tourbillon qu’il ne contrôlait plus. Tout lui paraissait en même temps dérisoire et cruel. Ce qu’il avait bâti jusqu’alors, sur lequel il avait investi une grande part de son énergie, était sapé à la base.
Un mariage qui s’effilochait, des enfants qui dérapaient, une page de sa vie qui se tournait sans annoncer la fin de l’histoire.
Il avait beau s’accrocher et tenter de ne pas se laisser distraire de son projet de vie, la création, on le tirait inexorablement vers le fond. Les ennuis, même les catastrophes affluaient de toutes parts. Sa volonté s’érodait au quotidien. Il tentait de maîtriser ce qui allait mal.
L’enfant en lui refusait de mourir, ou d’être pris en otage.
L’enfant en lui voulait allonger ses ailes, mais le destin le clouait au sol.
L’enfant en lui voulait rester lui-même sans masque. Dans cette conjoncture difficile, l’homme sage en lui a porté secours à l’enfant.
Mais, au fait, l’homme était-il si sage? Ou bien portait-il en lui les germes d’une grande fragilité émotive? N’y a-t-il pas lieu de croire qu’il allait parfois au devant du danger? Car il semblait de temps à autre pousser les limites de sa chance et de la bienveillance des anges chargés de veiller sur lui. Il n’a pas toujours pu esquiver les coups qui le mettaient k.-o.
Malgré sa tristesse, il est essentiel de revenir sur cette décennie 1990, puisque même s’il veut l’effacer de sa mémoire, elle est riche de leçons et de recommencements.
Le noir, le gris, toutes les densités de brumes furent son pain quotidien durant quatre ans. Le tunnel était d’une longueur démesurée. C’est tout le temps qu’ont duré les tracasseries de son divorce.
On dit qu’un malheur n’arrive jamais seul. Dans ce cas-ci, on peut affirmer que le malheur avait la dent longue et un appétit de forcené. Ce fut une véritable débâcle surréaliste.
Laissons dans l’ombre pour l’instant ce qui écorche encore son âme quand il les évoque : les conflits violents avec les membres de sa famille.
Le divorce seul déjà engendrait une forte part d’angoisse. Avec lui venaient les batailles juridiques, les pertes innombrables affectives et financières, et ses repères fondaient un à un. Il y a laissé maison, économies, chemise, alouette… À travers tout cela, subrepticement, il assistait impuissant à tout ce qui avait constitué sa vie jusque là.
Sans déraisonner, il expérimentait, plus insinueuse, plus dévastatrice encore, la perte du goût de vivre.
Durant ces longs mois de tracas sans fin, la Cour supérieure lui avait confié la garde de ses deux garçons. Il a vécu avec eux à l’étroit dans un petit appartement de trois pièces, après avoir été dépossédé de tout. On le harcelait de toutes parts pour mille raisons obscures et, quoi qu’il fît, rien ne parvenait à satisfaire l’appétit des vautours, ni calmer les esprits survoltés.
Il tentait du mieux qu’il pouvait de colmater les brèches, mais le navire prenait l’eau et finalement il a sombré. Il s’en est fallu de peu pour qu’il sombre avec lui.
« Je n’ai jamais vécu avec l’argent des autres, c’est
ce qui m’a protégé de la faillite », reconnaît-il,
sibyllin, avec un fond de philosophie qui n’appartient qu’à lui.
« Toute ma vie est partie en lambeaux. »
Dans cette conjoncture de drames ininterrompus, certains écueils ont quand même pu être évités. Depuis, heureusement, il a repris le gouvernail.
Mais, à ramer dans la tempête, il a fini par s’épuiser et croire que la vie ne valait pas la peine d’être
vécue. Qu’il pouvait peut-être jeter les rames à l’eau et se laisser porter par le courant. Sa résistance avait atteint une limite critique; le vertige du revolver sur la tempe était devenu éblouissant. Peut-être qu’une fuite ultime serait la réponse à ces douleurs omniprésentes?
C’est là où une fois encore son ami Daniel Provost a vu juste : selon lui, c’est son humilité qui l’a sauvé. « Il n’a pas craint de se montrer faillible, n’a pas hésité à demander de l’aide. » La vie, la belle vie, les couleurs de ses tableaux, la rivière qui coule, le sourire d’une femme, la tendresse des amis, voilà ce qui a constitué le ressort.
Charles se souvient avec émotion que c’est aussi grâce au cœur et à l’oreille secourables de son ami et voisin de l’époque, Daniel Provost, qu’il a refait surface. « Il est probable que sans lui je ne serais pas là aujourd’hui. »
Seul Daniel qui vivait toutes les situations au jour le jour, pour la bonne raison qu’il habitait à deux pas de chez lui, savait à quel point le risque était grand!
« Je me rendais compte que sa vie matrimoniale, sa vie tout court étaient en train de couler », se rappelle-t-il.
Comment ramener à une certaine raison quelqu’un qui souffre à ce point? Ce n’est pas qu’il ne voulait rien entendre. Il ne pouvait pas.
Daniel Provost s’étonne de l’influence qu’il a pu avoir, dans le vif de la tempête : « Pourtant, il me semble que je n’ai pas été tellement tendre avec lui. Je l’ai pas mal brassé, raconte-t-il en riant de bon cœur, puisque le danger est définitivement passé. Il l’a « brassé » de cette manière affectueuse et virile qu’on retrouve entre deux grands copains, en ne mâchant pas ses mots, mais sans rejet, sans jugement.
Daniel Provost a lancé une bouée au naufragé. Il a permis que l’écume se dépose à la surface et que Charles profite de ce répit pour faire sa valise.
Le meilleur choix dans les circonstances. Partir en voyage, c’était la soupape, le salut.
Dans cette thébaïde où plus rien ne le retenait, il a préféré la fuite, armé de ce qui lui restait d’énergie, seul espoir de sauver sa peau.
Il pouvait reprendre les mots du poète québécois Beaulieu :
« Me voici dénudé
Mais de vie possédé. »
Alors, la vie. C’est tout ce qui lui restait. Il fallait lui donner une autre chance.
Partir en voyage est une chose, mais pourquoi s’est-il déraciné? Pourquoi a-t-il choisi aussi longtemps une autre terre que la sienne pour se retrouver, s’apaiser? Le récit qui précède répond en grande partie à cette question. Le récit qui suit explique ce que Saint-Exupéry disait : « L’homme cherche sa densité et non pas son bonheur. »
C’est dans sa nature profonde de vouloir éclairer son paysage intérieur d’autres lumières, d’autres musiques. Les musées, les monuments, les églises; les champs, les rives de la mer ont leurs propres tonalités qui l’interpellent.
Il connaissait le Caire, Hong-Kong, les Philippines, l’Italie, la Chine et bien d’autres contrées lointaines. Quel lieu, quel pays lui restait-il à découvrir? Devant quel paysage pensait-il ressentir de nouvelles émotions qui pouvaient poser un baume sur ses blessures?
Car il s’est senti dériver, perdre la tête. Il restait là, immobile, toute énergie désamorcée; les bruits le faisaient sursauter; son cœur battait à tout rompre devant l’eau qui coulait d’une rivière, le vertige d’un pont, celui de dormir, dormir.
Un souvenir d’enfance lui revenait sans cesse durant cette période. Il se revoyait enfant sur son poney, galopant dans la poussière de la route au centre d’équitation que son père avait acheté à Lachenaie. Un chien le suivait. Il se sentait heureux et libre.
Et puis le poney a rapetissé. Ou n’est-ce pas plutôt Charles qui avait grandi? N’y avait-il pas dans ce symbole la perte définitive de son enfance? Où donc s’en est allé ce petit cheval familier qui lui donnait tant de joie?
Il raconte ce souvenir aujourd’hui et fait renaître, rêveur, d’autres images : les rodéos, les randonnées fantastiques en pleine nuit, ces baignades, ces courses folles accrochés, lui et Marcel aujourd’hui disparu, à la queue des chevaux!
Il se souvient du Nelly’s Band, le groupe aux trois accords de ses frères, de la reconstitution d’un village du Far West et des combats fictifs de cowboys et d’Indiens. Clint Eastwood était la vedette du jour. C’était lui, Charles, qui interprétait inlassablement sur son harmonica le thème musical de Il était une fois dans l’Ouest de Sergio Leone.
Après le spectacle, les chevaux dormaient, épuisés, debout, la tête molle.
Charles, en évoquant ces images, se revoit plutôt en vieux cheval de trait usé par tant de labeurs et d’ingratitudes, condamné à recevoir une balle dans la tête. La dépression va de la tristesse permanente au désir de mort. « C’est difficile de mettre de l’ordre dans le cheminement de ma vie à cette époque », dit-il.
Pour se distraire, il raconte cet autre souvenir.
« Un jour, au centre d’équitation, dans la cabane du jardin, je jouais avec mes frères, allongé sur un lit de fortune fait d’une vieille porte de métal sur laquelle on avait déposé un matelas de mousse.
Un orage a éclaté, on se croyait bien à l’abri dans notre petite maison.
Soudain, la foudre est entrée par une fenêtre, et la boule de feu dans sa trajectoire a frappé la porte de métal nous servant de lit, l’a noircie, a brûlé le matelas de mousse avant de ressortir par la fenêtre opposée. Si je n’avais pas été couché… sans doute que la foudre m’aurait touché. »
Le deuxième incident du genre s’est produit quelques années plus tard.
« Le curé de la paroisse Saint-Henri-de-Mascouche où je m’étais marié m’avait commandé des petits travaux. Incidemment, je lui ai fabriqué un grand fauteuil d’archevêque, imposant, décoré, qui doit être encore là aujourd’hui. Je travaillais donc au sous-sol de l’église, lieu où autrefois on déposait dans une sorte de crypte les curés décédés.
Un jour, il pleuvait des clous. J’avais laissé les deux portes ouvertes pour créer un courant d’air quand soudain un éclair en forme de boule de feu est entré, a frappé une tombe en lui faisant un grand trou au milieu, et est ressorti par l’autre porte en me frôlant dangereusement. »
Il poursuit son récit en disant qu’il s’est précipité tout tremblant, affolé, chez le prêtre. Il croyait que les curés décédés le pourchassaient de leurs… foudres.
Le bon curé, philosophe, inconscient sans doute de ce que Charles venait de vivre, lui a répliqué :
« Ne t’en fais pas, ils sont morts. Tu peux continuer ton travail. »
Il l’a donc frôlée, cette mort qui frappe à l’improviste. Il la porte aussi en lui par son frère décédé qui lui cause un chagrin qui l’habite encore.
Mais ces êtres disparus laissent-ils parfois, parmi nous, une trace de vie? Un esprit mystique peut y croire.
Charles évoque ce vieux château Montferrand en Normandie anciennement relié à une église, que Jacqueline de Torrès, son amie et agente en France, a acheté dans l’intention de le restaurer pour lui redonner sa gloire d’antan. Elle compte aussi le transformer en galerie d’art et en brocante.
Que dit-elle, en passant, de l’œuvre carsoniste qu’elle admire?
« Sur terre, en mer ou à vol d’oiseau, le maître des couleurs et créateur du carsonisme nous fait voyager dans un univers captivant... L’artiste dématérialise les formes avec un talent exceptionnel... Découvrir Carson, c’est dégager le chaînon manquant de l’encyclopédie de l’art contemporain... »
Revenons à notre sujet.
L’homme se souvient : « J’ai découvert là-bas dans les pierres, dans les briques, toutes sortes de signes, de figures. Mais le plus important s’est trouvé gravé dans le reflet d’une fenêtre, une empreinte, celle du visage mélancolique d’une religieuse. J’ai vu la croix accrochée à son cou. Elle devait passer des heures autrefois à regarder dehors. Si longtemps qu’elle a imprimé nettement son image blafarde et immobile, peut-être désespérée. Les gens du château que j’ai appelés en témoin l’ont vue comme moi! »
Attiré par ces phénomènes, intrigué, il aimerait croire à l’ange protecteur, à l’entité fraternelle, à l’âme qui erre avant de trouver la paix.
Qui est donc ce « moi » inconnu qu’il ne connaît pas encore et qui le hante?
Qui est donc cette inconnue postée pour l’éternité à la fenêtre, qui lui rappelle son âme inquiète face à la traversée du miroir?
Charles a vécu à plusieurs reprises des crises de mysticisme. Périodes extrasensorielles qui l’ont fait plonger dans l’invisible, plonger assez profondément dans des zones inconnues, y compris les siennes.
À Medellin en Colombie, un jour, il est entré dans une chapelle située dans la région Del Peñol.
En furie contre Dieu, il s’était mis à lui parler comme Fernandel en Don Camillo, dans le film du même nom. Aussi familièrement.
– Écoute-moi, Dieu… Pourquoi le monde va-t-il si mal?
C’était une de ces journées où la pauvreté et la souffrance lui semblaient insupportables, injustes.
Évidemment, Dieu ne répondit pas. Du moins pas avec des paroles. Est-ce que la volonté de Charles de vouloir recevoir un signe n’a pas été la plus forte?
Les traits d’un homme à la barbe touffue, dont l’apparence se comparait à un portrait de gentil-homme espagnol du peintre Vélasquez, il pouvait aussi ressembler à Christophe Colomb, sont apparus sur le mur, juste en haut de l’autel, au-dessus de la croix.
Charles s’est frotté les yeux, perplexe. Il croyait rêver. Tout en y voyant une réponse rassurante à une perpétuelle angoisse.
Il a décrit rétrospectivement l’apparition comme un homme au visage grave. « Il portait au cou, large sur sa poitrine, une croix de métal dont les branches étaient terminées chacune par trois boules de métal. »
Bouleversé, Charles a fait venir le curé qui ne voyait rien en dépit de tous ses efforts, mais qui lui dit :
– Le message s’adresse à toi personnellement.
« J’ai cru un moment qu’il pouvait s’agir d’un tableau ancien peint et caché sous des couches plus récentes de peinture. Avec la permission du curé, je suis donc monté sur l’autel pour voir de plus près. J’ai aussi fait des photos. Lorsque j’ai reçu les épreuves du laboratoire, le personnage paraissait clairement. Mais j’étais le seul à le voir… Le photographe à qui j’ai demandé un agrandissement de l’endroit sur le cliché où apparaissait l’homme barbu ne le voyait pas non plus… Quant à moi, je suis retourné à plusieurs reprises à l’église, et le contour du visage de l’homme subsistait toujours. Et puis un jour plus rien, l’image avait disparu. En même temps sur la photo et dans l’église. Pourquoi? Comment? Je ne me l’explique pas encore aujourd’hui. »
Durant les semaines qui ont suivi l’incident, lorsqu’il travaillait en atelier, il peignait d’abord la croix du personnage sur la toile. Ensuite, avec les couleurs, les spatules, il créait par-dessus un tout autre tableau. La croix disparaissait totalement.
« Bien des gens me faisaient remarquer qu’il se dégageait de mes tableaux une sorte d’aura religieuse, une puissance inexplicable. Quelle chose étrange... »
Plus tard, à l’occasion de l’un de ses voyages, dans un petit village cubain, il a rencontré une vieille femme manchote qui possédait le pouvoir d’analyser l’énergie des personnes à l’aide d’une flamme. Charles se trouvait dans un groupe prêt à vivre l’expérience. La vieille femme a versé de l’alcool dans un bouchon et a fait circuler la flamme parmi les participants. Dos à Charles, la flamme a subitement grandi au point de dépasser sa tête. « Elle suivait tous mes mouvements! » La vieille femme observait la scène avec un regard étrange, pendant que le reste du groupe s’extasiait devant le phénomène.
« Dans de nombreux pays, la sorcellerie fait partie de la vie. Ces gens vivent des expériences réelles, même si elles ne sont pas scientifiquement expliquées. »
Il se souvient d’avoir hypnotisé l’un de ses frères, à une époque où il étudiait cette technique. Il lui a fait joindre les mains, comme pour une prière, les doigts verrouillés. Mais l’heure passait, les doigts de son frère toujours pliés ne recevaient plus de sang et devenaient bleus! L’hypnotiseur en herbe ne savait pas comment les faire revenir à la normale, comment sortir son frère de cet état! Il a dû appeler son professeur à son secours!
« Il y a des risques à pratiquer l’hypnose et elle doit s’exercer dans un environnement professionnel et contrôlé; elle ne doit pas être laissée dans les mains de n’importe qui, dit-il par expérience. Pour arrêter les hémorragies, soulager les douleurs, par exemple chez le dentiste, elle peut être fort utile. »
C’est peu de dire que toutes les expériences de la vie, teintées d’audace et de mystère, l’intéressaient et continuent de le passionner. Il est vrai que, si la création peut faire émerger l’invisible, cet invisible peut prendre plusieurs formes.
Quelques années plus tard en Colombie, il a été victime d’un accident de plongée qui a failli lui coûter la vie et est à l’origine de quelques-uns de ses plus beaux tableaux. En effet, ils évoquent, au-delà du fond marin, l’univers immatériel d’une autre vie. Celle qu’il a traversée quelques instants éternels en compagnie des coraux.
L’éblouissement qu’il a vécu s’est imprimé sur des toiles en des éclats multipliés, mobiles. C’est de cette façon que les forces sous-jacentes transcendent le destin. Affronter un certain danger nous mène loin parfois…
« Rien ne saurait retracer quelle était la confusion de mes pensées lorsque j’allai au fond de l’eau », raconte Robinson Crusoé.
Et, comme ce dernier, Charles l’aventurier a été emporté par la vague qui l’a laissé sans souffle au-dessus des coraux sur lesquels il s’était blessé grièvement.
C’était aux Îles Rosario en Colombie. Plutôt mauvais nageur mais voyeur passionné des fonds marins en apnée, il avait décidé de se joindre à une équipe de biologistes marins en mission. Ils devaient aller examiner de plus près les langoustes dans le but d’en tirer des renseignements scientifiques. Charles y a vu une occasion unique de nager plus loin que d’ordinaire, en haute mer, pour aller admirer sous l’eau d’autres merveilles. Il allait courir sous l’eau d’autres dangers que la terre ferme lui avait jusqu’alors épargnés.
L’expédition des scientifiques devait durer une semaine, sur une île déserte, à prendre des mesures, à noter leurs observations.
Premier arrêt après leur départ à l’aube : une petite baie où la langouste abonde habituellement. Tout allait bien jusque-là. Les exigences physiques n’étaient pas encore insurmontables pour le piètre nageur. Palmes aux pieds, combinaison de plongeur, masque et tube, le voilà invincible.
« Après une heure passée dans la baie, on est repartis à la nage vers le large pour rejoindre notre île sur laquelle on devait ériger le campement. J’avais tellement envie de vivre ça! J’étais avec des gens d’expérience, intéressants. Évidemment, je ne leur ai pas dit que je ne savais pas bien nager, mais surtout que je n’étais pas en aussi bonne forme physique qu’eux. »
Une heure et demie à nager. Sur une mer d’encre, c’était encore faisable. Rencontrer le récif corallien où enfin Charles pouvait explorer des profondeurs nouvelles. « Des poissons merveilleux de toutes les couleurs et si étranges! Une eau de surface si claire! Et des profondeurs si limpides. »
Le spectacle était d’une beauté à couper le souffle, sans jeu de mots : il s’est enhardi, s’est laissé distraire par ses découvertes, a plongé plus profondément, s’est éloigné de ses compagnons.
Les scientifiques de leur côté étaient tout à leurs occupations d’analyses et d’observations.
Entre-temps, le vent s’était levé. Sournoisement. Sans préavis, les vagues ont commencé à grossir.
Entraîné malgré lui plus loin, ballotté comme une coquille de noix, déjà fatigué par la longue nage, il a eu du mal à contrôler son début d’épuisement. Les vagues venaient de toutes parts frapper la crête des coraux. Il s’est senti fouetté, cinglé par elles, de plus en plus violemment.
Une vague l’a alors porté, transporté sans ménagement directement sur le récif corallien. Il tentait de toutes ses forces d’échapper à ce piège liquide qui se refermait dans un tourbillon.
Tout s’est passé alors très vite. Il luttait contre la panique qui l’envahissait. Mais comment attirer l’attention de ses compagnons éloignés, se faire entendre à travers le vacarme des vagues?
Le bruit du vent était tout aussi étourdissant.
« Je suis alors monté debout pieds nus sur les coraux pour faire des signes désespérés aux hommes et les appeler avec tout ce qu’il me restait de voix pour couvrir le son terrifiant des vagues. »
Les hommes l’ont entendu, mais ils savaient que, s’ils s’approchaient trop près de l’infortuné, ils seraient eux aussi pris au piège du tourbillon.
« Ils me faisaient de grands signes, m’encoura-geaient à tenir bon, mais je ne pouvais pas me dégager », raconte Charles.
Et il s’épuisait peu à peu. Étourdi, assommé par chaque nouvelle vague qui le clouait sur place. Il évaluait mal la distance à parcourir jusqu’à ses compagnons. Il s’est senti perdre courage.
En même temps que son espérance prenait le large, l’attrait d’abandonner la lutte devenait plus fort. Combien de marins au cours de naufrages ont dû connaître cette sensation!
Par miracle, sa vigilance s’est accrue, son instinct de survie en même temps. Il s’est jeté à l’eau avec l’énergie du désespoir en nageant de toutes ses forces rassemblées pour s’approcher un peu plus des hommes aux mains tendues, des hommes qui hurlaient en lui lançant un ballon de sauvetage. Au même instant, une nouvelle vague violente l’a happé et fait remonter sur le corail.
Ce tourbillon qui l’emportait et l’enserrait lui a semblé une éternité. Il a cru cette fois qu’il ne s’en sortirait pas. Que c’était la fin, là au milieu des coraux et des poissons multicolores. Qu’il n’avait plus qu’à se laisser bercer.
Dans un ultime effort, une accalmie bienveillante de la vague, il a enfin réussi à s’accrocher au ballon. Les hommes l’ont soutenu jusqu’aux rives de l’île. Et là ils ont pu soigner ses blessures sérieuses aux pieds et aux jambes, en attendant la venue de l’embarcation qui devait les ramener sur le continent.
Il était sain et sauf, comme Robinson Crusoé le raconte :
« Enfin, après un dernier effort, je parvins à la terre ferme, où, à ma grande satisfaction, je gravis les rochers escarpés du rivage et m’assis sur l’herbe, délivré de tous périls et à l’abri de toute atteinte de l’océan. »
Depuis ce jour, pour Charles, la mer si familière, tellement séduisante, a laissé tomber son masque de bienveillance inébranlable. « Maintenant, je l’avoue, lorsque je suis au large, même à l’abri dans un bateau, et que je sais l’eau profonde, j’ai du mal à contrôler une certaine panique. »
Pourtant, malgré tout : « Ça valait le coup. C’est imprimé à jamais dans ma tête ce que j’ai vécu, mais surtout ce que j’ai vu. Aujourd’hui, je peux peindre des fonds marins sans autres images que celles qui sont gravées en moi. »
La Colombie. Une parenthèse de dix ans. Qu’est-ce que le destin pouvait bien vouloir lui apprendre par ses méandres sud-américains?
Il faut se rappeler pourquoi et dans quelles circonstances il a choisi de partir au loin pour continuer de vivre. L’éloignement n’est pas automatiquement la panacée au besoin de fuir son destin. Ni de fuir les autres, ni de se fuir soi-même.
Certes, il n’était pas question d’émigrer. Mais l’exil, même temporaire, peut être en soi une épreuve. La sociologue française, Perla Serfaty-Garzon, l’explique en ces termes :
« […] L’exil, non sous sa forme d’aventure romantique, d’ouverture à la diversité du monde, de l’âme et du cœur ou d’instinct du voyage, mais plutôt dans son sens d’errance imposée, subie, cet exil est calamité pure en ce qu’il exclut l’être de sa maison, c’est-à-dire de l’ordre des choses qui doit régir sa vie, le chasse et le coupe de son propre réel au profit du réel imposé par les contingences de l’itinérance. »
On l’a dit, les péripéties matrimoniales et autres duraient depuis fort longtemps. Une simple mésaventure dégénérait en drame, un petit problème devenait une montagne. L’acteur au milieu de la scène ne savait plus son rôle, cloué par le trac, aspiré par l’abîme qui s’ouvrait devant lui. Rétrospectivement, s’il y a lieu d’en sourire et de mettre cela sur le compte d’une mauvaise farce de la vie, on se rend compte qu’elle lui a coûté très cher. Il avait complètement perdu le contrôle de sa vie, engouffré dans le remous.
Les liens étaient rompus irréversiblement avec presque tous les membres de sa famille, sa maison appartenait désormais à son ex-épouse, son fils aîné devenait de plus en plus difficile; désespéré, à bout de souffle, il a vu le ressort de son énergie se briser.
Il lui restait tout juste assez pour partir loin, à jamais, qu’on l’oublie, qu’on le laisse en paix.
Sur le conseil d’amis – heureusement qu’il y en avait quelques-uns fidèles au poste –, par réflexe de survie, dans un état second, il a demandé à un employé d’une agence de voyage de lui trouver une place en avion; n’importe où, sans préférence de lieux et pas trop cher. Si possible dans un endroit de soleil et de mer. Il pensait au Mexique.
« Comme à la roulette, dit-il. Voilà. J’ai fait tourner le globe terrestre, j’ai fermé les yeux. J’ai mis mon index sur l’Amérique du Sud, sur la Colombie plus précisément. » Les dés étaient jetés.
Il ne se souvient pas du voyage en avion, ni de ce qu’il a emporté, sachant à peu près où il devait se rendre, sans s’en soucier outre mesure. Tout valait mieux que de rester au Québec, et de sombrer avec son désespoir.
« Je partais ou je mourais. »
Lessivé, le cœur tordu, les yeux rougis, le voilà dans un avion qui atterrit, plusieurs heures plus tard à Cartagena (Carthagène), une vieille ville fortifiée aux plages paradisiaques, d’un peu plus d’un million d’habitants.
La chaleur à sa descente d’avion était accablante, en dépit d’une légère brise venant de la mer. Une chose lui souriait pourtant et était comme une caresse dans son cou, sur son visage : à sa descente d’avion, cette brise, cette chaleur ont un parfum exotique, lourd et capiteux qu’il respire à pleins poumons. Parfum d’oubli et d’espoir.
Il s’est glissé dans ce parfum, comme dans un léger duvet, et accordé nonchalamment son pas, les battements de son cœur au rythme de cette ville étrangère.
Il était épuisé. Corps et tête accrochés à la même bouée. Quels ont été ses repères? Les souvenirs qu’il tente de faire revivre aujourd’hui ne sont plus très clairs. Il faudrait une séance d’hypnose. Il ne se rendra compte de la profondeur de sa dépression que plus tard, lorsqu’il commencera à émerger de son marasme.
Il s’est abandonné sans force à cette maladie de l’âme. Le corps et l’esprit prostrés. Incapable de se lever, de mener une vie normale, d’affronter le monde. Durant six mois, il a dormi de ces sommeils peuplés de rêves abracadabrants d’où il sortait plus épuisé encore.
La solitude, une langue étrangère, des mœurs nouvelles; il aurait pu dériver, délirer. Ces éléments ont provoqué l’effet contraire. Marcher doucement sur la plage, réfléchir, et surtout être loin (enfin!) de toute persécution, car personne ne savait où il était, l’ont aidé à remettre en place les morceaux éparpillés de lui-même.
– Dieu merci! Enfin, je suis tranquille.
Doucement, avec la mer guérisseuse à ses pieds, dans la rumeur d’une ville bon enfant, inspiré par sa joie de vivre, entouré de gentillesse, il s’est senti ragaillardi.
Il pouvait répéter en sourdine ce poème d’Émile Verhaeren :
« La mer! La mer!
La mer tragique et incertaine,
Où j’ai traîné toutes mes peines. »
Les jours passaient dans une sorte de paradis terrestre où le ciel était beau et les filles, belles. À 33 ans, plutôt agréable comme homme, nimbé de cette aura de mystère qui l’entourait, il séduisait sans peine, touchait le regard et le cœur de jeunes femmes qui pouvaient difficilement lui résister. D’autant plus qu’il portait dans ses yeux cette tristesse que bien des femmes se mettent en tête de consoler! Quelques jours à peine passés en plein soleil et il arborait en plus un teint bronzé, de bonne santé.
Il lui a fallu du temps pourtant. Sa vitalité avait du mal à reprendre sa pleine capacité. Mais cette faiblesse qui s’exprimait par un pas indolent sur la plage, une voix douce pour parler un espagnol
approximatif, mais touchant pour tenter d’expliquer ce qu’il peignait, ce qu’il vivait, furent autant d’atouts irrésistibles!
« L’important était de me retrouver, me soigner, récupérer ma vie, s’empresse-t-il de préciser pour ne pas qu’on pense qu’il vivait la dolce vita.
« J’apprenais à aimer ce coin du monde qui pansait mes plaies. »
Cet attendrissement sur lui-même s’est répercuté sur ceux et celles qui l’ont approché avec compassion.
« Je cherchais plus à être aimé qu’à m’aimer moi-même. Il faut être bien avec soi pour entretenir une relation sérieuse. »
Quel est le meilleur remède à la perte de sens de sa vie, sinon l’amour? Ou son illusion, le temps qu’il faut à l’âme pour reprendre goût à la vie.
« Que l’on ne confonde pas : les acteurs meurent de n’être pas loués, les vrais hommes de n’être pas aimés », disait Nietzsche.
Et puis, il y eut cette jolie histoire. Charles ne parlait pas espagnol, mais il la trouvait si belle! Elle ne parlait pas du tout français, mais elle le trouvait si… exotique.
« On a vécu trois ans à se comprendre sans se parler. Quand on a commencé à se parler, je me suis rendu compte qu’on ne se comprenait plus! »
Sa fille Mélissa est née de cette relation qui aurait dû rester au stade d’un beau souvenir amoureux, pour la raison qu’il s’inscrivait dans un contexte de tourmente.
Plus tard, Charles aurait bien aimé que la petite famille s’installe au Québec. Mais la tentative a tourné court. Aujourd’hui, Mélissa, qui est adolescente, vit avec sa mère aux États Unis. Le plus souvent possible, car il lui est très attaché, il la fait venir ici ou il va la voir.
Les méandres de sa vie amoureuse et familiale ne l’empêchaient pas de peindre, d’installer son chevalet partout où l’inspiration le tenaillait. Il commençait à y voir plus clair, à laisser entrer en lui des émotions nouvelles.
Sa peinture colombienne fut marquée par l’environnement, bien sûr; éclats fondants de cette lumière particulière de l’Amérique du Sud; exubérance de la faune, de la flore, gestes humains commandés par des siècles d’habitudes, palenqueras, etc. Mais elle fut aussi marquée par son état d’âme, une période de sa créativité où la toile a absorbé du noir d’abord avant d’être vaincue par la couleur. À un journaliste du Journal Universal de Colombie qui le lui faisait remarquer il a déclaré : « Dans ce qui est noir, il y a ma tristesse. »
Il ajoute : « C’est étonnant de voir ce que l’inconscient peut nous faire accomplir. »
Picasso disait : « Certains transforment le soleil en point jaune; d’autres transforment un point jaune en soleil. » On sait combien la présence du soleil dans un dessin d’enfant trahit ses états d’âme.
Carson n’a jamais cessé de rendre hommage au soleil, à la lumière, à les laisser se frayer un chemin dans son âme. Il a travaillé intensément pendant cette période de défaillances. « Peindre m’a aidé à me libérer. Au début, j’étais dans l’abstraction totale. Au fur et à mesure que je prenais du mieux, les choses devenaient moins abstraites, plus définies. Ma démarche suivait le cours de ma guérison. »
Certains tableaux créés avec une force d’amour et un élan de tristesse particuliers sont plus difficiles à quitter que d’autres. Ce qu’il a réussi à transcender et ce dont témoignent les œuvres finies lui sont comme des enfants. À la fois géniteur et père spirituel d’un tableau peint dans des moments de vie intense qui lui rappellent un temps suspendu, quand il a retrouvé ses esprits, rassemblé les pans de sa vie, il aimerait bien pouvoir conserver ces témoins. Mais Carson est tout sauf indifférence, tiédeur. Au cœur d’une tourmente ou dans la mollesse des vacances, il vit intensément. Il raconte l’un de ces moments bénis de sa vie : durant un long mois, dans les années 1990, il a vécu au Parc Taïrona dans la plus grande solitude. C’était une véritable forêt tropicale laissée en friche, protégée, à la fois mystérieuse et dense.
Six ans plus tard, il a constaté au cours d’une autre expédition que ce site paradisiaque avait subi des transformations, l’empreinte désolante du passage de la civilisation. « C’est déplorable, dit Carson, de voir à quel point, dès que les touristes affluent, les lieux uniques sur terre, tels que les grottes de Lascaux, les pyramides d’Égypte, Machu Pichu, etc. sont transformés pour le pire. »
Au Parc Taïrona, à cette époque, il pouvait vivre ce plaisir unique d’être l’un des rares humains à en fouler le sol. Malgré ses précautions, tout en mémorisant de vagues repères, il s’est tout de même égaré dans cette jungle. La rêverie l’occupe en général tout entier dès qu’il se trouve dans un endroit qui l’inspire. Cela s’était déjà produit en expédition dans la forêt d’ici. Il a ressenti le même pincement au cœur qu’alors devant le fouillis des arbres et des buissons, le silence, l’impression de tourner en rond sans espoir d’en sortir.
Son regard s’arrêtait à la frontière de la végétation et lui cachait le paysage. Tout en marchant, il a eu soudain l’impression que des pierres posées sur le sol prenaient la forme d’anciennes fondations. Il lui a semblé même apercevoir, à travers les arbres, plus loin, le sol nivelé comme une plateforme.
Il fut plus attentif, tous ses sens en alerte. Chacun de ses pas qui martelait le sol provoquait un bruit étrange : ploc, ploc...
Une pluie diluvienne imprévue dans une région où il ne pleut presque jamais créait des poches d’air dans le sol. Cette terre ramollie, ces cavités où son pied s’enfonçait cachaient des trésors inestimables. Il n’avait qu’à se pencher pour cueillir ce qui émergeait de plusieurs siècles d’enfouissement : de minuscules figurines intactes, une flûte, des bols, divers objets de la vie courante d’une époque révolue. Charles a dû prendre mille précautions pour saisir les objets et les débarrasser de leur gangue de boue. Puis, il les a fait sécher dans un abri de fortune qu’il a construit, les a emballés, un à un, délicatement. Il avait en main des vestiges de l’époque précolombienne!
La forme des crânes des figurines était tout à fait inusitée. « Ce sont des petites répliques en terre cuite de crânes de Mayas, ces crânes géants, déformés, allongés, de forme ovoïde exagérée. »
Les paléontologues y voient une signification religieuse, une forme d’identification à un groupe ethnique ou social, et la déformation aurait été pratiquée sur des têtes d’enfants, à l’aide d’objets qui comprimaient le crâne.
C’était un autre monde, un autre temps. L’espace de plusieurs jours donnait à Charles l’illusion de vivre un rêve de jeunesse : être archéologue. Ce passé culturel témoin d’une vie très lointaine l’atteignait en plein cœur. L’âme d’un peuple venait à sa rencontre. Comment rester insensible face à cette manifestation artistique naïve et pure?
Il s’est perçu sans peine comme un messager. Et la grande question qu’il se posait : « Comment moi, venu du froid, à des milliers de kilomètres de distance, comment moi, ai-je pu avoir accès à ces secrets perdus? »
Et puis, il a enfin retrouvé sa route après avoir épuisé ses réserves alimentaires.
Cette pluie violente qui s’était abattue sur la région pendant une semaine a provoqué en lui une furieuse envie de reprendre ses pinceaux. Dans cette sorte d’enfermement forcé, il a retrouvé le cocon bienfaisant de son imaginaire.
Finalement, le courroux qui avait déchaîné l’océan s’était calmé. Les noirs, les bruns, les gris, l’écume trouble des vagues cédaient la place à une mer enchanteresse, retrouvant ses armes de séduction : les verts, les bleus, les blancs et, en prime, des couchers de soleil éblouissants, touchants, magiques.
Carson a peint là une étude de tableaux intitulés simplement : Parc Taïrona, qui témoignaient de la métamorphose de l’océan, depuis les restes de sa colère noire jusqu’à l’embrasement du ciel. À mi-chemin entre la démesure et la poésie. Ces tableaux expriment mieux que des mots la sérénité, la spiritualité, la foi en la vie retrouvée.
Une image est revenue plusieurs fois au cours de ce récit. Une projection de colère comme un volcan qui se réveille : « Je te le dis, tout est moins sauvage dans la jungle là-bas que dans la jungle d’ici qui te transforme souvent en sauvage... »
L’hippocampe, petit poisson marin, à la fois attendrissant et fabuleux, menacé par des pêches intempestives, est son préféré dans le monde des animaux. La tortue suit pour sa longévité et sa carapace. Ce reptile qui transporte sa maison sur son dos le fascine.
À Carthagène, il a connu diverses expériences de gîtes. Parfois chez une maîtresse, parfois à l’hôtel. La vie là-bas était relativement bon marché. Sur le plan de l’organisation domestique et quotidienne, comment se débrouillait-il?
Ses peintures le suivaient partout dans des rouleaux de carton, des valises. À un certain moment, elles ont été suffisamment nombreuses pour qu’il songe à une exposition.
Que faire d’autre pour gagner son pain?
Il peignait dans sa chambre de l’hôtel Caribé, un établissement cinq étoiles. Comme un artiste est rarement millionnaire, il est allé rencontrer le gérant pour lui proposer un troc : une chambre pour un tableau. Ce fut marché conclu, car le gérant était le premier admirateur de ses œuvres. Fier d’héberger un artiste de réputation internationale, on lui a rapidement proposé d’exposer ses travaux dans le hall de l’hôtel.
Ce fut le coup d’envoi d’un engouement populaire qui ne s’est jamais démenti. Les journalistes des médias locaux ont rédigé de nombreux reportages, les critiques d’art ont fait leur travail dans les jours suivant le vernissage. Les articles étaient coiffés de titres accrocheurs : « Le pouvoir des couleurs de Carson… La lumière des planètes… Créateur au volcan explosif… »
Ces commentaires dithyrambiques ont attiré beaucoup de visiteurs à l’exposition et les tableaux se sont fort bien vendus. « Leur sensibilité a été touchée, je crois, explique Carson. Il ne faut pas oublier que la couleur fait partie de leur univers familier : que leurs festivals eux-mêmes sont des hymnes à la couleur exubérante. Peut-être que ma peinture les rejoignait au-delà du fait que j’étais originaire d’un pays de neige. L’art est sans frontières. »
À compter de 1994 et durant les années qui ont suivi, la réputation du peintre n’a fait que grandir et il est devenu l’une des vedettes de la vie culturelle de sa ville. Les expositions et les événements auxquels il participait noircissaient son agenda.
Invité d’honneur au 13e Festival d’Arte del Caribe, puis à la Casa de Valdehoyo, à la Galerie Cartegena Artes.
À l’école des Beaux-Arts de Carthagène, il a montré ses tableaux aux étudiants qui étaient curieux de connaître de nouvelles techniques picturales et de se familiariser avec elles. Carson a beaucoup aimé cette expérience dont il conserve un souvenir ému. « Il ne s’agissait pas d’enseigner à ces jeunes artistes le carsonisme, mais plutôt de les aider à se faire confiance, à révéler leur talent, leur orientation artistique; de leur prodiguer quelques conseils et manières de faire, notamment en matière d’ombre et de lumière. »
D’autres expositions ont suivi dans diverses galeries. À la Galerie d’art Autopista dans le secteur del Poblado à Medellin, l’exposition organisée par le Dr Hildebrando Mejia a donné lieu à de nombreux reportages. Il se souvient qu’au cours d’une entrevue radiophonique, le journaliste malicieux l’a invité à dire quelques mots en français à l’intention des belles Colombiennes. Surpris, intimidé, Charles est resté muet. L’animateur a alors repris le micro pour conclure en riant que « l’artiste devant tant de belles demoiselles en perd... son français ».
Il s’est lié d’amitié avec la galeriste de Cartagena Artes et a accepté d’investir personnellement pour l’aider à donner à sa galerie un statut international: un décor plus sophistiqué entre autres.
« Carthagène n’est pas une ville qui permet à un peintre de vivre convenablement, explique-t-il. On a juste ce qu’il faut pour manger et dormir, car la période touristique est courte; deux à trois mois. La ville s’endort après. »
Il évoque ici l’un des événements les plus spectaculaires en matière d’art dont il fut l’instigateur.
Dans la vieille ville de Carthagène, bordée de fortifications, est situé l’ancien monastère de Santo Domingo jouxtant la cathédrale. Cette presqu’île est un lieu mythique qui a vu naître des artistes célèbres.
L’espace est immense, impressionnant, couronné d’un puits de lumière. Le monastère désaffecté, la galerie, le jardin intérieur, voilà une atmosphère et un lieu propices à une grande exposition, se disait le peintre en quête d’un coup d’éclat. Un lieu où l’art et le spirituel pouvaient cohabiter et inspirer les visiteurs.
« Une atmosphère accueillante, intime qui invite à observer, à méditer devant chacune des œuvres qui comblent les murs des couloirs; à nous sensibiliser à la variété d’ombres, de couleurs, de textures et de manières », écrivait le critique du El Universal de Carthagène.
« J’ai réuni les meilleurs peintres colombiens, raconte Charles; il y avait près de 400 tableaux pour l’exposition. On a aménagé les lieux d’une manière théâtrale : des fauteuils Louis X1V dans l’entrée, flanqués de deux authentiques soldats de la garde colombienne. »
À l’entrée du cloître, une nature morte peinte à quatre mains : celles de Charles Carson et du peintre Marco Mejia.
Tout au long du parcours, des œuvres de Mejia, Lalemand, Bedoya, Serrano, San Miguel, Matius, Posada, Gutiérrez, Triana, Cerna Leon, Castellanos et plusieurs autres.
Le but de cet exercice spectaculaire : faire bouger les choses, créer un événement utile et significatif.
Le jour de l’an 1998 a été mémorable. « Il y avait des dizaines de milliers de personnes dans les rues selon la tradition; habitants et touristes. L’achalandage à l’exposition a été incroyable. »
C’est aussi à cette occasion qu’il fait la connaissance du peintre Botero. L’artiste présidait le vernissage de l’une de ses grandes sculptures de bronze installée sur la Plaza Santa Domingo.
La rencontre des deux hommes a eu lieu au restaurant Pacos que Carson avait décoré à sa manière quelques semaines plus tôt. Il avait proposé à la propriétaire de peindre sur du verre épais qui, une fois posé à l’envers sur les tables, était du plus bel effet. Le carsonisme s’offrait ainsi aux regards des affamés.
La technique lui avait donné du fil à retordre. Il devait penser à l’envers et, contrairement à sa manière de faire habituelle, appliquer ses couleurs au clair à l’obscur, créer l’image inversée pour un effet miroir. Le résultat en valait l’effort, il en était très fier.
Il se souvient de l’émotion qu’il a ressentie ce soir-là, quand, autour de tables bien garnies, le bon vin déliait les langues, ramollissait les cœurs, rassemblait les esprits brillants.
« On était quelques-uns à discuter ferme. Botero était là, simplement au milieu de nous, près de moi, sans façon. Ce fut une soirée magique! On parlait d’art, bien sûr, on échangeait nos points de vue en se regardant droit dans les yeux comme des vieux amis. C’était fort animé! »
Un seul regret : « Personne n’a fait de photo pour immortaliser cet instant! Et nous, on était tellement absorbés par nos discussions! » En espagnol, naturellement.
Ce qui est différent là-bas, souligne Carson, que l’on soit sous le soleil de midi ou dans la tiédeur des nuits, c’est la complicité et les échanges entre les artistes. Des conversations passionnantes, des discussions à n’en plus finir sur les différents courants de l’art, sur l’état du monde.
Leurs points de vue se comparaient ou se rejoignaient, mais les échanges restaient respectueux et purs d’intentions; l’écoute de l’autre, même les divergences d’opinions, tout participe à tisser des liens entre eux.
« On devient des camarades, peu importe le statut de l’artiste, qu’il soit célèbre ou non. »
C’est ce qu’il croit le plus difficile à retrouver ici. Cette froideur. Cette indifférence. Cette méfiance que les artistes et les galeristes entretiennent entre eux. Critiquer ou démolir est la règle. Ils se privent ainsi, selon lui, d’échanges intellectuels qui pourraient au moins les aider à se sentir moins isolés. « C’est un tel plaisir de partager nos recherches, nos expériences, de parler de nos difficultés entre nous, sans craindre d’être imités ou enviés! » Les artistes redoutent-ils les débats qu’ils jugent stériles? Les jugements de valeur sur tel ou tel style de peinture?
Carson a concentré la grande partie de son énergie organisatrice et créatrice sur Carthagène, puisqu’il habitait cette ville depuis son arrivée en Colombie. Ce qui ne l’a pas empêché évidemment d’exposer ailleurs selon les offres qu’on lui a faites : au Musée d’art moderne de Bogota et à Medellin. L’exposition dans cette ville en particulier est restée gravée dans sa mémoire. Elle s’est tenue à l’hôtel Dann Carlton où il a séjourné durant cinq mois en compagnie de son représentant artistique, John Acebedo.
L’exposition a donné lieu à une grande effervescence médiatique : entrevues dans les journaux, reportages télévisés. Le soir du vernissage, une quinzaine de galeristes parmi les plus importants du pays étaient également présents.
Le jour même, le journal Le Colombien annonçait l’événement : « Aujourd’hui, à l’hôtel Dann Carlton, l’artiste canadien Charles Carson présente ses nouvelles œuvres. On a pu voir ses peintures, l’an dernier, à la galerie Arte Autopiste; il est de retour avec ses couleurs particulières et sa technique unique qui, selon les critiques internationales, est un nouvel “isme”, le carsonisme. »
L’artiste avait complété l’accrochage des tableaux, veillé aux derniers préparatifs. Il est retourné à sa chambre pour faire un brin de toilette et changer de tenue. Le vernissage n’était prévu qu’à 19 h 30.
Le téléphone a sonné dans sa chambre à 19 heures.
Une voix affolée au bout du fil :
– Qu’est-ce qui se passe? a demandé Carson.
– Monsieur Carson! Vous devez venir! Il n’y a déjà plus de place pour bouger en bas. Il faut ouvrir les portes des salles, c’est urgent.
« Lorsque la porte de l’ascenseur s’est ouverte, je ne pouvais pas sortir tellement la foule était compacte. Peux-tu croire cela? J’étais devenu un héros, porté par une foule chaleureuse d’au moins 1 500 personnes! »
Après un moment d’hésitation et de panique, il s’est ressaisi. « Les gens me prenaient dans leurs bras, certains en pleurant; on distribuait des bouts de papier pour que je signe des autographes. Comme une rock star! Tout cet amour! Je me sentais choyé. » Du beau monde, un bon buffet, des roses partout. « Medellin recevait un maître avec affection et reconnaissance. J’en ai été bouleversé. »
Il s’est senti un authentique conquistador!
En 1998, à Medellin, il s’est offert un plaisir à la fois esthétique et charnel. Il a peint sur des tissus au mètre qui ont été transformés, pour la plus grande joie de tous, en maillots de bain pour femmes. Une collection réjouissante, présentée par des mannequins sur la passerelle, et qui, on s’en doute bien, a connu un succès fou!
En 1999, il a été l’invité d’une exposition solo à la Galerie d’art Montoya, Medellin. Cette galerie était spécialisée en décoration de maisons huppées. La galeriste, pour mettre en valeur les tableaux, n’hésite pas à les montrer dans des encadrements ornés de feuilles d’or et de moulures délicates. Au moins 400 visiteurs ont assisté au vernissage. Cette même année-là, il a exposé à la Galerie d’art Betty.
Le culte de l’artiste n’a cessé de grandir durant ses années là-bas. Des traces tangibles de l’affection et de l’admiration y sont toujours présentes.
Si vous descendez à l’aéroport de Carthagène, admirez le grand tableau de 4 sur 3 mètres, intitulé : El caballo de mar, (Le Cheval de mer) qui accueille les voyageurs.
Pour réaliser cette œuvre sans lieu de travail de bonne dimension, l’artiste a dû faire preuve d’ingéniosité. Il a construit une structure en bois sur laquelle il a collé la toile, directement installée sur le plancher. Ensuite, il a fait monter des échafaudages à environ 45 cm du sol. De cette hauteur, il lui était difficile de visualiser la perspective, ce qui l’obligeait, dans sa création, à procéder graduellement tout en ne perdant pas de vue l’œuvre entière. « Michel-Ange, quand il peignait les plafonds de la chapelle Sixtine, avait un meilleur recul face à son œuvre, je crois », dit Carson.
Ces contraintes n’ont apparemment pas nui au résultat final qui fut, selon les témoins, spectaculaire. « J’ai apprécié la décision des autorités aéroportuaires qui ont interdit de photographier l’œuvre afin de protéger les droits d’auteur, bien sûr, mais aussi pour éviter la lumière des flashes, nuisible à l’œuvre à long terme. »
Par ailleurs, à l’intérieur de l’église de Santo Domingo classée patrimoine mondial de l’humanité, se trouve une murale d’inspiration religieuse, qu’il a intitulée : Yo hice lo que tù querias. (J’ai fait ce que tu voulais).
Et, comme si ce n’était pas suffisant, la société aéroportuaire et les Carthaginois ont érigé en son honneur, et en témoignage de reconnaissance pour son apport artistique en plein cœur de leur ville, une statue de bronze grandeur nature, œuvre du sculpteur colombien, Mario Rodriguez.
Carson a suivi toutes les étapes de sa réalisation, depuis sa conception. Il s’est prêté au moulage de son visage, utilisé son sarrau, ses pantalons, ses chaussures, pinceaux et spatules véritables. Tout a été moulé pour être ensuite coulé dans le bronze à la manière des sculpteurs d’autrefois, avec un sable particulier dont l’objet est entouré, avant de créer le moule de plâtre.
Le sculpteur a d’abord fabriqué un modèle en fibre de verre pour ensuite le sectionner et créer des moules pour chacune des sections de la sculpture. Une fois les coulées de bronze terminées, elles ont été assemblées, soudées, polies et patinées en vue de reconstituer la pièce finale. Tout cela exécuté à la chaleur intensifiée par un soufflet, comme le veut la tradition de la lignée des sculpteurs de père en fils de ce pays. Un maître artisan de la dinanderie a assisté l’artiste.
Le maestro Carson entrait dans la légende.
Louis Bruens s’est rendu en Colombie en compagnie de sa femme Caroline afin de rendre visite à Charles, se rassurer sur son état de santé, son installation, sa vie et son développement artistique.
De retour au Québec, il n’a pu résister à l’envie de faire part aux lecteurs de Magazin’Art de ce qu’il avait vu là-bas.
« […] quel ne fut pas notre étonnement de découvrir à l’aéroport une immense murale de notre ami, un tableau splendide... qui retient immédiatement l’attention des voyageurs, car il est situé dans le hall de l’aéroport de Carthagène…
[…] quelques jours plus tard, écrit-il, ébloui, nous tombons face à face avec un bronze grandeur nature de Charles. Serait-il devenu à ce point célèbre?
[…] oui, quand nous découvrons à l’intérieur de la belle église Santo Domingo une murale religieuse que le curé est très fier de nous montrer. »
Dans l’atelier du peintre, l’on peut admirer les plus beaux fonds marins que l’artiste ait produits à cette époque. Les visiteurs québécois sont fiers de lui.
Aucune inquiétude à y avoir donc : la Colombie est son royaume, il finit par vivre comme un prince, fenêtres grandes ouvertes.
Chez lui, dans sa maison de Carthagène, il jouissait d’une belle installation qui avait ses lacunes toutefois. Comment peindre dans un paradis où il se sentait, pour reprendre ses termes, « enfermé, un bandeau sur les yeux? » En pleine ville, sans que son regard puisse s’échapper plus loin que les murs! Il faut tout ouvrir! Il faut respirer!
Il ne manquait pas d’audace, comme toujours. Il a décidé d’acheter le toit de son immeuble à condominiums pour y construire une terrasse. Avec l’accord des autres propriétaires moyennant une compensation financière.
Il fallait le faire! « Sans architecte, sans ouvrier spécialisé, le système D. Quelle charge pouvait supporter le toit? A-t-on besoin de structures métalliques? Il a fallu que les ouvriers montent cinq étages, chargés chaque fois d’une chaudière de cinq gallons de ciment portée sur l’épaule. Il y en a eu un millier! Ciment brassé à la pelle en toute urgence! Le toit était ouvert aux intempéries, il fallait faire vite!
Finalement, la récompense. Un atelier superbe digne d’un grand peintre!
« Du haut de son atelier, l’aile d’un avion souffle un nuage de couleur pourpre et dans l’air flotte le parfum des fleurs qui anime son jardin de rêve enchanté... Son atelier a l’aura des Caraïbes. Un hamac de San Jacinthe flotte au vent comme si l’arc-en-ciel était resté en suspens dans sa maison. Les fleurs aux couleurs exubérantes illuminent son jardin : les mussaendas endormies vers la fin de l’après-midi, les trinitarias à la couleur orangée, les cayenas, fleurs rouges d’un seul jour, les campanulas jaunes qui grimpent en cherchant le soleil... », écrivait poétiquement Gustavo Tatis Guerra, journaliste au Journal Universal, à la suite d’un reportage chez l’artiste.
Un escalier en colimaçon lui permettait de franchir ses deux étages à toute heure du jour et de la nuit et de retrouver un jardin capiteux et exubérant. Il profitait du ciel étoilé, de la brise du soir, bien installé dans un hamac indispensable au farniente, pour laisser libre cours à son imaginaire, laisser couler les heures, mesurer son bonheur.
La base de sa table de travail était une volumineuse racine d’arbre. En dessous, le tapis était en peau de vache. Des éléments « naturels » en pièces détachées. Une atmosphère de jungle où Tarzan pourrait évoluer à sa guise.
Un sens certain du décor, de la mise en scène, sans contredit. Objets récupérés, plantes gigantesques dans tous les coins. Afin de parachever cette atmosphère, il n’hésite pas à l’avouer : « J’ai peint aussi des paysages sur les murs. »
Immense terrasse, la mer bleue à l’horizon et que son regard s’y perde, voilà le rêve devenu réalité. Il habitait sa vie avec une ardeur d’enfant choyé.
La vie était belle sans trop de contraintes, sauf celles qu’il se créait lui-même. Sur le plan personnel, il menait une existence compliquée de conquêtes, de passions. Il a cultivé le risque, une certaine forme de danger.
Après la relation avec la mère de sa fille, il en a entrepris une nouvelle avec une autre jeune femme avec qui il a joué le bel indifférent. Durant quatre ans! Le chat et la souris. Elle rêve du grand amour, de conquérir cet homme qui n’était pas prêt du tout à s’engager.
Impatiente, finalement lassée, elle l’a quitté un beau matin pour un Américain plus conciliant qui lui promettait mer et monde et en premier lieu de lui faire quitter le pays. Installée depuis aux États-Unis, elle a complété des études en psychologie.
Charles est à même de comprendre mieux que personne l’envie de fuir, de faire sa vie ailleurs.
Cette humiliation, ce rejet sont toutefois, contre toute attente, plus difficiles à accepter.
Encore fragile moralement, il a du mal à vivre l’abandon et découvre alors en lui des défauts qu’il ne connaissait pas : méfiance, déception, jalousie.
Le bel indifférent se rebiffe. « Je crois que je l’aimais plus que je ne l’avouais », confie-t-il pour sa défense. Il n’a pas su cette fois-là rester digne dans l’échec amoureux.
Abondantes larmes versées, des mots troubles jetés en vrac aux amis qui acceptaient de les entendre; des moments d’espaces vides entre le cœur et la raison. Un sac de nœuds aux cordes enchevêtrées.
Suivent des excès en tous genres pour se sentir vivre, pour aussi de temps en temps anesthésier la douleur.
« Je suis gai! Je suis gai! Vive le vin et l’Art!... », s’exclamait Nelligan.
Le temps a fait son œuvre; l’échec amoureux lui en a appris beaucoup sur lui-même. Il vit maintenant avec une sorte de sagesse nouvelle qui prend le pas sur la déraison : « Je suis aujourd’hui ce que je suis, dit-il, avec mon bagage personnel. » Il veut faire comprendre que, maintenant, on ne le reprendra plus à s’emporter de cette manière. Il sait reconnaître ses forces mais aussi ses faiblesses.
L’idée de rentrer au pays, de revenir chez lui retrouver ses racines, commençait toutefois à le hanter.
Des éléments autres que les déconfitures sentimentales s’ajoutaient à cette réflexion. « Carthagène est une ville attachante d’une belle et douce qualité de vie. » Mais il reconnaît qu’au-delà des apparences, toutes les grandes villes de tous les pays du monde ont leurs travers.
Il y a surtout, dans ces villes, des individus prompts à repérer les proies faciles, les sensibles, les trop généreux. Il y a partout des arnaqueurs.
L’anecdote qui suit est assez éloquente à ce sujet. Il avait en sa possession un collier composé d’une émeraude en forme de poire de trois carats, sertie de multiples diamants. Évalué par le bijoutier Birks de Montréal à 42 500 $. Il comptait échanger le collier contre une voiture à son arrivée en Colombie.
En Colombie, le troc fait partie d’une manière d’agir en affaires qui convient bien à Carson. « Le gars a pris le bijou, m’a remis l’auto; on a rempli les papiers, apposé les signatures, tout le tralala. Mais j’ai finalement appris qu’il n’avait pas payé l’auto et qu’il n’en était pas le propriétaire. On est venu la saisir! J’ai perdu du coup et un collier et une auto! »
Un avocat? « C’est peine perdue dans un pays comme la Colombie. »
Il n’est pas fier de s’être fait berner comme un novice.
Mais c’est l’histoire de sa vie. Une personne passe près de lui en pleurant et il se laisse attendrir. Il est prêt à tout pour venir en aide à un père de famille soi-disant dans la misère.
Un autre exemple? Un pauvre homme qui perdait son sang, apparemment d’une blessure au ventre, s’approche de lui, implore sa générosité. Il refuse d’aller à l’hôpital. La vue de ce sang secoue Charles qui délie sa bourse une fois de plus.
C’est plus tard qu’il découvrira la supercherie : sang et tripes de poulet cachés sous la chemise du brigand.
Un autre individu se pointe devant lui avec deux bébés perroquets. « Deux magnifiques spécimens aux couleurs flamboyantes, des petites merveilles à seulement 50,00 $ chacune. Le grand-père de Mélissa, vétérinaire à Carthagène, lui dévoile le scandale. Les deux malheureux oiseaux avaient été peints avec des encres toxiques qui les ont fait mourir deux semaines plus tard. « Je dois reconnaître qu’il s’agissait là d’un travail artistique de haute qualité », dit Charles, encore ému par cette sordide histoire.
« Combien de fois me suis-je fait berner par des mendiants convaincants? Je tombe dans le panneau chaque fois. Mais je dois dire que j’admire leur talent de comédien! Que ce soit là-bas ou ici, le scénario se répète.
« Je suis trop sensible aux gens, trop pressé de vouloir les aider », reconnaît-il.
Il ne semble pas vouloir priver son existence de l’excitation de la séduction et de l’amour. De tous les leurres, de toutes les illusions rattachés à ce dernier. Une fois qu’il est pris au piège amoureux, il peut tout donner et tout perdre. C’est sans doute le prix qu’il consent à payer pour tenir éloignés la solitude et le vide.
« Pourtant, j’aime bien ma solitude. » Est-ce une autre contradiction? « La solitude est essentielle en soi et il est primordial de la préserver. Mais je ne crois pas qu’il y ait incompatibilité entre une vie de couple heureuse et la solitude nécessaire au processus de création. »
« J’ai perdu quelques plumes », finit-il par admettre en racontant ses déboires sentimentaux.
Il en rit de bon cœur, et ceux qui le connaissent bien savent que des jolies jambes, un gentil minois feront craquer sa soi-disant carapace.
Les expériences de la violence à travers son existence sont nombreuses, violences directes, quelquefois indirectes et angoissantes.
À Medellin, il a vécu une aventure traumatisante.
Il raconte : « J’étais assis à la terrasse d’un café. Un gars est sorti de sa boutique pour aller à la banque, je suppose. Deux types en moto sont arrivés en trombe, ont sorti des revolvers de leur poche et commencé à tirer dans la direction du gars. On se serait cru dans un film de cowboys », dit-il dans un grand éclat de rire.
Les balles sifflaient au-dessus de sa tête, dont une qui a fait éclater la vitre à quelques centimètres de lui. Malgré tout, il restait vissé à sa chaise. « C’est le garçon de l’hôtel qui est venu me tirer par le bras pour me mettre à l’abri. »
Il reconnaît que cette aventure l’a fait réfléchir, mais sans le convaincre toutefois de quitter le pays pourtant en proie à une violence quotidienne. Les attaques à main armée, les vols à moto étaient et sont encore monnaie courante.
Il se souvient qu’une autre fois en début d’après-midi, il se promenait avec sa fille dans une petite rue tranquille de la ville.
« Deux types à moto ont surgi. Le premier m’a collé un revolver sur la tempe tout en m’arrachant du cou une chaîne en argent que j’avais payée à peine 10,00 $. L’autre malfrat a immobilisé ma fille et il l’a frappée violemment. Elle s’est mise à pleurer. Durant ces secondes éternelles, j’ai bien cru que ma vie et celle de ma fille ne valaient que 10,00 $. »
Allait-il quitter le pays après ces chocs multiples?
Allait-il rester? Sa fille allait-elle s’adapter au changement? Est-ce que la mère de l’enfant accepterait de la voir vivre ailleurs, dans un pays étranger? Il a décidé de se laisser porter par les événements.
Quitter la Colombie? Une décision difficile. Une partie de sa vie y était déjà imprimée profondément. Il est venu tout de même à Montréal durant quelques mois, avec sa fille. C’était un test. Pour elle et pour lui.
Charles désirait avant tout qu’elle se sente aimée et en sécurité et qu’elle puisse poursuivre ses études. À huit ans, la petite Colombienne s’adaptait à l’école francophone de même qu’à son nouveau milieu de manière remarquable. Mélissa, comme la majorité des petites filles de cet âge, vouait à son père un véritable culte. Ensemble, ils formaient une équipe, un clan. Elle participait, enthousiaste, aux projets d’installation du nouvel atelier-galerie de son père, pinceaux et rouleaux à la main.
– Tu vois, papa, comme ça va être beau! Ne te décourage pas.
Son père est encore ému en revivant cette scène qu’anime cette petite femme sensible.
Cet atelier-galerie dont l’espace convenait à merveille à l’artiste était situé rue Notre Dame, dans le Vieux-Montréal. Carson pouvait travailler et exposer en même temps. Plafond tout en hauteur, mezzanine, il avait tout le recul souhaité pour travailler d’immenses tableaux. En outre, le décor naturel était inspirant : vieilles poutres, pierres d’origine, lattes de pin au sol, immense fenestration offrant une généreuse lumière. Pour plus de confort, il a lui-même aménagé un coin cuisine et une salle de bain. L’aménagement a été un projet réussi d’une équipe père-fille.
C’était un lieu de création idéal où il pouvait laisser libre cours à sa créativité effervescente et connaître la joie pure de sa liberté.
Toute cette démarche avait un air de stabilité qui remettait à plus tard les décisions concernant ses propriétés et ses biens en Colombie.
Cependant, quelques fantômes sont revenus le hanter. Se réapproprier son monde, sa culture, son environnement signifiait en même temps retrouver d’anciennes tracasseries, qu’il a fuies en allant en Colombie. Dieu seul sait combien il aimerait poser sa valise une fois pour toutes, s’entourer de complicités et d’amour, faire revivre une vie sociale riche de partages. Il devrait reprendre en quelque sorte une vie normale, planter ses racines dans le terreau québécois, retrouver un port d’attache, en se sentant libre de part,, , , , , ir quand il le voudrait.
« La stabilité m’a longtemps fait défaut : et l’instabilité crée de l’éparpillement. »
Pour ne pas avoir à affronter encore la série noire de son passé, il a pensé aller vivre aux États-Unis : sa fille serait plus près de lui, il pourrait tourner la page définitivement. Et puis, ce ne serait pas mauvais, songeait-il, l’établissement d’une carrière internationale via Boston ou New York.
« J’y pensais à cette vie américaine, quand un jour un couple de mes amis m’a offert de les accompagner pour un voyage d’une quinzaine de jours à Cuba. Ce hasard, ce détour dans mes plans a changé ma destinée. »
À Cuba, il a fait la connaissance d’une jeune femme, Yanelis Reynaldo. Elle a quelques années de moins que lui, et ce fut le coup de foudre. Il ne repartira pas de Cuba sans elle. Il tient à ne pas rater cette nouvelle chance que la vie lui offre.
Mais la ramener ici, au Canada, constitue toute une histoire, surtout avec un visa à titre de touriste. « Une aventure incroyable », raconte Charles, un roman feuilleton, une saga. Il doit user de diplomatie auprès des autorités à la fois cubaines et canadiennes, être convaincant, ferme, adroit. Les règles de l’immigration sont strictes, il ne peut pas les contourner. Yanelis est éperdue de confiance et de reconnaissance, même si certains jours elle perd espoir. Mais son homme est un preux chevalier qui n’hésite pas, par amour, à déplacer des montagnes!
Après une forte dépense d’énergie et d’argent, le couple peut enfin passer l’été à la maison de campagne du Québec, au bord de la rivière à regarder l’eau couler.
Ces sept dernières années, il s’est attaché à lui faire découvrir le monde et son monde à lui. Ils ont vécu la grande vie, beaucoup voyagé, appris à vivre ensemble.
Aujourd’hui, la jeune Cubaine apprivoise les hivers et la langue française. À quelques reprises, elle est retournée à Cuba visiter sa famille ou a elle-même accueilli sa mère pendant plusieurs mois. Une aide précieuse pour une jeune mère préoccupée de la vie et du bonheur de l’enfant Yann qui fait désormais partie de leur vie.
Charles a dû, rapidement, dès son arrivée au Québec, prendre d’autres décisions. En premier lieu, celle de s’installer dans le Vieux-Montréal de façon permanente. Un problème de taille a surgi. Que faire des œuvres d’art qu’il possédait en Colombie?
L’inventaire était fabuleux et comprenait plusieurs sculptures de bronze de Botero, de Buskaviski; des centaines de tableaux de peintres colombiens, des dizaines de porcelaines Capo di Monte, Lladro, et plus encore. On y trouvait un immense vase de Chine, du mobilier Louis XV, des meubles et sculptures en pierres de corail. Et une chose qu’il regrette particulièrement d’avoir abandonnée : un coffret peint par Salvador Dali. Un véritable petit musée dont certaines pièces étaient considérées patrimoine national et ne pouvaient, de toute façon, quitter le pays. Les pièces que le collectionneur a dû laisser derrière étaient soit trop imposantes pour être transportées, soit trop fragiles. L’abandon de ce trésor l’attriste encore. Collectionneur dans l’âme depuis sa tendre enfance, il reste attaché aux choses matérielles, celles qui ont un sens vivant, qui racontent une histoire et témoignent de ceux qui les ont créées.
Il ne peut et ne veut pas s’appesantir sur des regrets, il lui faut rattraper le temps perdu, travailler à rebâtir une collection de ses œuvres, créer de nouvelles alliances avec des galeries d’art. Toutes ces années d’absence de son pays d’origine, c’est long pour un artiste!
Cependant, sa brillante carrière colombienne témoigne d’une production impressionnante qui n’a jamais ralenti, qui ne s’est pas essoufflée. Par ailleurs, il a toujours maintenu de bonnes relations avec divers intervenants, galeristes et collectionneurs en art, ici même au pays.
Sa carrière canadienne, dès son retour en l’an 2000, a donc repris de plus belle, par de nouvelles œuvres percutantes.
Nourrit-il la nostalgie de son existence colombienne passée? Il y a certes une part de lui qui est restée colombienne. Ce pays a soigné ses blessures, l’a reçu avec affection; sa vie là-bas sous le soleil dans une sorte d’oubli, voilà ce qui va lui manquer. Il en conserve au fond de lui un souvenir lumineux, et des trésors d’images qui serviront son art incontestablement.
Carson est un battant, on le sait. Il est d’un tempérament actif, résolument axé sur l’avenir en forme de projets, d’idées à concrétiser. Il est revenu à la case départ de son monde à lui, bien résolu à se tailler la part du lion.
Dès son retour au Québec, il n’a qu’une quête : se remettre au travail. Après, bien sûr, avoir réglé l’essentiel de sa vie personnelle.
Plus riche de 30 années d’accumulation d’idées, d’images inscrites dans son cerveau, de créativité. Plus riche aussi d’années derrière lui, d’expériences humaines, d’aventures. Repartir à zéro est une image de style, car il a tout en lui pour continuer sa route comme artiste. Détermination, audace, opiniâtreté.
Il a retrouvé le décor de son ancienne vie, les rues de Montréal, quelques amis fidèles. Mais qui sont nos amis? Les vrais? Il s’accrochait à l’espoir de forcer l’admiration de ses concitoyens et compatriotes.
Le peintre Chagall avait connu cela lui aussi et écrivait, lucide :
« Je ne serai pas surpris, si après une longue absence, ma ville efface mes traces et ne se rappelle plus celui qui, abandonnant ses propres pinceaux, se tourmentait, souffrait et se donnait la peine d’y implanter l’Art, qui rêvait de transformer les maisons ordinaires en musées et l’habitant vulgaire en créateur. Et j’ai compris que nul n’est prophète en son pays. »
Il ramenait dans ses bagages une partie de sa gloire colombienne. Tout gonflé de cette fierté, il aurait voulu que les siens, les êtres d’ici le reconnaissent comme l’enfant prodigue de retour enfin!
Il s’est dit que sa recherche picturale prendrait forme à force de gestes, et de ruptures même avec ses anciennes techniques. Oser. Détenir une clef. Car où sont ses limites? Sait-il qu’à chaque détour, il y a une partie de ciel bleu qui apparaît, puis vole en éclats? « L’Art est utile parce qu’il est un cri du cœur, une contestation, une quête d’absolu, un geste de sensibilisation, de révolte... C’est en cela que l’Art est utile », dit-il.
Il a participé au Salon international des Galeries d’art du Québec tenu en l’an 2000, au Marché Bonsecours à Montréal. Cet événement lui permettra de se replonger dans le milieu des arts canadiens, d’annoncer en quelque sorte sa présence, son retour.
Madame Denise Di Candido (1946-2006), elle-même galeriste de renom (Le Relais des Époques), présidait l’événement. Elle a saisi l’occasion pour parler de Carson en ces termes :
« De nombreux artistes tentent de s’exprimer en art abstrait ou semi-figuratif, mais peu réussissent à créer leur propre style avec autant de talent et de créativité. L’artiste présente des œuvres fortes et lumineuses... un foisonnement de couleurs chaudes et froides qui se superposent avec bonheur sur la toile en un amalgame harmonieux et subtil. Carson fait preuve d’une parfaite maîtrise dans son travail, il sait toujours ce qu’il veut traduire. »
Son premier atelier avait, on le sait, pignon sur la rue Notre-Dame dans le Vieux-Montréal. Revirement peu de temps après : il aménage dans un nouvel atelier, rue Queen, toujours dans le Vieux-Montréal. L’artiste se crée un cocon très intime face au majestueux fleuve Saint-Laurent. Entre l’escalier en colimaçon, la terrasse immense sur le toit, il a recréé l’atmosphère sud-américaine de son ancienne vie. L’endroit, en tout cas, semblait fabuleux pour réaliser ce dont il avait envie : des murales, des fonds marins élaborés, des mosaïques monumentales qu’il présentera en exposition à l’atelier même, en 2002.
Les couleurs de ses tableaux de l’époque témoignent d’une partie de ce qu’il entendait révéler au monde, sa dualité, les influences sociales et culturelles qui l’ont marqué. Dans la forme, exotisme tropical et automne québécois intimement liés; dans le fond, joie de vivre et force vitale.
Et il y est parvenu. Les portes de plusieurs galeries d’art se sont ouvertes devant lui sans qu’il ait à les enfoncer. Aucun tam-tam ne vaut sa présence à lui, son approche charmeuse désarmante, et surtout, en porte-étendard, sa peinture. Elle a toujours exprimé mieux que des mots, mieux que lui-même la profondeur de son talent. Elle est simplement éloquente.
Les expositions se suivent de Montréal à Boston, de Boston à Paris; Florence, Vercelli, Miami. Bref, on retrouve ses tableaux dans les grandes capitales du monde, et il collectionne les récompenses et les honneurs.
À cause de toutes ces années passées loin du Québec, en l’an 2000, il doit se réapproprier les us et coutumes d’un pays qui avait beaucoup changé en dix ans, même s’il revenait de temps à autre en tâter le pouls.
Au cours des premiers mois de son retour, il s’est senti souvent plus espagnol que francophone. C’était surtout difficile de se sentir étranger dans son propre pays. « Si j’entendais quelqu’un parler espagnol, j’allais le voir et j’avais un tas de choses à lui raconter, bien plus qu’en français. »
Le rythme de vie était différent en Amérique latine, les mentalités aussi. « Quand, ici, ton meilleur ami, c’est ton ordinateur, les valeurs sont moins humaines. J’avais pris l’habitude d’être assis autour d’une table en bonne compagnie pour manger évidemment, mais surtout pour parler et rire. On avait le temps de vivre. Maintenant, les journées passent et je ne les vois pas. Tout le monde travaille comme des “malades”. »
« À notre époque, tout est banalisé, déclare Caroline Leroux. On privilégie les reproductions, l’instantané, l’imagerie. Pourtant, c’est d’un terrain beaucoup plus profond, d’une terre beaucoup plus riche que nous parvient la vision de Carson. L’artiste nous présente sa vision du monde, son regard, ses émotions fugitives chaque jour renouvelées et nous les livre lors d’un rendez vous intime, à la croisée d’une route imaginaire, là où deux mondes se confrontent et se rencontrent, là où se cache l’œuvre d’art », dit-elle.
Les mosaïques sont nées d’une évolution.
« Un véritable prestidigitateur. Il continue à chercher de nouvelles pistes, plutôt à créer hors piste de pures œuvres abstraites, des mosaïques abstraites, des mosaïques figuratives, des plumes, des abstraits avec filets... »
Louis Lefebvre, critique d’art français, a écrit : « Toujours en recherche pour dynamiser ses toiles, il a fragmenté à la fois formes et matières pour mieux les rassembler au cœur de ses tableaux selon le principe de la mosaïque… Au départ, cela a commencé par des applications de couleurs sans vraiment de transparence. Un peu comme pour l’apprentissage d’une deuxième langue ou celui du piano. Et puis, petit à petit, tout est arrivé. Presque naturellement, couleurs et transparences se sont fondues dans les toiles. »
Les mosaïques de Carson témoignent d’une recherche inventive et de sa volonté de se baigner dans la lumière des vitraux d’églises qu’il aime tant. Il explore aujourd’hui encore le rituel de la lumière emprisonnée dans la matière qu’il applique à la spatule.
Voici ce que, pour sa part, Leonel Jules, écrivain d’art, en pense : « Charles Carson innove dans la production récente de ses mosaïques, par un geste qui se singularise avec véhémence, après cette fusion dans le lieu commun de la grande peinture. Un univers où à loisir on peut voir Riopelle, Pollock, le Québec et l’Amérique tout entière. »
Le peintre Riopelle revient en filigrane dans l’analyse primaire des mosaïques de Carson, comme s’il fallait toujours comparer pour comprendre. On doit admettre qu’un œil peu averti cherche sans doute à y voir des ressemblances. « La parfaite coordination des plans, la synthèse de rythmes, l’organisation et l’éclat de la palette de Carson ne sont pas sans rappeler les merveilleux tableaux de Riopelle des années 1950, 1960 », reconnaît Bruens.
Il poursuit en proposant toutefois ce regard avisé : « Depuis cette époque, aucun artiste n’avait réellement réussi à reproduire une peinture de qualité de ce style particulier. Charles Carson peut, par la juxtaposition des couleurs, obtenir une limpidité et une transparence qui ne ressemblent en rien à la technique de Riopelle. Elle est d’une égale qualité. »
Guy Robert, pour sa part, a fait preuve de clair-voyance, dès les premiers tableaux qu’il lui a été donné d’analyser.
« Que proposait un Riopelle dans ses tableaux mosaïqués des années 1950, sinon une vision personnelle et enthousiaste de ses excursions en forêt ou sur les glaciers, de ses voyages de chasse ou de pêche? La Nature y vibre en effet de partout, et, un peu plus tard, à partir de 1968, en surgira tout naturellement un bestiaire, bientôt dominé par les hiboux.
La démarche de Carson se distingue de celle d’un Riopelle en se glissant à la frontière entre abstraction et figuration, dans leur champ de rencontre. On évite ainsi la vaine querelle qui les oppose si souvent, ou plutôt on réconcilie les deux credo... Les deux hommes proposent leur propre réalité, celle de leur vision personnelle... »
Un autre homme a fort bien connu Jean-Paul Riopelle, qui était dans le cercle des amis intimes et avec qui il partageait diverses passions dont celles de la pêche et de la chasse. Il s’agit de Champlain Charest, médecin-restaurateur, grand collectionneur de vins, amoureux collectionneur d’art. Rappelons que le Bistro à Champlain situé à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson abrite plus de 35 000 bouteilles, et que c’est avec Riopelle, présent sur les murs, qu’il s’en était porté acquéreur en 1974. Les deux hommes s’étaient connus à Paris en 1968 et n’étaient pratiquement jamais éloignés l’un de l’autre longtemps.
Tant de passion anime cet homme! Et lorsqu’il choisit d’aimer, qu’il s’agisse d’un vin ou d’un artiste, il est entier. On l’imagine attablé avec Riopelle, refaisant le monde, parlant de chasse et d’art. Ses coups de cœur sont éclatants. Qui mieux que lui peut mettre en parallèle le talent des deux artistes, puisqu’il a fait la rencontre de l’œuvre de Carson récemment. Et qu’il a été séduit.
Lorsqu’il est entré en contact avec l’artiste et ses tableaux, il a senti « une force, une grande force », dit-il.
« Pour moi, la technique mosaïque de Carson évoque un peu les tableaux que Riopelle faisait dans les années 1950. Coups de spatule, progression du tableau vers un endroit bien précis. Il y a un sens au tableau, un endroit où le regard s’accroche, converge vers le centre de ce tableau-là, tel qu’on le retrouve chez les peintres abstraits : donc, pour moi, la lumière vient d’en arrière du tableau, passe au travers et se projette devant soi. »
Doit-on comparer les deux artistes et se contenter de ce regard rapide sur leurs œuvres et leur force?
« Dans l’œuvre de Carson, il y a une recherche multicolore qu’on ne retrouvait pas chez Riopelle; avec le rouge par exemple, ou le bleu, le tableau entier était presque tout rouge ou tout bleu. Ici, c’est la densité des différentes couleurs qui fait la différence d’avec Riopelle. C’est un véritable foisonnement. »
Champlain Charest veut être plus précis : « Bien sûr, Riopelle utilisait des couleurs, mais l’ensemble du tableau montrait moins de ces coups de spatule, moins de couleurs dans chaque coup de spatule. Il faut une habileté extraordinaire pour arriver à ce résultat, selon moi. »
Bien qu’il se défende d’être un expert du calibre d’un historien ou d’un critique d’art, il revient à son regard « coup de cœur » qui justifie tous ses achats en art. « Non seulement il est habile dans la disposition des couleurs, mais ses tableaux me disent quelque chose. J’aime entre autres l’équilibre des masses, la transparence. J’apprécie particulièrement ses œuvres carsonistes, une manière de peindre qui va aller très loin… »
Et il conclut, admiratif : « Ce sont des tableaux très denses, très forts, répète-t-il, et qui prennent tout. Ça laisse les autres dans l’ombre, un petit peu... »
« C’est un homme assuré par le succès! »
Charles Carson a toujours ses spatules, ses toiles tendues, le fil de ses nuits, pour entreprendre d’autres recherches, et aller à la rencontre d’une vie intérieure réconciliée, plus sereine, malgré ce doute tonique qui l’habite et qui provoquera à n’en point douter des naissances picturales multiples d’envergure.
L’homme, entre-temps, n’a pas vieilli, du moins en apparence. La cinquantaine marque une étape importante. Elle est comme une solide assise, un point d’ancrage d’un nouveau souffle.
Un jeune enfant dans sa vie apporte son lot d’inquiétudes évidemment, de bonheurs, et provoque aussi une forte impulsion de créativité. Il y a d’ailleurs, avec le temps qui passe, la remise à l’endroit du tricot compliqué de la vie, avec des choix plus clairs. Charles n’échappe pas au besoin de sentir autour de lui ce qu’il privilégie par-dessus tout : la vie, ses enfants, la tendresse. L’Art.
Sur la table de son atelier, surgie de plusieurs nuits et jours fébriles, une sculpture étrange en gestation prend toute la place.
Jaillie des réminiscences de ses fonds marins tant admirés, elle tend vers la lumière, comme pour se montrer nue dans toute sa beauté et sa fragilité.
Le peintre, devenu sculpteur par besoin de façonner la matière, entreprend là une nouvelle démarche artistique.
Pour l’artiste, il s’agit non pas seulement d’un plaisir passager, d’une aventure banale en esthétisme, mais d’un réel cri du cœur. « Voyez ce que notre monde recèle de beautés! Ne les détruisons pas. »
C’est un cap rosé, non c’est un récif de corail où se cachent des poissons fabuleux, des petites bêtes des profondeurs. Il en a ciselé les arêtes, les creux et les surfaces pour transmettre en trois dimensions le monde de la mer. Les couleurs sont issues de sa palette habituelle carsoniste et font émerger un « trésor des Caraïbes ». Ou n’est-ce pas plutôt quelque merveille dérobée à un authentique royaume disparu?
Faut-il y voir un message prémonitoire? L’artiste est un poète; la matière inerte dont il tire la vie est son égérie.
« Sensible aux questions écologiques et environnementales, son sujet est généralement la nature. C’est d’elle qu’il tire son inspiration, c’est encore elle qu’il capte dans ses diverses formes, nous la ramenant transformée par la lumière de son imaginaire. Ode à la nature. Éloge des fonds marins et des champs d’oiseaux des forêts tropicales », dit la muséologue, Arévik Vardanyan.
Il veut laisser son empreinte aux générations futures, il veut aussi laisser sa marque, une trace de son passage dans notre univers, c’est entendu. Tous les symboles sont en place. La maison chante, la rivière coule et le temps avance.
Où s’en va-t-il ainsi? Où nous convie-t-il?
Caroline Bruens, présidente de l’Académie internationale des Beaux-Arts du Québec, a sans doute une bonne réponse à ce propos. « Reprendre le flambeau de ses prédécesseurs. Transformer sa vision, son inspiration, ses images mentales en tableaux, les jeter sur la toile. Créer un face-à-face où le peintre et l’observateur, l’amateur, le spectateur pourront le rejoindre pour s’y perdre. Une œuvre de communication, de communion, une œuvre habitée. »
Les mosaïques ne lui font pas perdre de vue le carsonisme, plus apte par sa manière à entretenir l’amour de la nature avec laquelle il se sent complice. L’artiste explore de véritables sentiers à l’aube dans sa forêt environnante. Il reste attentif aux signes, à sa fragilité. Elle y renferme une vie dont il nourrit sa peinture. Et sa vie personnelle. « Qu’allons-nous laisser à nos enfants comme héritage? »
Le monde ne tourne pas qu’autour de lui. Le nouveau millénaire annonce un remue-ménage planétaire. Les changements climatiques, les bouleversements politiques sont à l’ordre du jour. Tout bouge, tout explose : tsunamis et guerres.
L’artiste ne peut pas rester insensible, ni l’homme, à cette Terre qui se transforme, agonise. Comment traduire en gestes sur le canevas vierge ce qui l’habite et le trouble? Pourtant, il y a cet irrépressible besoin d’être heureux, l’espoir malgré tout que l’Homme responsable de sa perte trouvera également les remèdes à sa guérison.
Carson veut encore y croire. Et, pour le prouver, il fait éclater la couleur. Celle qui remplit les yeux, celle qui réjouit.
Il prend le parti de ne pas traduire un univers sombre et catastrophique. Il fait contrepoids à la déraison et s’engage résolument à consoler, à rassurer. Sa réaction est d’entraîner le regard plus loin, dans une sorte de jubilation, de force intérieure : toutes qualités aptes à conjurer le mauvais sort et la grisaille.
C’est à nous de le suivre sur cette voie au-delà du simple regard.
|
|
|